
par Jean.Michel Olivier
Hautboïste virtuose, férue d'histoire genevoise et enseignante de français et de musique au Collège de Saussure, Catherine Fuchs (née à Genève en 1957) parvient à marier ses passions avec succès. Après deux romans et trois recueils de poésie (parus chez Éliane Vernay et Empreintes), elle nous donne aujourd’hui La Beauté du geste*, une vaste fresque polyphonique, subtilement orchestrée, qui fait entendre cinq voix de femmes, au seuil de la quarantaine, dont les destins se croisent, à l’occasion d’un concert où toutes les passions s’exacerbent. Elle s’en explique ici. Entretien.
— Vous avez publié deux romans et trois livres de poésie. Quelle différence faites-vous entre écriture narrative et écriture poétique ?
— Pour moi, il n'y a pas vraiment de différence entre écriture narrative et écriture poétique. Il s'agit avant tout d'une question de forme, de cadre. Le poème est plus ramassé, plus concentré, certes, mais la démarche est la même : trouver les mots qui résonnent, qui correspondent au mieux avec l'envie de dire... En plus, mon dernier roman est construit par petites séquences et j'ai conçu plusieurs d'entre elles comme des textes poétiques. Seuls les dialogues supposent un type d'écriture bien spécifique.
— Plusieurs de vos livres ressuscitent des époques passées. La Beauté du geste se passe de nos jours. Pourquoi ce saut ?
— Je suis a priori toujours passionnée par l'histoire, et je n'exclus pas d'y retourner, mais j'avais envie, cette fois.ci, de parler au présent et de mettre moins de distance entre mes personnages et moi-même.
— Votre roman est polyphonique. Cinq voix de femmes s'entremêlent et se répondent. D'où vous est venue cette idée ?
Je ne me souviens plus exactement ! Il faut dire que j'ai commencé ce livre en 1998... Donc entre les ré-écritures, les corrections, les doutes divers et variés, du temps a passé ! Mais je sais que j'avais envie de parler des femmes d'aujourd'hui (de mon milieu, évidemment, je n'ai pas essayé de me glisser dans la peau d'une ouvrière ou d'une immigrée clandestine) et ces différents personnages se sont sans doute assez vite imposés à moi. C'était aussi une manière de me diviser en cinq, de ne pas concentrer tout ce qui m'appartient dans une seule femme.
— La musique est le vrai centre du livre. Quelle place occupe-t-elle dans votre vie ? Est-ce la première fois que vous en parlez dans vos livres ?
— Non, j'ai déjà évoqué la musique ou certains compositeurs dans plusieurs poèmes et dans mon roman précédent, En mal d'innocence**, le personnage principal est pianiste et compositeur. Toutefois, c'est effectivement la première fois que je donne à la musique cette place centrale. Il faut dire que je suis musicienne moi-même (j'ai fait des études de hautbois et j'ai joué comme professionnelle pendant de nombreuses années, et continue à la faire occasionnellement) et je m'étais toujours dit que je tenterais un jour de parler de la musique, de dire tout ce qu'elle m'a apporté. « Sans la musique, la vie serait une erreur » a écrit Baudelaire. Je partage cette opinion, je crois que de tous les arts, c'est celui qui me nourrit le plus immédiatement, physiquement. Bien sûr, il y a la peinture, la littérature, le cinéma, etc. mais la musique a quelque chose d'unique, lié aux sons et à leurs propriétés. Pour moi, elle nous met en rapport avec l'indicible. Précisément ce que les mots ont parfois peine à... dire ! Et ce n'est sans doute pas un hasard si la musique est si souvent utilisée par toutes les religions ou spiritualités. Si j'ai choisi la Messe en si, c'est aussi pour rendre hommage à Bach et à sa formidable capacité d'illustrer musicalement sa foi en Dieu ; sa musique témoigne, elle chante mieux qu'aucune autre un espoir fou, celui que notre vie a un sens qui nous dépasse.
— Tous les personnages du livre ont quarante ans et sont en quête de sens ? Est-ce la fameuse crise de la quarantaine ?!
— Oui, on peut dire cela comme ça (d'ailleurs Isabelle évoque cette crise, même si elle en sourit), même si je pense que les crises n'attendent pas les chiffres ronds pour s'annoncer. Mais si tout va bien., ça ne fait pas un roman, n'est-ce pas ? Il est tjs plus intéressant de montrer des personnages en train de se remettre en question, de douter, de chercher.
—Les hommes, dans votre livre, sont souvent des ombres qui passent. Comme ce chef d'orchestre qui fascine par ses gestes et son mystère ?
— Effectivement, les hommes ne sont vus qu'à travers les personnages féminins dans ce roman. C'est un choix, car un des sujets du livre, ce sont précisément les rapports hommes-femmes et je trouvais plus juste, plus honnête, d'en parler du côté que je connais, que je maîtrise, à savoir celui des femmes ! Voilà pourquoi on ne suit aucun homme en focalisation interne. Cela dit, les personnages masculins jouent un rôle immense dans cette histoire. Ils sont sans cesse présents dans les pensées des héroïnes. Le chef, Gianni Orsini, symbolise le séducteur, celui qui s'impose dans une vie, qui la bouleverse de fond en comble.
— Les musiciennes sont-elles toujours fascinées par le chef d’orchestre ?!
— Il est clair qu'un chef d'orchestre, de par sa position de pouvoir, exerce un attrait sur ceux — et surtout celles — qui dépendent de son autorité (on connaît bien le principe !), et ce d'autant plus s'il est compétent et qu'à ses qualités propres s'ajoute le charme de la musique. C'est un mélange explosif ! Mais au-delà de ça, je voulais symboliser par ce personnage essentiellement absent l'importance des manques qui nous construisent et nous font avancer. Chacun cherche, plus ou moins assidûment, avec plus ou moins d'intensité suivant les moments de sa vie, mais personne (du moins me semble-t-il) ne peut se prétendre complet, abouti. Les jeux de séduction tournent souvent là autour et si l'on s'y précipite avec tant d'ardeur parfois, c'est souvent parce qu'on espère y trouver une forme de réponse. Mais cette réponse, souvent, fuit encore plus loin. C'est ce que vont vivre plusieurs de mes héroïnes dans le roman. Heureusement, peut-être, car la quête se poursuit....
* Catherine Fuchs, La Beauté du geste, roman, Bernard Campiche, 2010.
** Catherine Fuchs, En mal d’innocence, roman, éditions Slatkine, 2002
 On y va sur la pointe des talons : les spectacles présentés dans les Maisons de quartier sont souvent teintés d’amateurisme, tout au mieux éclairé, croit-on. Mais on sait aussi que c’est dans ces lieux improbables que naissent parfois de belles carrières.
On y va sur la pointe des talons : les spectacles présentés dans les Maisons de quartier sont souvent teintés d’amateurisme, tout au mieux éclairé, croit-on. Mais on sait aussi que c’est dans ces lieux improbables que naissent parfois de belles carrières.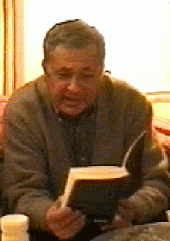
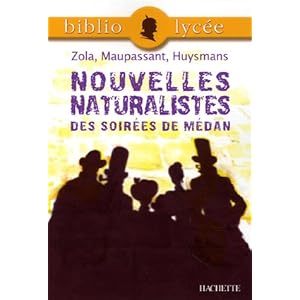 Il y a quelque chose dans le genre de la nouvelle qui me semble, je dois l’avouer, un peu suspect. Vieillot en tout cas. Lié au XIXème siècle, où cette forme a triomphé grâce aux journaux.
Il y a quelque chose dans le genre de la nouvelle qui me semble, je dois l’avouer, un peu suspect. Vieillot en tout cas. Lié au XIXème siècle, où cette forme a triomphé grâce aux journaux. quand sa mère lui avoue que son vrai père est en fait un autre homme. Ailleurs, un ancien petit ami est devenu un pantin militariste à cause de l’armée et finit par se jeter au bas des rochers. Une autre nouvelle est thématiquement construite autour du thème de la boucherie. Il y aussi une narratrice qui rencontre en Grèce un dernier de famille, immigré revenu au pays, puis une Allemande qui se plaint de tout et a peut-être tué son mari. La narratrice se demande si le Grec l’aime et s’interroge sur le destin. C’est de circonstance, puisqu’on est en Grèce...
quand sa mère lui avoue que son vrai père est en fait un autre homme. Ailleurs, un ancien petit ami est devenu un pantin militariste à cause de l’armée et finit par se jeter au bas des rochers. Une autre nouvelle est thématiquement construite autour du thème de la boucherie. Il y aussi une narratrice qui rencontre en Grèce un dernier de famille, immigré revenu au pays, puis une Allemande qui se plaint de tout et a peut-être tué son mari. La narratrice se demande si le Grec l’aime et s’interroge sur le destin. C’est de circonstance, puisqu’on est en Grèce...
 Notre ami Pascal Rebetez, orpailleur poétique, est tombé sur une pépite. Un recueil arrivé aux
Notre ami Pascal Rebetez, orpailleur poétique, est tombé sur une pépite. Un recueil arrivé aux  Chacune des parties définies par Milhi
Chacune des parties définies par Milhi
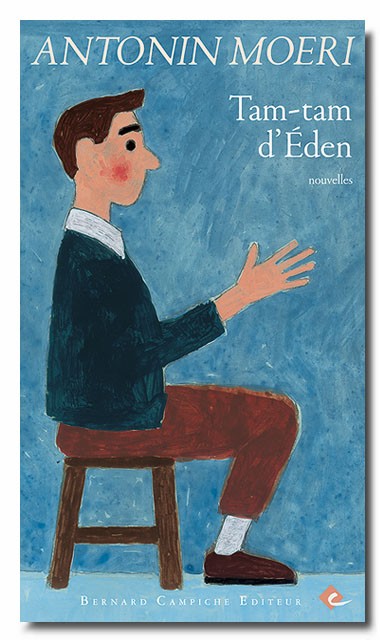

 Evidemment, si elle coule facilement, sa langue ne fera pas précisément frissonner les amateurs de belle littérature. Houellebecq est l’exact contraire de Pierre Michon par exemple, qui vise à assembler dans son texte une suite de beaux morceaux d’écriture. Dans La carte et le territoire, la critique est « unanime dans la louange », le personnage « consacra sa vie à l’art », le galeriste « réagit avec enthousiasme », etc.
Evidemment, si elle coule facilement, sa langue ne fera pas précisément frissonner les amateurs de belle littérature. Houellebecq est l’exact contraire de Pierre Michon par exemple, qui vise à assembler dans son texte une suite de beaux morceaux d’écriture. Dans La carte et le territoire, la critique est « unanime dans la louange », le personnage « consacra sa vie à l’art », le galeriste « réagit avec enthousiasme », etc.