Anne-Claire Decorvet, Prix Édouard-Rod 2015
par Jean-Michel Olivier
« La folie, écrit Michel Foucauld, c’est l’absence d’œuvre ».
Il la compare à cette phrase paradoxale : "Je mens". Quand le fou parle, il dit quelque chose comme "Je délire". Comment peut-on délirer et, en même temps, dire de soi-même : Je délire ? Comment peut-on fixer les règles de son propre langage au moment même où l'on parle? Ce qui caractérise la folie, c'est qu'elle ne suit pas les mêmes règles du langage que le discours courant. Le fou a la capacité de parler une langue dont il définit lui-même les règles. Du point de vue du discours, il ne dit rien, c'est pure vacuité (absence d'oeuvre). Et pourtant cette « absence » donne l'essence même du langage dans le temps où il émerge.
Comment dire la folie ?
 C’est le défi que s’est donné Anne-Claire Decorvet. Un défi ancien, déjà, qui remonte à son premier livre, paru en 2010 chez Bernard Campiche, intitulé, comme par hasard, En habit de folie. Il s’agissait, dans ce recueil de nouvelles, de parler de folie ordinaire. S'appuyant sur des faits divers survenus ces dernières années, Anne-Claire Decorvet réussit à éclairer d'un point de vue nouveau et original quelques-uns de ces événements ayant largement défrayé la chronique. Qu'il s'agisse des déséquilibres mentaux engendrés par un travail de vidéo-surveillance, des nuisances olfactives causées par une femme atteinte du complexe de Diogène, d’une mère infanticide ou de cet auxiliaire de santé qui entretient des rapports intimes avec des personnes handicapées, jamais l'auteur ne tombe dans les clichés ou les considérations banales. Elle cherche à chaque fois à pointer les limites de la raison ou de la déraison : ce moment subreptice où l’individu considéré comme « normal » bascule dans la folie.
C’est le défi que s’est donné Anne-Claire Decorvet. Un défi ancien, déjà, qui remonte à son premier livre, paru en 2010 chez Bernard Campiche, intitulé, comme par hasard, En habit de folie. Il s’agissait, dans ce recueil de nouvelles, de parler de folie ordinaire. S'appuyant sur des faits divers survenus ces dernières années, Anne-Claire Decorvet réussit à éclairer d'un point de vue nouveau et original quelques-uns de ces événements ayant largement défrayé la chronique. Qu'il s'agisse des déséquilibres mentaux engendrés par un travail de vidéo-surveillance, des nuisances olfactives causées par une femme atteinte du complexe de Diogène, d’une mère infanticide ou de cet auxiliaire de santé qui entretient des rapports intimes avec des personnes handicapées, jamais l'auteur ne tombe dans les clichés ou les considérations banales. Elle cherche à chaque fois à pointer les limites de la raison ou de la déraison : ce moment subreptice où l’individu considéré comme « normal » bascule dans la folie.
Comment dire la folie, donc ?
Dans son dernier ouvrage, Un lieu sans raison — qui est son premier roman — Anne-Claire Decorvet décortique, une fois encore, la mécanique de la folie. Ou plutôt elle tente d’en dénouer les fils. La folie est un labyrinthe. Une toile serrée qu’on tisse chaque jour et qui finit par vous emprisonner. Au sens propre comme au sens figuré, puisque Marguerite Sirvins, l’héroïne du roman de Anne-Claire Décorvet, fut internée près de trente ans à Saint-Alban, un asile oublié de Lozère. C’est là, dans cet ancien château fort, que la folie se noue, qu'elle prolifère, contagieuse, d'interné en interné, qu'elle se sédimente, se pétrifie, à l'image de cet endroit clos et minéral. Avant leur entrée à l’asile, les « fous » ne le sont pas. « Gâteux, trisomiques ou rebelles », les familles s'en débarrassent. Puis le confinement fait le reste, surtout quand on est encadré par des sœurs de charité peu charitables.
 Dans ce roman à la texture intense, Anne-Claire Decorvet tire plusieurs fils. Il y a d’abord l’enfance de Marguerite Sirvins, qui n’est pas malheureuse, même si elle est marquée par des événements traumatiques (mort d'un petit frère à peine né, mort d'une collègue après un avortement, ravage de la Grande Guerre). Car Marguerite est fille de bonne famille, éduquée, élégante, libérée (elle travaillera dans une boutique de mode à Paris). Mais déjà pèse sur elle l’ombre rigide de sa mère, incarnation d’un sur-moi écrasant. La voix de Marguerite, qui parle à la première personne au début du roman, va éclater, se diffracter en plusieurs voix intérieures, premier signe de schizophrénie. Mais ce qui causera le basculement dans la « folie », c’est une liaison avec un homme marié — passion qui habitera Marguerite toute sa vie. Et nourrira son éternel rêve d’amour, d’union charnelle, réalisé dans sa fameuse robe de mariée.
Dans ce roman à la texture intense, Anne-Claire Decorvet tire plusieurs fils. Il y a d’abord l’enfance de Marguerite Sirvins, qui n’est pas malheureuse, même si elle est marquée par des événements traumatiques (mort d'un petit frère à peine né, mort d'une collègue après un avortement, ravage de la Grande Guerre). Car Marguerite est fille de bonne famille, éduquée, élégante, libérée (elle travaillera dans une boutique de mode à Paris). Mais déjà pèse sur elle l’ombre rigide de sa mère, incarnation d’un sur-moi écrasant. La voix de Marguerite, qui parle à la première personne au début du roman, va éclater, se diffracter en plusieurs voix intérieures, premier signe de schizophrénie. Mais ce qui causera le basculement dans la « folie », c’est une liaison avec un homme marié — passion qui habitera Marguerite toute sa vie. Et nourrira son éternel rêve d’amour, d’union charnelle, réalisé dans sa fameuse robe de mariée.
À 40 ans, Marguerite est internée à Saint-Alban. Elle n’en sortira plus jusqu’à sa mort, en 1957. Pendant des mois, Anne-Claire Decorvet a mené une enquête minutieuse, interrogeant les membres de la famille de Marguerite Sirvins, étudiant les archives de Saint-Alban, questionnant les médecins et le personnel de l’asile. Pour tenter de comprendre, de l’intérieur, la genèse de ce dérèglement. D’où vient la folie ? Est-ce une maladie de l’âme ou de la société Ne serait-ce pas plutôt les asiles qui produisent la folie, comme les prisons produisent les criminels ?
Ces questions, Anne-Claire Decorvet se les pose et nous les pose, bien sûr. Elle nous raconte aussi l’histoire de Saint-Alban, asile dirigé par des religieuses, qui accueillit longtemps les parias de la société, avant de donner refuge aux maquisards pendant la Seconde guerre mondiale, puis aux artistes résistants comme Paul Éluard, qui donne son titre au roman d’Anne-Claire Decorvet. Enfin, après la guerre, Saint-Alban va devenir une sorte de laboratoire pour les médecins proches de l’antipsychiatrie. Les conditions d’hygiène seront améliorées. Les malades jouiront de meilleurs soins et d’un peu de liberté.
Comment dire la folie ?
Le fou, c’est l’autre, celui qu’on ne comprend pas, ou celle qui se comporte bizarrement. À chacune des étapes de sa vie, Marguerite Sirvins sera diagnostiquée. Et à chaque fois, différemment, bien sûr. Non pas que sa « maladie » évolue ou empire : c’est le regard de l’autre, du médecin, du juge, qui change. Finalement, le diagnostic de schizophrénie va tomber, abrupt, définitif. C’est alors que le « je » disparaît du roman. Marguerite se perd dans le brouillard de ses identités. Elle ne sera plus évoquée qu’à la troisième personne.
« Un vide égaré quelque part entre le mur et le mur, celui de la salle de jour et celui de la cour. Un vide enfermé dans un lieu sans raison! Quelqu’un pourrait m’appeler Matricule, encore une fois ce serait pure convention. Quel que soit le mot dont on me désigne, il tombera forcément à côté, je ne m’y reconnaîtrai pas. Matricule vous déplaît ? Parlez de Marguerite ou de moi, d’elles ou de nous, pour ma part je ne dirai plus « je ». »
Ce roman d’une grande richesse et d’une profonde humanité relate une vie ordinaire qui bascule imperceptiblement dans la folie. D’où vient-elle, cette folie ? De la mère étouffante ? De l’amour déçu, puis rêvé pour un homme déjà pris ? De l’enfermement à Saint-Alban ? De la solitude ? Du silence ?
Anne-Claire Decorvet ne tranche pas. Elle donne, dans son roman, la parole à la folie. Une parole assumée tout d’abord par un « je » raisonnable, lucide, doué de personnalité. Puis cette identité s’effrite, gagnée par la déraison, qui prend possession des lieux. Sans raison. Il y a dans ce livre des pages bouleversantes sur la vie des aliénés (comme on dit), les traitements inhumains (électrochocs, camisole chimique, insulinothérapie), la naissance de l’Art brut avec Jean Dubuffet, l’évolution de la psychiatrie, etc.
 Tous ces fils se rejoignent, en fin d’ouvrage, pour tisser cette robe de rêve qui a occupé Marguerite Sirvins pendant les dernières années de sa vie. Cette robe de mariée, qu’elle ne portera jamais, est créée selon la technique du point de crochet, avec des aiguilles à coudre et du fil tiré des morceaux de draps usagés. Et cette robe de rêve, tissée des fils de la folie, est devenue un roman. Grâce à Anne-Claire Decorvet.
Tous ces fils se rejoignent, en fin d’ouvrage, pour tisser cette robe de rêve qui a occupé Marguerite Sirvins pendant les dernières années de sa vie. Cette robe de mariée, qu’elle ne portera jamais, est créée selon la technique du point de crochet, avec des aiguilles à coudre et du fil tiré des morceaux de draps usagés. Et cette robe de rêve, tissée des fils de la folie, est devenue un roman. Grâce à Anne-Claire Decorvet.
À qui je suis heureux de remettre, aujourd’hui, le Prix Édouard-Rod 2015.
* Anne-Claire Decorvet, Un lieu sans raison, éditions Bernard Campiche, 2015.
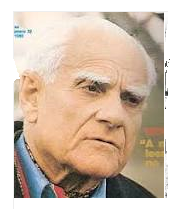 Du «Taedium vitae» des Anciens à la «nausée» de Sartre en passant par le «spleen» de Baudelaire, l’Ennui «métaphysique» n’a cessé d’inspirer toute une famille d’auteurs, de penseurs, de poètes, parmi lesquels on pourrait citer, sans être exhaustif, Huysmans, Mallarmé ou Flaubert. Ou encore, Sénèque, Pascal (songeons aux fragments sur le «Divertissement» en particulier) ou Chateaubriand.
Du «Taedium vitae» des Anciens à la «nausée» de Sartre en passant par le «spleen» de Baudelaire, l’Ennui «métaphysique» n’a cessé d’inspirer toute une famille d’auteurs, de penseurs, de poètes, parmi lesquels on pourrait citer, sans être exhaustif, Huysmans, Mallarmé ou Flaubert. Ou encore, Sénèque, Pascal (songeons aux fragments sur le «Divertissement» en particulier) ou Chateaubriand.

