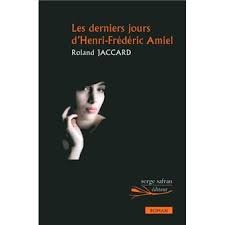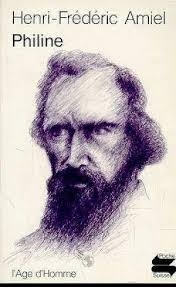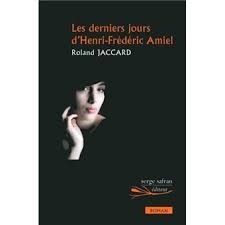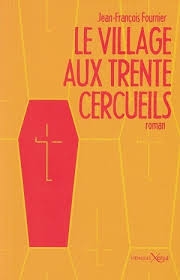Tout au bout de la nuit (Pierre Lepori)
par Jean-Michel Olivier
 Comme il navigue entre les langues (anglais, français, italien, allemand), Pierre Lepori voyage aussi entre les genres (théâtre, romans, poésie). Son quatrième roman, Nuit américaine* met en scène Alexandre, un animateur de radio (pensez à La Ligne du Cœur!), au bord du burn-out ou de la dépression. Chaque soir, il écoute sur les ondes des voix sans visage qui viennent parler de leur vie. Témoignages tantôt drôles, tantôt désespérés, tantôt absurdes ou tantôt pleins d'espoir. Des voix perdues dans la nuit (américaine) qu'il faut écouter et consoler. Pierre Lepori rend à merveille ces « témoignages » de la douleur humaine, du deuil ou du sentiment d'injustice. Il prête une voix juste et profonde à ces auditeurs sans visage.
Comme il navigue entre les langues (anglais, français, italien, allemand), Pierre Lepori voyage aussi entre les genres (théâtre, romans, poésie). Son quatrième roman, Nuit américaine* met en scène Alexandre, un animateur de radio (pensez à La Ligne du Cœur!), au bord du burn-out ou de la dépression. Chaque soir, il écoute sur les ondes des voix sans visage qui viennent parler de leur vie. Témoignages tantôt drôles, tantôt désespérés, tantôt absurdes ou tantôt pleins d'espoir. Des voix perdues dans la nuit (américaine) qu'il faut écouter et consoler. Pierre Lepori rend à merveille ces « témoignages » de la douleur humaine, du deuil ou du sentiment d'injustice. Il prête une voix juste et profonde à ces auditeurs sans visage.
 Mais Alexandre, après tant d'années d'écoute et de consolation, se sent dépossédé. Il n'est plus lui-même ou il n'est plus à sa place. D'ailleurs, son chef le sent et l'oblige à prendre un congé. Alexandre en profite pour traverser l'Atlantique et découvrir la nuit américaine. Dans une ville inconnue, où les voix de la nuit le poursuivent encore, il espère renaître. Poser la vieille peau. Retrouver ou réinventer un sens à sa vie.
Mais Alexandre, après tant d'années d'écoute et de consolation, se sent dépossédé. Il n'est plus lui-même ou il n'est plus à sa place. D'ailleurs, son chef le sent et l'oblige à prendre un congé. Alexandre en profite pour traverser l'Atlantique et découvrir la nuit américaine. Dans une ville inconnue, où les voix de la nuit le poursuivent encore, il espère renaître. Poser la vieille peau. Retrouver ou réinventer un sens à sa vie.
Là encore, le style de Lepori, à la fois subtil et précis, d'une grande poésie, restitue bien cette dérive qui pourrait être fatale. Car un jour, par hasard, Alexandre croise Pamela — une rencontre improbable et pourtant essentielle qui va lui redonner le goût de vivre. Je n'en dirai pas plus, tant le roman de Lepori tient le lecteur en haleine et lui réserve d'autres surprises…
Roman polyphonique, alternant confessions et récit, le tout scandé par des morceaux de musique (il vaut la peine d'écouter la bande-son du livre), Nuit américaine est un livre sur la dépossession : Alexandre, hanté par les voix de la nuit, est écarté de son émission, avant de perdre celle qui va l'aider à se reconstruire. Double dépossession, donc, que Pierre Lepori restitue et creuse parfaitement dans son roman à la mélancolie allègre.
* Pierre Lepori, Nuit américaine, roman (traduit de l'italien par l'auteur), éditions d'En-Bas, 2018.