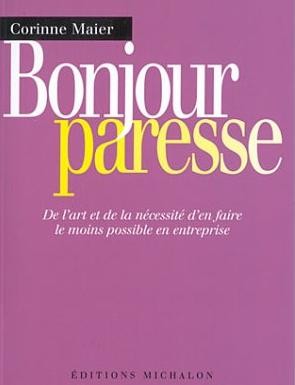Par Pierre Béguin
«J’ai écrit tant que je ne connaissais pas la vie; maintenant que j’en ai compris le sens, je n’ai plus rien à écrire»
dit Oscar Wilde. Et, de fait, il consacra les deux dernières années de sa vie à la paresse, à la contemplation, à l’inaction… et à l’absinthe. De l’écriture à la vie donc…
Dans Bartleby et compagnie, Vila-Matas fait référence à Marcel Schwob, – conteur, essayiste, grand connaisseur et traducteur de la littérature anglaise (Shakespeare notamment), qui publia les premiers textes de Jarry – et à ses fameuses Vies imaginaires, création borgésienne avant la lettre, où l’érudition se mêle à la fiction pour composer un artifice esthétique achevé qui rivalise avec le réel. Parmi ces vies imaginaires, celle de Pétrone – un Pétrone fictif bien entendu, peu conforme à celui que nous décrit les livres d’histoire – qui, après avoir écrit seize récits inspirés de ses incursions dans les bas fonds de la cité, décide de vivre les histoires qu’il a inventées. En compagnie d’un esclave, Cyrus, déguisés, ils «quittèrent la cité et s’en furent par les chemins vivre les aventures inventées par Pétrone, qui renonça pour toujours à écrire à partir du moment même où il commença à vivre la vie qu’il avait imaginée». Oser vivre ce qu’on a écrit et, pour cela, cesser d’écrire. L’itinéraire est original…
![chamfort[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/02/01/1867198495.jpg) Il en est de plus tragique qui mène de l’écriture au silence. Celui de Chamfort, par exemple, littérateur et académicien (certains voyaient en lui un successeur possible de Voltaire). Malgré un soutien financier, idéologique et littéraire absolu à la Révolution (il donne tout son argent à la cause et compose les vingt-six premiers Tableaux historiques de la Révolution française), il est dénoncé au Comité de sûreté générale par son subalterne au Cabinet des Estampes et incarcéré aux «Madelonnettes». Libéré, puis reconduit dans une maison d’arrêt, lui qui ne veut en aucun cas «satisfaire aux besoins de la nature en commun avec trente personnes» se rend dans son cabinet sous prétexte de se préparer, et se tire une balle dans la tête. La balle dévie, lui crève l’œil droit et lui brise le nez. Etonné de vivre encore, il se taillade férocement la gorge, le torse, les bras et les jambes à coups de rasoir et de couteau avant de s’effondrer en hurlant dans son sang… toujours vivant. Il succombe cinq mois plus tard dans d’atroces douleurs, laissant derrière lui des cartons entiers de petits carrés de papiers dont la plupart disparaîtront. Ceux qui ont pu être sauvés constituent les Produits de la civilisation perfectionnée, mieux connus sous le titre de Maximes et pensées, caractères et anecdotes, plus cyniques et presqu’aussi célèbres que les Maximes de La Rochefoucauld. Sur un de ces petits cartons, il s’était posé à lui-même cette question: «Pourquoi ne publiez-vous pas?» Voici les réponses que Vila-Matas a sélectionnées (je précise que je n’en ai trouvé nulle trace dans mon édition): «Parce que le public me paraît porté au comble du mauvais goût et au souci de dénigrer. Parce que nous nous exhortons à la tâche de la même façon qu’en nous penchant à la fenêtre nous espérons voir passer dans la rue singes et montreurs d’ours. Parce que j’ai peur de mourir sans avoir vécu. Parce que plus ma réputation littéraire s’évanouit, plus je suis heureux. Parce que je ne voudrais pas faire comme les gens de lettres, qui ressemblent à des ânes lorsqu’ils ruent et se battent devant leur mangeoire vide. Parce que le public ne s’intéresse qu’aux succès qu’il est capable d’apprécier». Personnellement, j’ajouterais à cette liste les deux pensées suivantes: «Un homme de lettres menait de front un poème et une affaire d’où dépendait sa fortune. On lui demandait comment allait son poème: "Demandez-moi plutôt, dit-il, comment va mon affaire (…) Avant d’être immortel, je veux savoir si je vivrai"», et «Le fameux Ben Johnson disait que tous ceux qui avaient pris les muses pour femmes étaient morts de faim, et que ceux qui les avaient prises pour maîtresses s’en étaient fort bien trouvés.» Quelque cent vingt ans plus tard, Jacques Vaché, compagnon de la première heure des surréalistes, concrétise de manière plus directe encore cet itinéraire de l’écriture au silence: «L’Art est une sottise» clamait-il avant d’absorber une trop forte dose d’opium.
Il en est de plus tragique qui mène de l’écriture au silence. Celui de Chamfort, par exemple, littérateur et académicien (certains voyaient en lui un successeur possible de Voltaire). Malgré un soutien financier, idéologique et littéraire absolu à la Révolution (il donne tout son argent à la cause et compose les vingt-six premiers Tableaux historiques de la Révolution française), il est dénoncé au Comité de sûreté générale par son subalterne au Cabinet des Estampes et incarcéré aux «Madelonnettes». Libéré, puis reconduit dans une maison d’arrêt, lui qui ne veut en aucun cas «satisfaire aux besoins de la nature en commun avec trente personnes» se rend dans son cabinet sous prétexte de se préparer, et se tire une balle dans la tête. La balle dévie, lui crève l’œil droit et lui brise le nez. Etonné de vivre encore, il se taillade férocement la gorge, le torse, les bras et les jambes à coups de rasoir et de couteau avant de s’effondrer en hurlant dans son sang… toujours vivant. Il succombe cinq mois plus tard dans d’atroces douleurs, laissant derrière lui des cartons entiers de petits carrés de papiers dont la plupart disparaîtront. Ceux qui ont pu être sauvés constituent les Produits de la civilisation perfectionnée, mieux connus sous le titre de Maximes et pensées, caractères et anecdotes, plus cyniques et presqu’aussi célèbres que les Maximes de La Rochefoucauld. Sur un de ces petits cartons, il s’était posé à lui-même cette question: «Pourquoi ne publiez-vous pas?» Voici les réponses que Vila-Matas a sélectionnées (je précise que je n’en ai trouvé nulle trace dans mon édition): «Parce que le public me paraît porté au comble du mauvais goût et au souci de dénigrer. Parce que nous nous exhortons à la tâche de la même façon qu’en nous penchant à la fenêtre nous espérons voir passer dans la rue singes et montreurs d’ours. Parce que j’ai peur de mourir sans avoir vécu. Parce que plus ma réputation littéraire s’évanouit, plus je suis heureux. Parce que je ne voudrais pas faire comme les gens de lettres, qui ressemblent à des ânes lorsqu’ils ruent et se battent devant leur mangeoire vide. Parce que le public ne s’intéresse qu’aux succès qu’il est capable d’apprécier». Personnellement, j’ajouterais à cette liste les deux pensées suivantes: «Un homme de lettres menait de front un poème et une affaire d’où dépendait sa fortune. On lui demandait comment allait son poème: "Demandez-moi plutôt, dit-il, comment va mon affaire (…) Avant d’être immortel, je veux savoir si je vivrai"», et «Le fameux Ben Johnson disait que tous ceux qui avaient pris les muses pour femmes étaient morts de faim, et que ceux qui les avaient prises pour maîtresses s’en étaient fort bien trouvés.» Quelque cent vingt ans plus tard, Jacques Vaché, compagnon de la première heure des surréalistes, concrétise de manière plus directe encore cet itinéraire de l’écriture au silence: «L’Art est une sottise» clamait-il avant d’absorber une trop forte dose d’opium.
Cette tentation du silence est forte et lancinante chez certains écrivains. On en trouve des signes même chez les plus prolixes. Comme dans ce passage de Les Indes noires de Jules Verne où l’on voit la jeune fille Nell, trouvée agonisante au fond d’une mine de charbon où elle était séquestrée depuis sa petite enfance, découvrir la magie de l’astre lunaire pour la première fois. Comme si son enthousiasme avait besoin de mots pour prendre forme et exister, les deux personnages masculins qui l’accompagnent se croient obliger de lui décrire ce qu’elle voit parfaitement par elle-même. L’un dans un langage exagérément lyrique et surchargé de métaphores – parodie des envolées lyrico romantiques lamartiniennes – l’autre dans un langage scientifique aussi condescendant que pédant, visant à expliquer la mécanique céleste – parodie du discours positiviste à la Homais. A la fin, Nell, qui les écoute à peine, perdue dans sa contemplation, s’exclame en s’agenouillant: «Mon Dieu! Que votre monde est beau!», comme pour signifier que la beauté est dans la chose elle-même, et non pas dans les mots qui servent à la décrire. Une manière de renvoyer la poésie (et la science) au silence. Et de lui préférer la vie, tout simplement. «Assez de mots, assez de phrases! ô vie réelle / Sans art et sans métaphores, sois à moi» écrivait Valery Larbaud contre Mallarmé, avant qu’une attaque d’hémiplégie ne le contraignît au fauteuil roulant et au silence pour ses vingt dernières années.
L’écriture ou la vie. L’écriture et la vie. La vie et l’écriture… Ce que j’ignorais encore à 25 ans en observant le ferry flanqué de l’inscription Manhattan Transfer traverser l’estuaire de l’Hudson, c’est qu’on ne choisit pas. Dans un sens ou dans un autre, agraphique, dilettante ou graphomane, besogneux, talentueux ou génial, on ne peut pas faire autrement. Tout simplement. Parmi les nombreuses explications déjà avancées pour justifier cette injonction intérieure (j’écris parce que…), celle de Jean Genêt me semble particulièrement judicieuse: «Je hasarde une explication: écrire, c’est le dernier recours quand on a trahi». L’écriture érigée au rang de réparation. Réparation rendue nécessaire par le sentiment coupable que peut éprouver l’écrivain, consciemment ou non, d’avoir abandonné sa classe sociale. Car écrire, c’est, d’une manière ou d’une autre, trahir son milieu, ses origines, ses parents. Écrivain, le grand bourgeois devient saltimbanque, l’enfant d’ouvrier un "Monsieur cultivé": «Je sens souvent la sourde inquiétude d’une sorte de trahison. Il y a si loin du monde où je suis né au monde où je vis désormais» écrit Jean Guéhenno dans Changer la vie (1961). Une problématique que l’écrivain transforme en matériau littéraire. D’où probablement ce thème récurrent de la mobilité sociale dont l’univers romanesque porte souvent la trace, quand il n’en est pas l’expression même. Jusqu’à envahir parfois tout l’espace fictionnel de manière obsessionnelle, comme dans l’œuvre d’Annie Ernaux: «Je suis certaine d’écrire depuis une déchirure entre deux mondes» déclare-t-elle dans une étude qui lui est consacrée (Annie Ernaux, une œuvre de l’entre-deux). L’écrivain se pardonnerait-il cette trahison que les autres, souvent, ne la lui pardonnent pas.
L’écriture ou la vie? Et si, finalement, tout était affaire de culpabilité?
 « Un petit roi, un papa vite effacé, une mère lascive. Œdipe hante toujours la littérature. Constamment remise au goût du jour, sa figure a subi des liftings. Dans L'Amour fantôme, Jean-Michel Olivier réussit où tant d'autres ont échoué. Sans paraphraser le mythe. Avec de jolis coups de scalpel.
« Un petit roi, un papa vite effacé, une mère lascive. Œdipe hante toujours la littérature. Constamment remise au goût du jour, sa figure a subi des liftings. Dans L'Amour fantôme, Jean-Michel Olivier réussit où tant d'autres ont échoué. Sans paraphraser le mythe. Avec de jolis coups de scalpel.
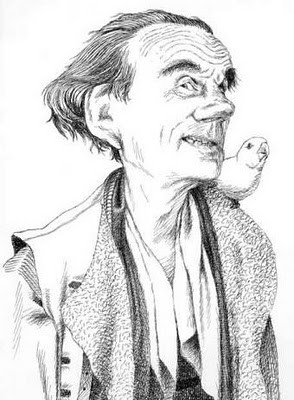
![london[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/01/02/3505650211.jpg) Le soir du 21 novembre 1916, dans sa luxueuse demeure californienne, couvert de plus de gloire et d’argent que n’importe quel autre écrivain de son temps, Jack London décide, pour hâter sa fin, d’avaler plusieurs doses de drogues mortelles. Il a quarante ans. Ainsi le prétendent du moins ceux qui soutiennent la thèse du suicide…
Le soir du 21 novembre 1916, dans sa luxueuse demeure californienne, couvert de plus de gloire et d’argent que n’importe quel autre écrivain de son temps, Jack London décide, pour hâter sa fin, d’avaler plusieurs doses de drogues mortelles. Il a quarante ans. Ainsi le prétendent du moins ceux qui soutiennent la thèse du suicide… Grisélidis Réal,
Grisélidis Réal, 

![chamfort[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/02/01/1867198495.jpg) Il en est de plus tragique qui mène de l’écriture au silence. Celui de Chamfort, par exemple, littérateur et académicien (certains voyaient en lui un successeur possible de Voltaire). Malgré un soutien financier, idéologique et littéraire absolu à la Révolution (il donne tout son argent à la cause et compose les vingt-six premiers Tableaux historiques de la Révolution française), il est dénoncé au Comité de sûreté générale par son subalterne au Cabinet des Estampes et incarcéré aux «Madelonnettes». Libéré, puis reconduit dans une maison d’arrêt, lui qui ne veut en aucun cas «satisfaire aux besoins de la nature en commun avec trente personnes» se rend dans son cabinet sous prétexte de se préparer, et se tire une balle dans la tête. La balle dévie, lui crève l’œil droit et lui brise le nez. Etonné de vivre encore, il se taillade férocement la gorge, le torse, les bras et les jambes à coups de rasoir et de couteau avant de s’effondrer en hurlant dans son sang… toujours vivant. Il succombe cinq mois plus tard dans d’atroces douleurs, laissant derrière lui des cartons entiers de petits carrés de papiers dont la plupart disparaîtront. Ceux qui ont pu être sauvés constituent les Produits de la civilisation perfectionnée, mieux connus sous le titre de Maximes et pensées, caractères et anecdotes, plus cyniques et presqu’aussi célèbres que les Maximes de La Rochefoucauld. Sur un de ces petits cartons, il s’était posé à lui-même cette question: «Pourquoi ne publiez-vous pas?» Voici les réponses que Vila-Matas a sélectionnées (je précise que je n’en ai trouvé nulle trace dans mon édition): «Parce que le public me paraît porté au comble du mauvais goût et au souci de dénigrer. Parce que nous nous exhortons à la tâche de la même façon qu’en nous penchant à la fenêtre nous espérons voir passer dans la rue singes et montreurs d’ours. Parce que j’ai peur de mourir sans avoir vécu. Parce que plus ma réputation littéraire s’évanouit, plus je suis heureux. Parce que je ne voudrais pas faire comme les gens de lettres, qui ressemblent à des ânes lorsqu’ils ruent et se battent devant leur mangeoire vide. Parce que le public ne s’intéresse qu’aux succès qu’il est capable d’apprécier». Personnellement, j’ajouterais à cette liste les deux pensées suivantes: «Un homme de lettres menait de front un poème et une affaire d’où dépendait sa fortune. On lui demandait comment allait son poème: "Demandez-moi plutôt, dit-il, comment va mon affaire (…) Avant d’être immortel, je veux savoir si je vivrai"», et «Le fameux Ben Johnson disait que tous ceux qui avaient pris les muses pour femmes étaient morts de faim, et que ceux qui les avaient prises pour maîtresses s’en étaient fort bien trouvés.» Quelque cent vingt ans plus tard, Jacques Vaché, compagnon de la première heure des surréalistes, concrétise de manière plus directe encore cet itinéraire de l’écriture au silence: «L’Art est une sottise» clamait-il avant d’absorber une trop forte dose d’opium.
Il en est de plus tragique qui mène de l’écriture au silence. Celui de Chamfort, par exemple, littérateur et académicien (certains voyaient en lui un successeur possible de Voltaire). Malgré un soutien financier, idéologique et littéraire absolu à la Révolution (il donne tout son argent à la cause et compose les vingt-six premiers Tableaux historiques de la Révolution française), il est dénoncé au Comité de sûreté générale par son subalterne au Cabinet des Estampes et incarcéré aux «Madelonnettes». Libéré, puis reconduit dans une maison d’arrêt, lui qui ne veut en aucun cas «satisfaire aux besoins de la nature en commun avec trente personnes» se rend dans son cabinet sous prétexte de se préparer, et se tire une balle dans la tête. La balle dévie, lui crève l’œil droit et lui brise le nez. Etonné de vivre encore, il se taillade férocement la gorge, le torse, les bras et les jambes à coups de rasoir et de couteau avant de s’effondrer en hurlant dans son sang… toujours vivant. Il succombe cinq mois plus tard dans d’atroces douleurs, laissant derrière lui des cartons entiers de petits carrés de papiers dont la plupart disparaîtront. Ceux qui ont pu être sauvés constituent les Produits de la civilisation perfectionnée, mieux connus sous le titre de Maximes et pensées, caractères et anecdotes, plus cyniques et presqu’aussi célèbres que les Maximes de La Rochefoucauld. Sur un de ces petits cartons, il s’était posé à lui-même cette question: «Pourquoi ne publiez-vous pas?» Voici les réponses que Vila-Matas a sélectionnées (je précise que je n’en ai trouvé nulle trace dans mon édition): «Parce que le public me paraît porté au comble du mauvais goût et au souci de dénigrer. Parce que nous nous exhortons à la tâche de la même façon qu’en nous penchant à la fenêtre nous espérons voir passer dans la rue singes et montreurs d’ours. Parce que j’ai peur de mourir sans avoir vécu. Parce que plus ma réputation littéraire s’évanouit, plus je suis heureux. Parce que je ne voudrais pas faire comme les gens de lettres, qui ressemblent à des ânes lorsqu’ils ruent et se battent devant leur mangeoire vide. Parce que le public ne s’intéresse qu’aux succès qu’il est capable d’apprécier». Personnellement, j’ajouterais à cette liste les deux pensées suivantes: «Un homme de lettres menait de front un poème et une affaire d’où dépendait sa fortune. On lui demandait comment allait son poème: "Demandez-moi plutôt, dit-il, comment va mon affaire (…) Avant d’être immortel, je veux savoir si je vivrai"», et «Le fameux Ben Johnson disait que tous ceux qui avaient pris les muses pour femmes étaient morts de faim, et que ceux qui les avaient prises pour maîtresses s’en étaient fort bien trouvés.» Quelque cent vingt ans plus tard, Jacques Vaché, compagnon de la première heure des surréalistes, concrétise de manière plus directe encore cet itinéraire de l’écriture au silence: «L’Art est une sottise» clamait-il avant d’absorber une trop forte dose d’opium.