Fiant Luces neve iam extinguantur
Par Pierre Béguin
«L’homme est resté seul comme créateur de sa propre histoire et de sa propre civilisation; seul comme celui qui décide de ce qui est bon et de ce qui est mauvais (…) Si l’homme peut décider par lui-même, sans Dieu, de ce qui est bon ou mauvais, il peut aussi disposer qu’un groupe d’homme soit anéanti.» Celui qui écrit ces mots n’y va pas par quatre chemins. Il proclame la supériorité des lois divines, leur préséance sur la sphère privée, et rend responsable des pires catastrophes le renoncement de l’homme à désirer le salut pour prix de la recherche de son propre bonheur. Cette solitude de l’homme sans Dieu le conduit aux pires comportements: «qu’un groupe d’hommes soit anéanti». Ce sont les purges, les génocides, Auschwitz. Ainsi donc Les Lumières – car c’est bien des Lumières qu’il s’agit dans l’allusion de la première phrase – seraient à l’origine non seulement du matérialisme des sociétés libérales mais aussi des idéologies du mal, les totalitarismes, le nazisme, le communisme. Le théocrate contempteur des Lumières qui tient ce discours anti-laïc n’est pas un extrémiste virulent justifiant son combat, c’est le Pape Jean-Paul II, bien plus modéré que son successeur, qui rédige son dernier livre Mémoire et identité quelque temps avant sa mort. Preuve que la hiérarchie de l’Eglise catholique n’a pas tout à fait renoncé à sortir le religieux de la sphère privée où le principe de laïcité, issu des Lumières, l’a confiné. Et même si sa position reste bien plus modérée, moins tragique et moins dangereuse que celle d’extrémistes d’autres religions, elle souligne tout de même la volonté des théocrates de ne pas rendre toutes les armes.
Deux siècles et demi plus tôt, Voltaire, dans le Dictionnaire philosophique faisait «l’histoire du fanatisme et ses exploits»: quinze siècles d’horreur, peuples égorgés, rois poignardés «tyrans, bourreaux, parricides et sacrilèges violant toutes les conventions divines et humaines par esprit de religion». S’il apparente le fanatisme (terme inventé par Bossuet au XVIIe siècle) à «une peste des âmes» qui contamine faibles et ignorants, à «une maladie épidermique» de la religion presque incurable, à part peut-être par l’esprit philosophique qui «prévient les accès du mal», il admet que la raison et les lois se révèlent impuissantes face à des «enthousiasmes» délirants qui se persuadent d’être guidés par L’Esprit saint: «Que répondre à un homme qui vous dit qu’il aime mieux obéir à Dieu qu’aux hommes, et qui, en conséquence, est sûr de mériter le Ciel en vous égorgeant?» demande-t-il.
Donc, pour les laïcs, les pires atrocités surviennent lorsqu’on place Dieu au centre de la sphère publique; pour les théocrates, les pires atrocités surviennent lorsqu’on exclut Dieu de la sphère publique. Et le pire, c’est que l’Histoire ne donne vraiment raison ni aux uns ni aux autres. Bien sûr, la laïcité s’est profondément enracinée dans nos mentalités et dans nos systèmes politiques occidentaux, au point que nous sommes tous convaincus – moi le premier – que la nouvelle virulence dont font preuve les théocrates de tout poil au tournant des XXe et XXIe siècle est la pire des gangrènes. Voilà pourquoi le problème des minarets ne se réduit pas à savoir s’ils vont concurrencer nos montagnes ou déparer nos vertes prairies. Et s’il ne fait aucun doute que l’Etat de droit, démocratique et républicain, doit leur accorder leur place à côté de nos clochers – il en va du respect de son esprit même – nous devons nous souvenir que les Lumières de la raison ont triomphé du pouvoir clérical non pas seulement par la plume des philosophes mais surtout au prix de beaucoup de sang versé. L’héritage est à prendre au sérieux et exige vigilance et fermeté. Comme le souligne Tzvetan Todorov, chantre des Lumières, dans son livre L’Esprit des Lumières: «Les maux combattus par cet esprit se sont avérés plus résistants que ne l’imaginaient les hommes du XVIIIe siècle; ces maux se sont même multipliés depuis. Les adversaires traditionnels des Lumières, obscurantisme, autorité arbitraire, fanatisme, sont comme les hydres qui repoussent après avoir été coupées, car ils puisent leur force dans des caractéristiques des hommes et de leurs sociétés tout aussi indéracinables que le désir d’autonomie et de dialogue (...) On peut donc craindre que ces attaques ne cessent jamais» Or, justement, le besoin de religion est indéracinable et il ne s’exprime pas toujours dans la tolérance… Veillons donc à préserver rigoureusement le principe de laïcité! A commencer par son application stricte dans nos écoles. Et surtout ne focalisons pas sur de faux problèmes et sur une cible unique – les extrémistes musulmans. On en viendrait à oublier d’autres dangers. Ainsi, les chrétiens fondamentalistes – les créationnistes – continuent sans polémique leur croisade anti-darwinienne par de nombreuses conférences, notamment à Genève et Lausanne. Ils ont déjà imposé leur enseignement dans de multiples universités américaines, ils s’implantent en Allemagne et profitent allégrement de la privatisation de l’enseignement pour se payer des chaires académiques un peu partout. Dans la plus complète indifférence… Et, si l'on en croit le journal Le Temps, dans les colonies de Cisjordanie se développe un fondamentalisme juif emmené par une soixantaine de rabbins dont Itzhak Ginsburg, un rabbin persuadé qu’il existerait un «ADN juif» supérieur à celui des non-juifs. Tiens, ça me rappelle quelque chose! Pas vous? Je me demande ce qu’en aurait pensé Jean-Paul II…
Que les Lumières soient et qu’elles ne s’éteignent plus!

![huysmans[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/01/01/1168405732.jpg) riture. Fugace. Météorite. Heureusement! Elle n’était pas de moi, cette idée. J’aurais eu l’air de quoi?
riture. Fugace. Météorite. Heureusement! Elle n’était pas de moi, cette idée. J’aurais eu l’air de quoi?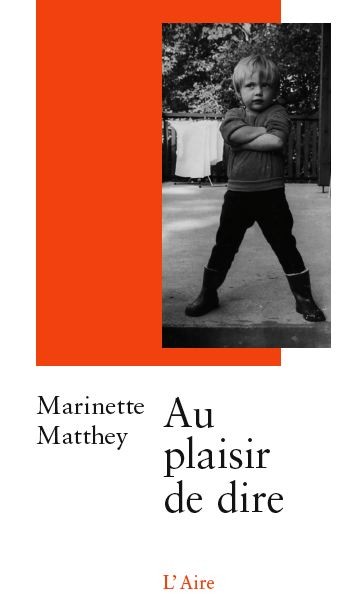
 Une de mes amies enseigne dans un cycle d’orientation genevois. Elle m’a raconté une histoire déconcertante. Elle venait de faire entrer ses élèves dans la classe lorsqu’une inconnue, échevelée, se présenta sur le seuil hurlant comme une démente: Elliot! Elliot! Voulant donner son cours, la prof intima l’ordre à l’échevelée de quitter les lieux et de rejoindre son groupe. La fâcheuse refusant d’obéir, la prof lui saisit fermement le bras pour l’éloigner.
Une de mes amies enseigne dans un cycle d’orientation genevois. Elle m’a raconté une histoire déconcertante. Elle venait de faire entrer ses élèves dans la classe lorsqu’une inconnue, échevelée, se présenta sur le seuil hurlant comme une démente: Elliot! Elliot! Voulant donner son cours, la prof intima l’ordre à l’échevelée de quitter les lieux et de rejoindre son groupe. La fâcheuse refusant d’obéir, la prof lui saisit fermement le bras pour l’éloigner.![Michea_article[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/00/02/2253260851.jpg)
 Je me suis donc rendu à cette exposition de photos, un must, qu’il paraissait. Foule au loft « attitudes », rue du Beulet. Petit tour de piste, les photos sont peu convaincantes mais le buffet oui. Plein de têtes connues. L’une d’elles s’approche :
Je me suis donc rendu à cette exposition de photos, un must, qu’il paraissait. Foule au loft « attitudes », rue du Beulet. Petit tour de piste, les photos sont peu convaincantes mais le buffet oui. Plein de têtes connues. L’une d’elles s’approche :![immobilier[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/00/01/4234355902.jpg)
![capitalisme[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/00/01/2655514413.jpg)
![Quête[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/01/00/2759578949.jpg)