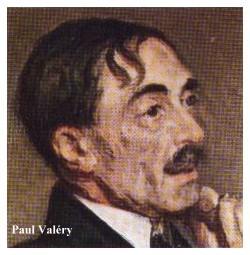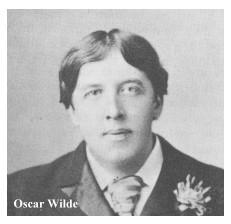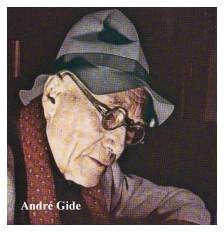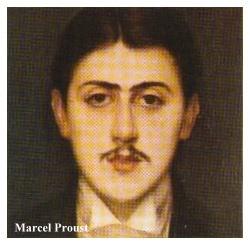Du bon usage des noms
par Pascal Rebetez
Il nous avait été dit autrefois qu’à chaque objet correspondait un nom qui le désignait précisément et lui donnait vie. Il nous avait été dit autrefois que chaque individu possédait un prénom qui, accolé à son patronyme voire à son lieu de naissance, lui conférait un statut d’autonomie et de reconnaissance dans le maelström des définitions individuelles.
J’ai pris une fois un taxi à Bienne dont le chauffeur avait le même nom que moi.
Selon lui, il avait reçu à ma place un certain nombre de courriers indésirables, dont quelques lettres de menaces… Borges tendait l’oreille quand je m’acquittai de ma course.
J’ai un ami gastronome qui a le nom d’un champion olympique et qui me dit que, rien qu’à Genève, ils sont six à porter la même identité. Imaginez les confusions !
Si je frappe par exemple Paul Simon ou Jacques Martin dans l’annuaire électronique suisse, je trouve 86 occurrences. En tapant Christoph Blocher, je ne trouve aucune adresse, alors qu’il y a 49 numéros sous ce même patronyme. Pas davantage de succès avec Pascal Couchepin. Plus les gens sont connus, semble-t-il, moins ils sont inscrits dans la masse. Sous Paris, je ne trouve aucun Marcel Proust, encore moins d’Emile Zola ou de Victor Hugo. Mais les morts ne sont pas câblés, c’est bien connu.
Par tous les diables, je tape « Dieu » sur mon moteur de recherche électronique et j’en trouve 666, qui est le chiffre du grand Satan !
Où voulais-je en venir ? A oui, à cette affiche du Musée du St-Bernard à Martigny qui montre des objets des Inuits du Grand Nord. Ça s’intitule : « Nanouk, l’ours polaire ». Nanouk, un ours ? Il nous avait été dit autrefois que Nanouk était un Inuit, un homme, un chasseur, un pêcheur menacé par la civilisation. En 1922, Nanouk et sa famille étaient filmés par Robert Flaherty. J’ai vu ce docu-fiction il y a peu et c’est splendide. Ce beau prénom d’homme fier est désormais devenu le prénom d’un ours, d’une peluche, d’un reste à consommer au chaud d’une expo durant nos loisirs.
Et puis quoi, me dira-t-on ? Il y a longtemps que nos molosses se nomment Brutus ou César, que nos vaches acquiescent en hochant leurs tétines quand on les appelle Marguerite ou Pamela. Il paraît même que certains jeunes désormais élèvent des rats ou même des blattes. Je m’opposerai toujours avec vigueur à ce qu’ils leur donnent mon nom, dussé-je perdre un peu de ma renommée ! Déjà que certains petits écrivaillons anonymes usent de mon identité sacrée pour signer des textes sans nom !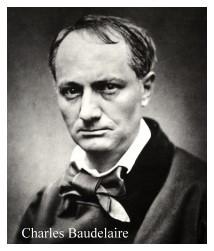

%25202.jpg)