Par Pierre Béguin
Vivre d’abord, écrire ensuite donc. Car écrire vieux – pensais-je – devrait faciliter l’accès à la mort au moins autant qu’écrire jeune empêche l’accès à la vie. C’est ce que je décidai à 25 ans en observant, à New York, le ferry frappé sur son flanc des caractères exorbitants Manhattan Transfer traverser l’estuaire de l’Hudson. Un peu comme Monsieur-Tout-Le-Monde tendance bobo décide qu’il se mettra au golf lorsque l’âge et les limites de son corps lui interdiront toute autre activité sportive. Ou, plus flatteur, comme Joseph Conrad ou Hermann Melville, marins et aventuriers avant d’être écrivains…
![EnriqueVila[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/00/00/20961927.jpg) C’est précisément un personnage d’Hermann Melville, le scribe Bartleby (Bartleby the scrivener), l’anti aventurier par excellence, qui sert de symbole et de fil conducteur à l’excellent livre d’Enrique Vila-Matas Bartleby et compagnie, dont mon compère Alain Bagnoud a fait un compte-rendu dans blogres en mars dernier (ici). L’écrivain catalan dresse une liste aussi impressionnante que (presque) exhaustive des auteurs qui, après une entrée discrète ou fracassante dans le monde littéraire, ont renoncé à jamais à l’écriture pour diverses bonnes raisons ou prétextes fallacieux. Ecrire d’abord, vivre ensuite donc. Les trois exemples les plus représentatifs – parce que les plus radicaux – sont ceux de l’Américain Jerome David Salinger – qui publia quatre livres éblouissants entre 1951 (le fameux Catcher in the Rye) et 1963 avant d’observer 36 ans de silence et d’anonymat aussi absolus qu’obsessionnels – le Mexicain Juan Rulfo et, bien entendu, Arthur Rimbaud. Au point que ces trois auteurs sont devenus plus célèbres encore par leur silence que par leurs écrits. Arrêtons-nous un instant sur les cas exemplaires de Rimbaud et, surtout, de Juan Rulfo.
C’est précisément un personnage d’Hermann Melville, le scribe Bartleby (Bartleby the scrivener), l’anti aventurier par excellence, qui sert de symbole et de fil conducteur à l’excellent livre d’Enrique Vila-Matas Bartleby et compagnie, dont mon compère Alain Bagnoud a fait un compte-rendu dans blogres en mars dernier (ici). L’écrivain catalan dresse une liste aussi impressionnante que (presque) exhaustive des auteurs qui, après une entrée discrète ou fracassante dans le monde littéraire, ont renoncé à jamais à l’écriture pour diverses bonnes raisons ou prétextes fallacieux. Ecrire d’abord, vivre ensuite donc. Les trois exemples les plus représentatifs – parce que les plus radicaux – sont ceux de l’Américain Jerome David Salinger – qui publia quatre livres éblouissants entre 1951 (le fameux Catcher in the Rye) et 1963 avant d’observer 36 ans de silence et d’anonymat aussi absolus qu’obsessionnels – le Mexicain Juan Rulfo et, bien entendu, Arthur Rimbaud. Au point que ces trois auteurs sont devenus plus célèbres encore par leur silence que par leurs écrits. Arrêtons-nous un instant sur les cas exemplaires de Rimbaud et, surtout, de Juan Rulfo.
Rimbaud tout d’abord pour préciser que j’ai toujours éprouvé (j’éprouve toujours) quelques difficultés à adhérer vraiment à son œuvre. Rien à faire! Là où certains encensent leur sainteté, certains vers me paraissent artificiels. Et je n’eusse sans doute pas osé cet aveu sans la caution de Julien Gracq qui, à l’occasion du centenaire de Rimbaud, s’était élevé vigoureusement contre la stupide mythification du silence du poète. Vila-Matas (son narrateur) surenchérit fort opportunément : «Il se trouve par ailleurs que je suis le premier à démythifier toute cette sainteté insensée que l’on a si souvent attribuée à Rimbaud. Je ne puis oublier que celui qui disait "fumer surtout, boire des liqueurs fortes comme du métal bouillant" (une bien belle prise de position poétique) était ce même être mesquin qui, depuis l’Ethiopie, assurait : "Je ne bois que de l’eau, quinze francs par mois, tout est très cher. Je ne fume jamais."» Une précision qui exprime parfaitement ce sentiment d’artificialité que je ressens parfois à la lecture de Rimbaud. C’est peut-être ce qui arrive lorsqu’on écrit, malgré le génie d’Arthur, avant d’avoir vécu. Et peut-être ce qu’il ressentit lui-même tant son entreprise poétique, avant de devenir «la prairie à l’oubli livrée», contient sa propre condamnation et les traces de son futur silence. Le voyage dans les mots ne mène à rien. L’important est ailleurs, aux antipodes de ce qu’il appelle «l’histoire d’une de [ses] folies» qui l’amène à «trouver sacré le désordre de [son] esprit». Ainsi, loin d’une sacralisation de son silence, l’itinéraire de Rimbaud souligne davantage la désacralisation de son œuvre, voire de toute alchimie du verbe: «Ma vie serait toujours trop immense pour être dévouée à la force et à la beauté». Le paradoxe de celui qui énonce son futur silence, c’est bien que, pour se taire, il lui faut parler.
![rulfo[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/00/00/5311086.jpg) Moins original, moins tragique, le silence de Rulfo est tout autant mythifié. Un silence de trente ans durant lequel il retourne simplement à ses travaux d’archives à l’Institut National Indigéniste tout en s’adonnant à la photographie. Deux fulgurances seulement au milieu d’une vie à la Bartleby: à 36 ans, en 1953, il publie un recueil de nouvelles, El Llano en llamas (Le Llano en flammes), puis, deux ans plus tard, son chef-d’œuvre Pedro Paramo. Ensuite quelques scénarios tirés de son œuvre pour le cinéma, réunis plus tard sous le titre El Gallo de oro (le coq d’or), un roman annoncé qu’il n’écrira jamais (La Cordillera), et le mutisme définitif malgré la célébrité. Je me suis souvent demandé si son succès immédiat et fracassant n’était pas plus surprenant encore que son silence inexpliqué. El Llano en llamas le place d’emblée à la tête des lettres mexicaines avant que Pedro Paramo, – «la plus haute expression jamais atteinte par le roman mexicain» est-il écrit au dos de mon édition espagnole –, ne consacre universellement sa notoriété. La diffusion de ce petit roman fut énorme, ses traductions multiples, son retentissement mondial. Et pourtant rien à mon sens – et surtout pas sa complexité et sa technique narrative révolutionnaire – ne le disposait au succès populaire. La structure éclatée, le désordre chronologique délibéré, la dislocation des séquences temporelles, la juxtaposition des anticipations et des analepses place le lecteur en danger permanent de se perdre dans un monde de fantasmes. Une situation inconfortable qui l’inciterait à abandonner très vite un récit dont il perd sans cesse le fil. Le texte se donne en fait comme une suite décousue de voix fantomatiques, sans identité (tous les personnages sont morts), par lesquelles le héros, Juan Preciado (et le lecteur avec lui), reconstitue l’histoire de son père Pedro Paramo, le cacique du village, dominateur et cruel, qui l’avait abandonné dans son enfance (Juan Rulfo est orphelin a huit ans). Davantage encore que les grandes références romanesques traitant du thème du caciquisme, comme Moi le Suprême de paraguayen Augusto Roa Bastos, de L’Etincelle (Gracias por el fuego) de l’uruguyen Mario Benedetti, de L’Automne du patriarche du colombien Garcia Marquez, tous pourtant de facture plus classique, Pedro Paramo incarne la référence absolue de tous les Citizen Kane latino-américains. L’énigme Juan Rulfo s’inscrit donc entre succès surprenant et mystérieux silence. Enrique Vila-Matas rappelle que, pour justifier son mutisme, Rulfo prétextait non seulement la mort de son oncle Celerino qui lui dictait ses histoires mais aussi les fumeurs de marihuana: «Aujourd’hui, disait-il, même les fumeurs de marihuana publient des livres. Vous ne trouvez pas qu’il sort plein de livres bizarres un peu partout? Eh bien moi j’ai préféré garder le silence». Plus loin, il évoque une fable de Monterroso, un ami de Rulfo, Le plus sage Renard, en guise d’explication: «Il y est question d’un Renard bien content d’avoir écrit deux livres à succès. Les années passent sans qu’il ne publie rien d’autre. Les gens commencent à chuchoter, à se demander ce qui se passe, et lorsqu’ils tombent sur lui dans les coktails, vont le voir pour lui dire qu’il devrait recommencer à publier. Mais j’en ai déjà publié deux, répond, lassé, le Renard. Justement, ils sont très bons, répondent-ils, et c’est pour ça que tu devrais en sortir un autre. Le Renard n’en dit rien, mais pense qu’en réalité ils espèrent le voir publier un mauvais livre. Mais, pas Renard pour rien, il s’en garde bien». Il faut parfois toute une œuvre pour qu’émerge enfin un chef-d’œuvre, souvent beaucoup de livres médiocres ou inutiles pour en faire un acceptable. Ceux qui ont le génie ou la chance d’atteindre immédiatement l’objectif auraient bien tort d’insister, autant pour eux que pour leurs lecteurs.
Moins original, moins tragique, le silence de Rulfo est tout autant mythifié. Un silence de trente ans durant lequel il retourne simplement à ses travaux d’archives à l’Institut National Indigéniste tout en s’adonnant à la photographie. Deux fulgurances seulement au milieu d’une vie à la Bartleby: à 36 ans, en 1953, il publie un recueil de nouvelles, El Llano en llamas (Le Llano en flammes), puis, deux ans plus tard, son chef-d’œuvre Pedro Paramo. Ensuite quelques scénarios tirés de son œuvre pour le cinéma, réunis plus tard sous le titre El Gallo de oro (le coq d’or), un roman annoncé qu’il n’écrira jamais (La Cordillera), et le mutisme définitif malgré la célébrité. Je me suis souvent demandé si son succès immédiat et fracassant n’était pas plus surprenant encore que son silence inexpliqué. El Llano en llamas le place d’emblée à la tête des lettres mexicaines avant que Pedro Paramo, – «la plus haute expression jamais atteinte par le roman mexicain» est-il écrit au dos de mon édition espagnole –, ne consacre universellement sa notoriété. La diffusion de ce petit roman fut énorme, ses traductions multiples, son retentissement mondial. Et pourtant rien à mon sens – et surtout pas sa complexité et sa technique narrative révolutionnaire – ne le disposait au succès populaire. La structure éclatée, le désordre chronologique délibéré, la dislocation des séquences temporelles, la juxtaposition des anticipations et des analepses place le lecteur en danger permanent de se perdre dans un monde de fantasmes. Une situation inconfortable qui l’inciterait à abandonner très vite un récit dont il perd sans cesse le fil. Le texte se donne en fait comme une suite décousue de voix fantomatiques, sans identité (tous les personnages sont morts), par lesquelles le héros, Juan Preciado (et le lecteur avec lui), reconstitue l’histoire de son père Pedro Paramo, le cacique du village, dominateur et cruel, qui l’avait abandonné dans son enfance (Juan Rulfo est orphelin a huit ans). Davantage encore que les grandes références romanesques traitant du thème du caciquisme, comme Moi le Suprême de paraguayen Augusto Roa Bastos, de L’Etincelle (Gracias por el fuego) de l’uruguyen Mario Benedetti, de L’Automne du patriarche du colombien Garcia Marquez, tous pourtant de facture plus classique, Pedro Paramo incarne la référence absolue de tous les Citizen Kane latino-américains. L’énigme Juan Rulfo s’inscrit donc entre succès surprenant et mystérieux silence. Enrique Vila-Matas rappelle que, pour justifier son mutisme, Rulfo prétextait non seulement la mort de son oncle Celerino qui lui dictait ses histoires mais aussi les fumeurs de marihuana: «Aujourd’hui, disait-il, même les fumeurs de marihuana publient des livres. Vous ne trouvez pas qu’il sort plein de livres bizarres un peu partout? Eh bien moi j’ai préféré garder le silence». Plus loin, il évoque une fable de Monterroso, un ami de Rulfo, Le plus sage Renard, en guise d’explication: «Il y est question d’un Renard bien content d’avoir écrit deux livres à succès. Les années passent sans qu’il ne publie rien d’autre. Les gens commencent à chuchoter, à se demander ce qui se passe, et lorsqu’ils tombent sur lui dans les coktails, vont le voir pour lui dire qu’il devrait recommencer à publier. Mais j’en ai déjà publié deux, répond, lassé, le Renard. Justement, ils sont très bons, répondent-ils, et c’est pour ça que tu devrais en sortir un autre. Le Renard n’en dit rien, mais pense qu’en réalité ils espèrent le voir publier un mauvais livre. Mais, pas Renard pour rien, il s’en garde bien». Il faut parfois toute une œuvre pour qu’émerge enfin un chef-d’œuvre, souvent beaucoup de livres médiocres ou inutiles pour en faire un acceptable. Ceux qui ont le génie ou la chance d’atteindre immédiatement l’objectif auraient bien tort d’insister, autant pour eux que pour leurs lecteurs.
Ecrire et vivre. Pour le génie, peut-être…
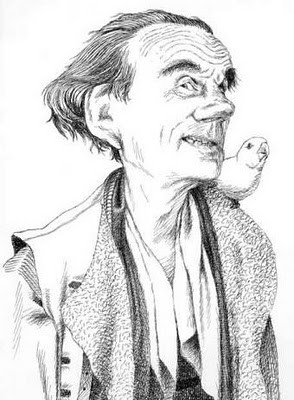
![london[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/01/02/3505650211.jpg) Le soir du 21 novembre 1916, dans sa luxueuse demeure californienne, couvert de plus de gloire et d’argent que n’importe quel autre écrivain de son temps, Jack London décide, pour hâter sa fin, d’avaler plusieurs doses de drogues mortelles. Il a quarante ans. Ainsi le prétendent du moins ceux qui soutiennent la thèse du suicide…
Le soir du 21 novembre 1916, dans sa luxueuse demeure californienne, couvert de plus de gloire et d’argent que n’importe quel autre écrivain de son temps, Jack London décide, pour hâter sa fin, d’avaler plusieurs doses de drogues mortelles. Il a quarante ans. Ainsi le prétendent du moins ceux qui soutiennent la thèse du suicide…![chamfort[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/02/01/1867198495.jpg) Il en est de plus tragique qui mène de l’écriture au silence. Celui de Chamfort, par exemple, littérateur et académicien (certains voyaient en lui un successeur possible de Voltaire). Malgré un soutien financier, idéologique et littéraire absolu à la Révolution (il donne tout son argent à la cause et compose les vingt-six premiers Tableaux historiques de la Révolution française), il est dénoncé au Comité de sûreté générale par son subalterne au Cabinet des Estampes et incarcéré aux «Madelonnettes». Libéré, puis reconduit dans une maison d’arrêt, lui qui ne veut en aucun cas «satisfaire aux besoins de la nature en commun avec trente personnes» se rend dans son cabinet sous prétexte de se préparer, et se tire une balle dans la tête. La balle dévie, lui crève l’œil droit et lui brise le nez. Etonné de vivre encore, il se taillade férocement la gorge, le torse, les bras et les jambes à coups de rasoir et de couteau avant de s’effondrer en hurlant dans son sang… toujours vivant. Il succombe cinq mois plus tard dans d’atroces douleurs, laissant derrière lui des cartons entiers de petits carrés de papiers dont la plupart disparaîtront. Ceux qui ont pu être sauvés constituent les Produits de la civilisation perfectionnée, mieux connus sous le titre de Maximes et pensées, caractères et anecdotes, plus cyniques et presqu’aussi célèbres que les Maximes de La Rochefoucauld. Sur un de ces petits cartons, il s’était posé à lui-même cette question: «Pourquoi ne publiez-vous pas?» Voici les réponses que Vila-Matas a sélectionnées (je précise que je n’en ai trouvé nulle trace dans mon édition): «Parce que le public me paraît porté au comble du mauvais goût et au souci de dénigrer. Parce que nous nous exhortons à la tâche de la même façon qu’en nous penchant à la fenêtre nous espérons voir passer dans la rue singes et montreurs d’ours. Parce que j’ai peur de mourir sans avoir vécu. Parce que plus ma réputation littéraire s’évanouit, plus je suis heureux. Parce que je ne voudrais pas faire comme les gens de lettres, qui ressemblent à des ânes lorsqu’ils ruent et se battent devant leur mangeoire vide. Parce que le public ne s’intéresse qu’aux succès qu’il est capable d’apprécier». Personnellement, j’ajouterais à cette liste les deux pensées suivantes: «Un homme de lettres menait de front un poème et une affaire d’où dépendait sa fortune. On lui demandait comment allait son poème: "Demandez-moi plutôt, dit-il, comment va mon affaire (…) Avant d’être immortel, je veux savoir si je vivrai"», et «Le fameux Ben Johnson disait que tous ceux qui avaient pris les muses pour femmes étaient morts de faim, et que ceux qui les avaient prises pour maîtresses s’en étaient fort bien trouvés.» Quelque cent vingt ans plus tard, Jacques Vaché, compagnon de la première heure des surréalistes, concrétise de manière plus directe encore cet itinéraire de l’écriture au silence: «L’Art est une sottise» clamait-il avant d’absorber une trop forte dose d’opium.
Il en est de plus tragique qui mène de l’écriture au silence. Celui de Chamfort, par exemple, littérateur et académicien (certains voyaient en lui un successeur possible de Voltaire). Malgré un soutien financier, idéologique et littéraire absolu à la Révolution (il donne tout son argent à la cause et compose les vingt-six premiers Tableaux historiques de la Révolution française), il est dénoncé au Comité de sûreté générale par son subalterne au Cabinet des Estampes et incarcéré aux «Madelonnettes». Libéré, puis reconduit dans une maison d’arrêt, lui qui ne veut en aucun cas «satisfaire aux besoins de la nature en commun avec trente personnes» se rend dans son cabinet sous prétexte de se préparer, et se tire une balle dans la tête. La balle dévie, lui crève l’œil droit et lui brise le nez. Etonné de vivre encore, il se taillade férocement la gorge, le torse, les bras et les jambes à coups de rasoir et de couteau avant de s’effondrer en hurlant dans son sang… toujours vivant. Il succombe cinq mois plus tard dans d’atroces douleurs, laissant derrière lui des cartons entiers de petits carrés de papiers dont la plupart disparaîtront. Ceux qui ont pu être sauvés constituent les Produits de la civilisation perfectionnée, mieux connus sous le titre de Maximes et pensées, caractères et anecdotes, plus cyniques et presqu’aussi célèbres que les Maximes de La Rochefoucauld. Sur un de ces petits cartons, il s’était posé à lui-même cette question: «Pourquoi ne publiez-vous pas?» Voici les réponses que Vila-Matas a sélectionnées (je précise que je n’en ai trouvé nulle trace dans mon édition): «Parce que le public me paraît porté au comble du mauvais goût et au souci de dénigrer. Parce que nous nous exhortons à la tâche de la même façon qu’en nous penchant à la fenêtre nous espérons voir passer dans la rue singes et montreurs d’ours. Parce que j’ai peur de mourir sans avoir vécu. Parce que plus ma réputation littéraire s’évanouit, plus je suis heureux. Parce que je ne voudrais pas faire comme les gens de lettres, qui ressemblent à des ânes lorsqu’ils ruent et se battent devant leur mangeoire vide. Parce que le public ne s’intéresse qu’aux succès qu’il est capable d’apprécier». Personnellement, j’ajouterais à cette liste les deux pensées suivantes: «Un homme de lettres menait de front un poème et une affaire d’où dépendait sa fortune. On lui demandait comment allait son poème: "Demandez-moi plutôt, dit-il, comment va mon affaire (…) Avant d’être immortel, je veux savoir si je vivrai"», et «Le fameux Ben Johnson disait que tous ceux qui avaient pris les muses pour femmes étaient morts de faim, et que ceux qui les avaient prises pour maîtresses s’en étaient fort bien trouvés.» Quelque cent vingt ans plus tard, Jacques Vaché, compagnon de la première heure des surréalistes, concrétise de manière plus directe encore cet itinéraire de l’écriture au silence: «L’Art est une sottise» clamait-il avant d’absorber une trop forte dose d’opium.![EnriqueVila[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/00/00/20961927.jpg) C’est précisément un personnage d’Hermann Melville, le scribe Bartleby (Bartleby the scrivener), l’anti aventurier par excellence, qui sert de symbole et de fil conducteur à l’excellent livre d’Enrique Vila-Matas Bartleby et compagnie, dont mon compère Alain Bagnoud a fait un compte-rendu dans blogres en mars dernier (
C’est précisément un personnage d’Hermann Melville, le scribe Bartleby (Bartleby the scrivener), l’anti aventurier par excellence, qui sert de symbole et de fil conducteur à l’excellent livre d’Enrique Vila-Matas Bartleby et compagnie, dont mon compère Alain Bagnoud a fait un compte-rendu dans blogres en mars dernier (![rulfo[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/00/00/5311086.jpg) Moins original, moins tragique, le silence de Rulfo est tout autant mythifié. Un silence de trente ans durant lequel il retourne simplement à ses travaux d’archives à l’Institut National Indigéniste tout en s’adonnant à la photographie. Deux fulgurances seulement au milieu d’une vie à la Bartleby: à 36 ans, en 1953, il publie un recueil de nouvelles, El Llano en llamas (Le Llano en flammes), puis, deux ans plus tard, son chef-d’œuvre Pedro Paramo. Ensuite quelques scénarios tirés de son œuvre pour le cinéma, réunis plus tard sous le titre El Gallo de oro (le coq d’or), un roman annoncé qu’il n’écrira jamais (La Cordillera), et le mutisme définitif malgré la célébrité. Je me suis souvent demandé si son succès immédiat et fracassant n’était pas plus surprenant encore que son silence inexpliqué. El Llano en llamas le place d’emblée à la tête des lettres mexicaines avant que Pedro Paramo, – «la plus haute expression jamais atteinte par le roman mexicain» est-il écrit au dos de mon édition espagnole –, ne consacre universellement sa notoriété. La diffusion de ce petit roman fut énorme, ses traductions multiples, son retentissement mondial. Et pourtant rien à mon sens – et surtout pas sa complexité et sa technique narrative révolutionnaire – ne le disposait au succès populaire. La structure éclatée, le désordre chronologique délibéré, la dislocation des séquences temporelles, la juxtaposition des anticipations et des analepses place le lecteur en danger permanent de se perdre dans un monde de fantasmes. Une situation inconfortable qui l’inciterait à abandonner très vite un récit dont il perd sans cesse le fil. Le texte se donne en fait comme une suite décousue de voix fantomatiques, sans identité (tous les personnages sont morts), par lesquelles le héros, Juan Preciado (et le lecteur avec lui), reconstitue l’histoire de son père Pedro Paramo, le cacique du village, dominateur et cruel, qui l’avait abandonné dans son enfance (Juan Rulfo est orphelin a huit ans). Davantage encore que les grandes références romanesques traitant du thème du caciquisme, comme Moi le Suprême de paraguayen Augusto Roa Bastos, de L’Etincelle (Gracias por el fuego) de l’uruguyen Mario Benedetti, de L’Automne du patriarche du colombien Garcia Marquez, tous pourtant de facture plus classique, Pedro Paramo incarne la référence absolue de tous les Citizen Kane latino-américains. L’énigme Juan Rulfo s’inscrit donc entre succès surprenant et mystérieux silence. Enrique Vila-Matas rappelle que, pour justifier son mutisme, Rulfo prétextait non seulement la mort de son oncle Celerino qui lui dictait ses histoires mais aussi les fumeurs de marihuana: «Aujourd’hui, disait-il, même les fumeurs de marihuana publient des livres. Vous ne trouvez pas qu’il sort plein de livres bizarres un peu partout? Eh bien moi j’ai préféré garder le silence». Plus loin, il évoque une fable de Monterroso, un ami de Rulfo, Le plus sage Renard, en guise d’explication: «Il y est question d’un Renard bien content d’avoir écrit deux livres à succès. Les années passent sans qu’il ne publie rien d’autre. Les gens commencent à chuchoter, à se demander ce qui se passe, et lorsqu’ils tombent sur lui dans les coktails, vont le voir pour lui dire qu’il devrait recommencer à publier. Mais j’en ai déjà publié deux, répond, lassé, le Renard. Justement, ils sont très bons, répondent-ils, et c’est pour ça que tu devrais en sortir un autre. Le Renard n’en dit rien, mais pense qu’en réalité ils espèrent le voir publier un mauvais livre. Mais, pas Renard pour rien, il s’en garde bien». Il faut parfois toute une œuvre pour qu’émerge enfin un chef-d’œuvre, souvent beaucoup de livres médiocres ou inutiles pour en faire un acceptable. Ceux qui ont le génie ou la chance d’atteindre immédiatement l’objectif auraient bien tort d’insister, autant pour eux que pour leurs lecteurs.
Moins original, moins tragique, le silence de Rulfo est tout autant mythifié. Un silence de trente ans durant lequel il retourne simplement à ses travaux d’archives à l’Institut National Indigéniste tout en s’adonnant à la photographie. Deux fulgurances seulement au milieu d’une vie à la Bartleby: à 36 ans, en 1953, il publie un recueil de nouvelles, El Llano en llamas (Le Llano en flammes), puis, deux ans plus tard, son chef-d’œuvre Pedro Paramo. Ensuite quelques scénarios tirés de son œuvre pour le cinéma, réunis plus tard sous le titre El Gallo de oro (le coq d’or), un roman annoncé qu’il n’écrira jamais (La Cordillera), et le mutisme définitif malgré la célébrité. Je me suis souvent demandé si son succès immédiat et fracassant n’était pas plus surprenant encore que son silence inexpliqué. El Llano en llamas le place d’emblée à la tête des lettres mexicaines avant que Pedro Paramo, – «la plus haute expression jamais atteinte par le roman mexicain» est-il écrit au dos de mon édition espagnole –, ne consacre universellement sa notoriété. La diffusion de ce petit roman fut énorme, ses traductions multiples, son retentissement mondial. Et pourtant rien à mon sens – et surtout pas sa complexité et sa technique narrative révolutionnaire – ne le disposait au succès populaire. La structure éclatée, le désordre chronologique délibéré, la dislocation des séquences temporelles, la juxtaposition des anticipations et des analepses place le lecteur en danger permanent de se perdre dans un monde de fantasmes. Une situation inconfortable qui l’inciterait à abandonner très vite un récit dont il perd sans cesse le fil. Le texte se donne en fait comme une suite décousue de voix fantomatiques, sans identité (tous les personnages sont morts), par lesquelles le héros, Juan Preciado (et le lecteur avec lui), reconstitue l’histoire de son père Pedro Paramo, le cacique du village, dominateur et cruel, qui l’avait abandonné dans son enfance (Juan Rulfo est orphelin a huit ans). Davantage encore que les grandes références romanesques traitant du thème du caciquisme, comme Moi le Suprême de paraguayen Augusto Roa Bastos, de L’Etincelle (Gracias por el fuego) de l’uruguyen Mario Benedetti, de L’Automne du patriarche du colombien Garcia Marquez, tous pourtant de facture plus classique, Pedro Paramo incarne la référence absolue de tous les Citizen Kane latino-américains. L’énigme Juan Rulfo s’inscrit donc entre succès surprenant et mystérieux silence. Enrique Vila-Matas rappelle que, pour justifier son mutisme, Rulfo prétextait non seulement la mort de son oncle Celerino qui lui dictait ses histoires mais aussi les fumeurs de marihuana: «Aujourd’hui, disait-il, même les fumeurs de marihuana publient des livres. Vous ne trouvez pas qu’il sort plein de livres bizarres un peu partout? Eh bien moi j’ai préféré garder le silence». Plus loin, il évoque une fable de Monterroso, un ami de Rulfo, Le plus sage Renard, en guise d’explication: «Il y est question d’un Renard bien content d’avoir écrit deux livres à succès. Les années passent sans qu’il ne publie rien d’autre. Les gens commencent à chuchoter, à se demander ce qui se passe, et lorsqu’ils tombent sur lui dans les coktails, vont le voir pour lui dire qu’il devrait recommencer à publier. Mais j’en ai déjà publié deux, répond, lassé, le Renard. Justement, ils sont très bons, répondent-ils, et c’est pour ça que tu devrais en sortir un autre. Le Renard n’en dit rien, mais pense qu’en réalité ils espèrent le voir publier un mauvais livre. Mais, pas Renard pour rien, il s’en garde bien». Il faut parfois toute une œuvre pour qu’émerge enfin un chef-d’œuvre, souvent beaucoup de livres médiocres ou inutiles pour en faire un acceptable. Ceux qui ont le génie ou la chance d’atteindre immédiatement l’objectif auraient bien tort d’insister, autant pour eux que pour leurs lecteurs.![Semprun[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/01/01/813940161.jpg) L’écriture ou la vie. C
L’écriture ou la vie. C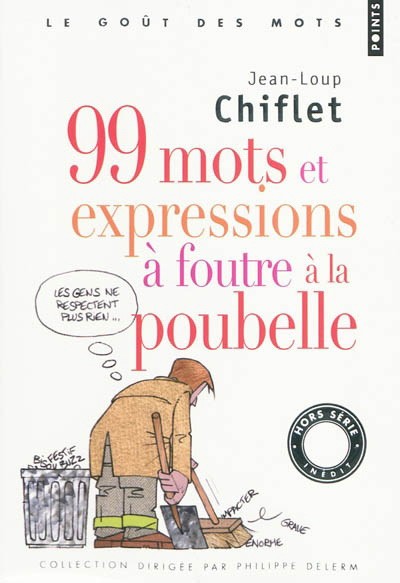
![butor[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/01/02/3096650766.jpg) Je ne devais guère avoir plus de 20 ans quand j’ai lu L’Emploi du temps de Michel Butor. Un passage a marqué ma relation avec l’écriture. On se souvient que le roman met en scène un personnage – Jacques Revel – fraîchement arrivé dans une ville imaginaire (Bleston) où il est chargé de la correspondance avec la France aux établissements Matthews & Sons. Envahi d’un insidieux malaise, et pour lever la gêne qui l’absorbe, il se met à retracer son parcours en consignant tous les événements vécus. Mais rédiger dans leurs détails ces différents épisodes, et surtout ceux qui lui ont paru sur le moment insignifiants mais dont il soupçonne par là-même l’importance a posteriori, lui prend du temps. Beaucoup de temps. Si bien que, pendant qu’il court vainement après le passé, le présent lui échappe. La vie se poursuit sans lui, hors de son espace temps rédactionnel. Ainsi, sa voisine, dont il est amoureux, s’en va avec un type qui, lui, ne passe pas son temps à consigner son emploi du temps.
Je ne devais guère avoir plus de 20 ans quand j’ai lu L’Emploi du temps de Michel Butor. Un passage a marqué ma relation avec l’écriture. On se souvient que le roman met en scène un personnage – Jacques Revel – fraîchement arrivé dans une ville imaginaire (Bleston) où il est chargé de la correspondance avec la France aux établissements Matthews & Sons. Envahi d’un insidieux malaise, et pour lever la gêne qui l’absorbe, il se met à retracer son parcours en consignant tous les événements vécus. Mais rédiger dans leurs détails ces différents épisodes, et surtout ceux qui lui ont paru sur le moment insignifiants mais dont il soupçonne par là-même l’importance a posteriori, lui prend du temps. Beaucoup de temps. Si bien que, pendant qu’il court vainement après le passé, le présent lui échappe. La vie se poursuit sans lui, hors de son espace temps rédactionnel. Ainsi, sa voisine, dont il est amoureux, s’en va avec un type qui, lui, ne passe pas son temps à consigner son emploi du temps.![poveda2[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/02/00/710286444.jpg) En automne dernier sortait sur les écrans l’extraordinaire documentaire La Vida Loca de Christian Poveda, journaliste franco-espagnol assassiné au Salvador en septembre 2009, victime de son œuvre.
En automne dernier sortait sur les écrans l’extraordinaire documentaire La Vida Loca de Christian Poveda, journaliste franco-espagnol assassiné au Salvador en septembre 2009, victime de son œuvre.![vallejo[1].JPG](http://blogres.blogspirit.com/media/01/02/1689952587.JPG) Ce documentaire m’a renvoyé au sublime roman La Vierge des tueurs, de l’écrivain colombien Fernando Vallejo. Sorte de randonnée mortelle, dans une ville de Medellin hallucinée, d’un homosexuel et d’un jeune sicaire qui sème les cadavres sur son passage avant d’être fatalement tué à son tour. Medellin – connue en Colombie sous le nom de Metrallo (par allusion à mitraillette)– où la mort est ce qu’il y a de moins chère, de plus commun, où l’on pouvait voir sur les hauteurs surplombant un ravin et quelques bananiers desséchés l’écriteau «INTERDIT DE JETER DES CADAVRES», Medellin, que l’auteur décrit d’une prose rapide comme une rafale de mitraillette et extraordinairement évocatrice de certaines villes actuelles, voire prophétique des villes du futur: «Les trottoirs? Envahis par les étalages de camelote qui bloquaient le passage. Les téléphones publics? Démolis. Le centre? Dévasté. L’Université? Démantelée. Ses murs? Profanés par des proclamations haineuses «revendiquant» les droits du «peuple». Partout le vandalisme et la horde humaine: des gens, toujours des gens, encore plus de gens, et comme si nous n’étions pas assez, de temps en temps une bonne femme enceinte, une de ces putes de chiennes pondeuses qui pullulent dans tous les coins avec leur panse impudique dans l’impunité la plus monstrueuse. C’était la populace envahissant tout, détruisant tout, cochonnant tout avec sa misère crapuleuse. «Place, racaille puante!», Medellin donc se transforme en un monde de morts qui reflète clairement une des fins possibles de notre espèce. Car la loi de Medellin sera bientôt celle de notre monde, prophétise l’auteur: «Ni à Sodome ni à Gomorrhe ni à Medellin ni en Colombie il n’y a d’innocents; ici tout ce qui existe est coupable, et s’il se reproduit d’autant plus. Les pauvres fabriquent encore plus de pauvres, la misère plus de misère, et plus il y a de misère plus il y a d’assassins, et plus il y a d’assassins plus il y a de morts. C’est la loi de Medellin, qui régira dorénavant la planète Terre. Prenez-en note.» Ce que prédisait déjà Georges Bernanos de la pauvreté au siècle dernier. Certaines villes, comme Saõ Paulo, ont d’ailleurs déjà troqué leurs ghettos de pauvres contre des ghettos de riches.
Ce documentaire m’a renvoyé au sublime roman La Vierge des tueurs, de l’écrivain colombien Fernando Vallejo. Sorte de randonnée mortelle, dans une ville de Medellin hallucinée, d’un homosexuel et d’un jeune sicaire qui sème les cadavres sur son passage avant d’être fatalement tué à son tour. Medellin – connue en Colombie sous le nom de Metrallo (par allusion à mitraillette)– où la mort est ce qu’il y a de moins chère, de plus commun, où l’on pouvait voir sur les hauteurs surplombant un ravin et quelques bananiers desséchés l’écriteau «INTERDIT DE JETER DES CADAVRES», Medellin, que l’auteur décrit d’une prose rapide comme une rafale de mitraillette et extraordinairement évocatrice de certaines villes actuelles, voire prophétique des villes du futur: «Les trottoirs? Envahis par les étalages de camelote qui bloquaient le passage. Les téléphones publics? Démolis. Le centre? Dévasté. L’Université? Démantelée. Ses murs? Profanés par des proclamations haineuses «revendiquant» les droits du «peuple». Partout le vandalisme et la horde humaine: des gens, toujours des gens, encore plus de gens, et comme si nous n’étions pas assez, de temps en temps une bonne femme enceinte, une de ces putes de chiennes pondeuses qui pullulent dans tous les coins avec leur panse impudique dans l’impunité la plus monstrueuse. C’était la populace envahissant tout, détruisant tout, cochonnant tout avec sa misère crapuleuse. «Place, racaille puante!», Medellin donc se transforme en un monde de morts qui reflète clairement une des fins possibles de notre espèce. Car la loi de Medellin sera bientôt celle de notre monde, prophétise l’auteur: «Ni à Sodome ni à Gomorrhe ni à Medellin ni en Colombie il n’y a d’innocents; ici tout ce qui existe est coupable, et s’il se reproduit d’autant plus. Les pauvres fabriquent encore plus de pauvres, la misère plus de misère, et plus il y a de misère plus il y a d’assassins, et plus il y a d’assassins plus il y a de morts. C’est la loi de Medellin, qui régira dorénavant la planète Terre. Prenez-en note.» Ce que prédisait déjà Georges Bernanos de la pauvreté au siècle dernier. Certaines villes, comme Saõ Paulo, ont d’ailleurs déjà troqué leurs ghettos de pauvres contre des ghettos de riches. 