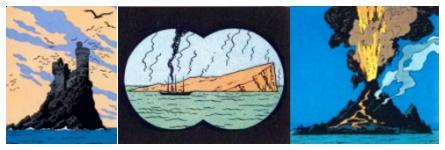Par Pierre Béguin «Ceux qui sont situés à droite ont du style, les autres une écriture» suggère Alain Bagnoud dans son blog de vendredi dernier. Et Antonin Moeri de surenchérir dans son commentaire: «Tous les grands stylistes étaient de droite» (le pense-t-il encore?) Le débat n’est pas sans rappeler celui de la littérature genre, à savoir de l’écriture spécifiquement féminine pas opposition à celle spécifiquement masculine. Et les sottises qui furent alors proférées. Mais supposons la pertinence de la question sur laquelle repose ces professions de foi. Supposons donc qu’une idéologie, en l’occurrence politique, détermine – et hiérarchise – un style (car apparemment il n’est pas question de la causalité inverse). Permettez-moi alors de substituer à la question «Y a-t-il au 20e siècle un style différent selon que l’écrivain soit de gauche ou de droite?» une autre question qui offre l’avantage d’un meilleur recul: «Y a-t-il au 16e siècle un style différent selon que l’écrivain soit protestant ou catholique?» A priori, en apparence du moins, la réponse est oui. Prenons deux exemples édifiants.
Chez Ronsard, le manteau fabuleux, richement brodé et serti de pierreries, qui recouvre un objet caché devient le symbole même de son principe poétique: la poésie cache et représente. Ce qu’elle cache, c’est une théologie mystique incompréhensible au commun des mortels, faite pour une élite, ce qu’elle représente, par l’art de l’amplification, de la surcharge, c’est la beauté, l’ornement. Car les poètes de la Pléïade pensent que le nombre est un élément du beau. Au contraire des protestants qui optent pour la réduction et la simplicité. Quand Théodore de Bèze écrit son Abraham sacrifiant (première pièce de théâtre en français à être appelée tragédie), il prend soin d’éviter un parler trop éloigné du commun. L’écriture ne doit pas attirer l’attention sur elle-même, on doit voir au travers. Son art est transparent pour laisser apparaître la vérité divine. Le défi à la Pléïade repose sur l’accessibilité, par opposition à ce qui se cache sous des enjolivures multiples comme celles du manteau de Ronsard (bien entendu, ce n’est pas le même dieu: Ronsard vénère la langue, les Protestants Dieu). La traduction des psaumes de Clément Marot, dès 1543, répond à l’optique du culte de Genève. S’ils restent très imagés, ils s’inscrivent dans le quotidien et la simplicité (et ils seront d’ailleurs condamnés par la Sorbonne). De même pour les Octonaires de la Roche-Chandieu (cf. par exemple, Octonaires sur la vanité et inconstance du monde, 1582) dont l’appauvrissement par rapport à la Pléïade est évident et volontaire: images et structure simples, poésie de la transparence, dénudée, pour ne pas distraire du message central. Bref, au 16e siècle, les littératures protestante et catholique semblent se différencier aussi par des styles spécifiques à leur doctrine respective, à l’image de leurs églises: austère, dénudée, vide chez les premiers, chez les seconds richement décorées et surchargées d’ornements et d’objets saints.
Cette distinction semble se confirmer si l’on se réfère au style des théologiens. Souvenez-vous, dans Gargantua, de la harangue incompréhensible de Janotus de Bragmardo pour récupérer les cloches de Notre-Dame, harangue par laquelle Rabelais se moque du jargon sorbonnard au service de l’obscurantisme (les plaidoiries des Seigneurs Humevesne et Baisecul dans Pantagruel leur ressemblent). A vrai dire, le style des théologiens sorbonnards ne diffèrent guère de la parodie qu’en fait Rabelais. Voyez par exemple Claude Despense (Traité contre l’erreur vieil et renouvellé des predestinez, 1548) : «…qu’il ne nous fault penser, chercher ou parler de nostre election hors la parole de Dieu, non point s’amuser et convertir, destourner l’ouye et l’attester aux fables ineptes, inutiles, semblables à celles des vieilles, poëtiques ou Judaïques, non en vaine philosophie seculiere, ou en hautesse de sapience ou eloquence humaine, non en autre science de ce monde prophane, science faulsement appellee, science non descendue d’en haut…» Je vous fais grâce de la suite de la phrase qui dure encore 5 lignes. Une longue phrase qui cherche à présenter le pour et le contre et fait avancer le tout sur un front large, comme un rouleau compresseur, pour aborder la pensée complète dans une seule res![calvin3[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/01/00/2394101857.jpg) piration syntaxique (la grammaire du 16e siècle ne fait pas la distinction entre les conjonctions de coordinations et de subordinations). Par opposition, lisez Calvin. Des phrases courtes, sans rhétorique, un vocabulaire simple, une syntaxe ordonnée, une volonté d’argumenter par la multiplication des coordinations («car») et de s’accommoder aux petits (un style qui ressemble à celui de Mathurin Cordier, son professeur de latin): «Or il convient estendre ce qui a esté faict en un sainct à tous les autres, veu que c’est une mesme raison. Mais encore que nous laissions là les sainctz, advisons que dit sainct Paul de Jesus Christ mesmes. Car il proteste de ne le congnoistre…». Oui, Calvin a inventé la phrase courte et fait évoluer la langue française vers une langue de débat. Son empreinte stylistique ira jusqu’à Malherbe dont on sait qu’il fut à l’origine de la mode du classicisme.
piration syntaxique (la grammaire du 16e siècle ne fait pas la distinction entre les conjonctions de coordinations et de subordinations). Par opposition, lisez Calvin. Des phrases courtes, sans rhétorique, un vocabulaire simple, une syntaxe ordonnée, une volonté d’argumenter par la multiplication des coordinations («car») et de s’accommoder aux petits (un style qui ressemble à celui de Mathurin Cordier, son professeur de latin): «Or il convient estendre ce qui a esté faict en un sainct à tous les autres, veu que c’est une mesme raison. Mais encore que nous laissions là les sainctz, advisons que dit sainct Paul de Jesus Christ mesmes. Car il proteste de ne le congnoistre…». Oui, Calvin a inventé la phrase courte et fait évoluer la langue française vers une langue de débat. Son empreinte stylistique ira jusqu’à Malherbe dont on sait qu’il fut à l’origine de la mode du classicisme.
Mais si tout semble donc indiquer en apparence qu’une idéologie – en l’occurrence une doctrine religieuse – détermine un style, à y regarder de plus près, l’affirmation n’est pas si simple. A lire des théologiens protestants, par exemple Guillaume Farel ou Pierre Viret (le Réformateur le plus lu après Calvin), on est surpris de retrouver un style très proche de celui des Sorbonnards. A l’inverse, des théologiens catholiques, comme Jean de Montluc ou Antoine du Val, voient leur style contaminé par celui de Calvin. Comme Ronsard qui a dû répondre à ses adversaires dans leur style, les théologiens catholiques, pour la première fois contestés et poussés au débat, se doivent d’adopter les armes de leurs opposants. Et ils le feront très bien, sans pour autant trahir leur doctrine. Ce n’est donc pas tant une idéologie ou une doctrine (ni même une appartenance à un sexe) qui détermine un style – et dans ce sens il n’y a pas de causalité directe – que les circonstances dans lesquelles une idéologie ou une doctrine prend corps dans les mots. Ainsi, de même qu’on ne peut pas dire que la phrase simple et argumentative, au 16e siècle, est protestante, de même on ne peut pas dire que tous les grands stylistes, au 20e siècle, se situent à droite de l’échiquier politique, comme si être de droite (ou être protestant ou être une femme) impliquait un style généré par l’idéologie même (ou la doctrine ou l’appartenance à un sexe). En revanche, il est permis de penser, comme le précise ensuite Antonin Moeri, que des écrivains qui se trouvent «du bon côté de la barrière trouvent plus facilement satisfaction en écrivant» et que ceux qui seraient «honnis, rejetés, traînés dans la boue, menacés de mort s’y reprennent plusieurs fois avant de fixer une phrase sur le papier». La nuance est d’importance. Pour autant doit-on en déduire qu’aujourd’hui, la pensée dominante étant à droite, il faudrait impérativement être de gauche pour avoir du style?
![Verhaeren[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/02/00/3088906854.jpg)
![calvin3[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/01/00/2394101857.jpg) piration syntaxique (la grammaire du 16e siècle ne fait pas la distinction entre les conjonctions de coordinations et de subordinations). Par opposition, lisez Calvin. Des phrases courtes, sans rhétorique, un vocabulaire simple, une syntaxe ordonnée, une volonté d’argumenter par la multiplication des coordinations («car») et de s’accommoder aux petits (un style qui ressemble à celui de Mathurin Cordier, son professeur de latin): «Or il convient estendre ce qui a esté faict en un sainct à tous les autres, veu que c’est une mesme raison. Mais encore que nous laissions là les sainctz, advisons que dit sainct Paul de Jesus Christ mesmes. Car il proteste de ne le congnoistre…». Oui, Calvin a inventé la phrase courte et fait évoluer la langue française vers une langue de débat. Son empreinte stylistique ira jusqu’à Malherbe dont on sait qu’il fut à l’origine de la mode du classicisme.
piration syntaxique (la grammaire du 16e siècle ne fait pas la distinction entre les conjonctions de coordinations et de subordinations). Par opposition, lisez Calvin. Des phrases courtes, sans rhétorique, un vocabulaire simple, une syntaxe ordonnée, une volonté d’argumenter par la multiplication des coordinations («car») et de s’accommoder aux petits (un style qui ressemble à celui de Mathurin Cordier, son professeur de latin): «Or il convient estendre ce qui a esté faict en un sainct à tous les autres, veu que c’est une mesme raison. Mais encore que nous laissions là les sainctz, advisons que dit sainct Paul de Jesus Christ mesmes. Car il proteste de ne le congnoistre…». Oui, Calvin a inventé la phrase courte et fait évoluer la langue française vers une langue de débat. Son empreinte stylistique ira jusqu’à Malherbe dont on sait qu’il fut à l’origine de la mode du classicisme. Je suis donc allé voir, comme beaucoup de gens, l'exposition que la fondation Gianadda a montée pour les 100 ans de la naissance de Balthus.
Je suis donc allé voir, comme beaucoup de gens, l'exposition que la fondation Gianadda a montée pour les 100 ans de la naissance de Balthus.![chat[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/02/01/308972250.jpg)
 Eurofoot encore. C'est fini et bien fini, certes. Mais il me reste quelques questions, pour avoir observé tous ces fans de foot, tous ces adultes enroulés dans des drapeaux, portant le maillot de leur équipe, roulant dans des voitures qui arborent les emblèmes d'un pays. Le phénomène était d'une telle ampleur qu'il y avait de quoi s'interroger.
Eurofoot encore. C'est fini et bien fini, certes. Mais il me reste quelques questions, pour avoir observé tous ces fans de foot, tous ces adultes enroulés dans des drapeaux, portant le maillot de leur équipe, roulant dans des voitures qui arborent les emblèmes d'un pays. Le phénomène était d'une telle ampleur qu'il y avait de quoi s'interroger. PAR ANTONIN MOERI
PAR ANTONIN MOERI