Pour Péguy
Par Pierre Béguin
Et quant à la  poésie, j’ai trois sensibilités particulières qui l’emportent en fin de compte sur toutes les autres: Aragon, Reverdy et Péguy. Les deux premières sont avouables, la troisième plus difficilement. Nul écrivain ne traîne le poids des clichés davantage que Péguy, victime des étiquettes nationaliste et catholique conservateur que lui a confectionnées à titre posthume le régime de Vichy. Peu lu mais beaucoup critiqué par ceux-là même qui ne l’ont pas lu, il est peut-être le poète le plus défiguré par les a priori.
poésie, j’ai trois sensibilités particulières qui l’emportent en fin de compte sur toutes les autres: Aragon, Reverdy et Péguy. Les deux premières sont avouables, la troisième plus difficilement. Nul écrivain ne traîne le poids des clichés davantage que Péguy, victime des étiquettes nationaliste et catholique conservateur que lui a confectionnées à titre posthume le régime de Vichy. Peu lu mais beaucoup critiqué par ceux-là même qui ne l’ont pas lu, il est peut-être le poète le plus défiguré par les a priori.
Rien d’incompatible au fond entre catholicisme et socialisme. Emile Verhaeren était de cette veine. Charles Péguy aussi. Tout d’abord socialiste humaniste, c’est-à-dire pacifiste et internationaliste, dreyfusard, disciple de Jaurès et plutôt anticlérical, il évolue vers le nationalisme sous le double effet d’un caractère entier et de la menace allemande: «Une capitulation – affirme-t-il – est essentiellement une opération par laquelle on se met à expliquer au lieu d’agir». Plutôt la mort que la soumission. De fait, la première guerre mondiale sitôt commencée, Péguy, toujours pratiquement inconnu, arrive à peine sur le front qu’une balle lui transperce le sien. Un signe qui ne trompe pas. Péguy est l’exacte image de son style: loin des modes et des compromissions, il appartient aux tempéraments qui vont au bout de leur engagement, sans tricherie, sans concession, avec la détermination, le courage, la candeur, l’obsédant ressassement, l’infatigable rumination de ceux qui s’exposent et ne calculent jamais. Un approfondissement intérieur le ramène à la foi. Le voilà, sans contradiction, socialiste chrétien et nationaliste pacifiste. Le très beau Mystère de la charité Jeanne d’Arc unit les deux inspirations. Foi, espérance, charité sont au cœur de son œuvre comme de son christianisme qui prend sa source dans le mystère de l’Incarnation et qui préfère aux spéculations sur la transcendance l’enracinement dans le charnel, à l’arrogance de l’intellect l’humilité du spirituel. Que n’a-t-on pas dit sur son style! Répétitions, piétinements, lourdeurs, litanies perpétuelles qui tournent en rond et tracent leur sillon comme un paysan laborieux accroché à sa terre. Je dirais plutôt comme l’incessant flux et reflux des vagues sur le sable dont le souffle, imitant l’idée fixe et l’obstination, finit par dégager des vertus fascinantes. Laissez-vous seulement emporter par cette houle obsédante, par le bercement enchanteur de ces vagues, par le charme insidieux et hypnotique de leur mouvement, et vous verrez bientôt surgir de cette lourdeur, de cette pesanteur, par un miracle aussi sublime qu’inattendu, une puissance pleine de grâce: la beauté de l’écume et la légèreté des gouttelettes qui dansent entre ciel et terre. C’est le miracle du style de Péguy. Et peut-être aussi celui de la foi dont ce style, précisément, cherche à en suggérer le souffle silencieux. Reverdy, lui, suggère parfois le mystère divin dans les blancs du poème nés des décalages typographiques – dans les deux cas, nous sommes aux antipodes des affirmations de foi triomphante d’un Claudel qui me laissent insensible.
Souvent, je lis ou relis quelques vers de Péguy. Je l’ai toujours convoqué dans les circonstances religieuses importantes qui ont marqué mon existence, de l’enterrement de mon fils aux baptêmes de mes filles. Du Mystère des saints Innocents au Porche du mystère de la deuxième vertu, ses vers ont résonné dans le temple. Et à chaque fois, spontanément, sitôt la fin du sermon, presque toute l’assemblée, sous le charme et l’émotion, est venue me demander qui était l’auteur de si beaux poèmes. Ceux qui connaissaient Péguy de réputation sans jamais l’avoir lu, à l’annonce de son nom, ont semblé exprimer une manière de grimace, à l’image de leur déception. Tant pis pour eux! Moi, loin des clichés et des a priori – que mes proches s’en souviennent! – à mon enterrement, je veux du Péguy!

![voltaire2[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/00/01/704856046.jpg) ristiques étonnantes, les rives du lac Léman sont un haut lieu historique des rapports tendus entre le pouvoir politique et les écrivains. Quelques dizaines d’années et quelques dizaines de kilomètres séparent le patriarche de Ferney de la matriarche de Coppet. Tous deux exilés, tous deux frénétiquement actifs, tous deux diablement efficaces, tous deux «aubergistes de l’Europe», Voltaire et Germaine de Staël ont fait trembler le pouvoir parisien du bout de leur plume, narguant par les mots l’Ancien régime et l’Empire. Voltaire trouve un renouveau de vie, une seconde jeunesse, dans sa joie à combattre, avec une incroyable fureur ce qu’il nomme l’infâme – la superstition et le fanatisme. Bien sûr, le vieux patriarche n’a rien du redresseur de torts, l’impératif moral reste chez lui secondaire. Son engagement est en réalité toujours dirigé contre l’adversaire obsédant sur lequel il multiplie les coups. En ce sens, il choisit soigneusement ses combats. Que ce soit, par exemple, dans l’affaire Calas ou celle du chevalier de la Barre, il saisit l’occasion où la cause de la justice se conjugue étroitement avec sa haine de l’Eglise. Il n’en reste pas moins que la capitale du monde intellectuel devait pour un temps coïncider avec la région où vivait l’être le plus prompt à réagir et le plus habile dans l’escrime du langage. Quant à Mme de Staël, qui polarisait à Coppet les espoirs déçus des royalistes et des républicains, son activisme fit dire à Napoléon: «Sa demeure à Coppet était devenue un véritable arsenal contre moi; on venait s’y faire armer chevalier.» Tous les Genevois devraient faire le pèlerinage dans ses deux châteaux dont l’intérêt est aussi immense que fut leur rayonnement vers la fin du 18e et le début du 19e siècle.
ristiques étonnantes, les rives du lac Léman sont un haut lieu historique des rapports tendus entre le pouvoir politique et les écrivains. Quelques dizaines d’années et quelques dizaines de kilomètres séparent le patriarche de Ferney de la matriarche de Coppet. Tous deux exilés, tous deux frénétiquement actifs, tous deux diablement efficaces, tous deux «aubergistes de l’Europe», Voltaire et Germaine de Staël ont fait trembler le pouvoir parisien du bout de leur plume, narguant par les mots l’Ancien régime et l’Empire. Voltaire trouve un renouveau de vie, une seconde jeunesse, dans sa joie à combattre, avec une incroyable fureur ce qu’il nomme l’infâme – la superstition et le fanatisme. Bien sûr, le vieux patriarche n’a rien du redresseur de torts, l’impératif moral reste chez lui secondaire. Son engagement est en réalité toujours dirigé contre l’adversaire obsédant sur lequel il multiplie les coups. En ce sens, il choisit soigneusement ses combats. Que ce soit, par exemple, dans l’affaire Calas ou celle du chevalier de la Barre, il saisit l’occasion où la cause de la justice se conjugue étroitement avec sa haine de l’Eglise. Il n’en reste pas moins que la capitale du monde intellectuel devait pour un temps coïncider avec la région où vivait l’être le plus prompt à réagir et le plus habile dans l’escrime du langage. Quant à Mme de Staël, qui polarisait à Coppet les espoirs déçus des royalistes et des républicains, son activisme fit dire à Napoléon: «Sa demeure à Coppet était devenue un véritable arsenal contre moi; on venait s’y faire armer chevalier.» Tous les Genevois devraient faire le pèlerinage dans ses deux châteaux dont l’intérêt est aussi immense que fut leur rayonnement vers la fin du 18e et le début du 19e siècle.![barbey3[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/01/01/216680835.jpg)
![moreau_OK[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/01/00/3447180404.jpg)
![feyerabend[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/02/02/1017704214.jpg) La science est avant tout humaniste. Aucun prétendu argument ne m’énerve davantage que celui qui balaie toute contestation par ce stupide revers de formule: «C’est prouvé scientifiquement!» Pour paraître sérieux, tout doit devenir scientifique dans notre vie: sciences politiques, sciences économiques, sciences de l’éducation… Même la médecine, qui se glorifiait d’être un art, s’enorgueillit maintenant d’être une science. Quand donc comprendrons-nous que la science n’est jamais aussi scientifique qu’elle le prétend? Alors oui, pour parodier Sartre, je dirai que la Science est un humaniste… qui veut s’ignorer.
La science est avant tout humaniste. Aucun prétendu argument ne m’énerve davantage que celui qui balaie toute contestation par ce stupide revers de formule: «C’est prouvé scientifiquement!» Pour paraître sérieux, tout doit devenir scientifique dans notre vie: sciences politiques, sciences économiques, sciences de l’éducation… Même la médecine, qui se glorifiait d’être un art, s’enorgueillit maintenant d’être une science. Quand donc comprendrons-nous que la science n’est jamais aussi scientifique qu’elle le prétend? Alors oui, pour parodier Sartre, je dirai que la Science est un humaniste… qui veut s’ignorer.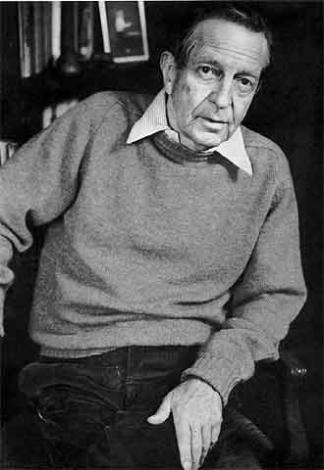

![murger[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/00/01/3472858476.jpg) Le roman d’Henry Murger (1851) – qui n’est pas un roman, précise l’auteur, mais de petites histoires, des scènes – malgré le succès qu’il connut à sa parution, dans les journaux d’abord, puis en recueil, est largement oublié de nos jours, éclipsé dès la fin du 19e siècle par l’opéra de Puccini, La Bohème (1896), qui s’est alors approprié à lui seul ce répertoire emblématique du romantisme. Oubli regrettable à plus d’un titre. Non seulement parce que l’opéra en est l’adaptation – ou plutôt l’adaptation de l’adaptation, puisque le livret s’inspire non du texte original de Murger mais de la pièce, La Vie de bohème, que ce dernier en a tirée en collaboration avec Théodore Barrière. Non seulement parce que sa préface, prolégomènes semés de noms célèbres, des ménestrels en passant par Villon, Marot, Rabelais, Shakespeare et Molière, tous illustres bohémiens, nous fait mieux comprendre la genèse de la bohème et son importance historique et artistique. Mais surtout parce que, même à notre époque où la bohème délaisse la mansarde pour le squat, le charme de ces petites scènes opère toujours avec cette magie qui leur avait valu l’admiration de tous les écrivains contemporains, et la reconnaissance de Victor Hugo. Si les quatre personnages principaux, sortes de mousquetaires des arts, Rodolphe le poète, Schaunard le musicien, Marcel le peintre et Gustave Colline le philosophe, ressemblent davantage à des caricatures qu’à des constructions psychologiques réalistes (ils pourraient être en ce sens les ancêtres des Pieds Nickelés ou de Bibi Fricotin), les véritables protagonistes sont surtout les instances sociales emblématiques de la vie de bohème à l’intérieur desquelles se meuvent les personnages: la mansarde, le café, l’atelier, la rue, l’hôpital… Et Murger, avec une lucidité clinique derrière le masque de l’humour et de la légèreté qui enrobe plaisamment le désespoir, montre superbement comment, d’une génération l’autre, la notion même de bohème a évolué entre 1830 et 1850. Si les Dumas, Nodier, Petrus Borel, Gautier, Nerval donnaient au romantisme un souffle nouveau dans l’atmosphère fervente de l’impasse du Doyenné (où habitaient Gautier et Nerval), un souffle qui trouvait dans la bataille d’Hernani son sens et sa légitimation, la génération suivante, celle décrite par Murger, s’est retrouvée aliénée par une morale publique qui a envoyé Baudelaire et Flaubert devant le tribunaux, livrée à elle-même, sans convictions ni croyances, sans autres horizons qu’un ciel désespérément vide au dessus d’une bohème menant inéluctablement en enfer pour peu que la Muse de l’artiste ne se pliât aux exigences du marché. Pas de liberté ni de bonheur dans cette bohème mais une errance subie qui n’offre d’autres issues pour sortir de la jeunesse que la mort prématurée ou l’embourgeoisement. Soit le destin de Jacques, le sculpteur, qui meurt avant trente ans, inconnu et solitaire, à l’hôpital, soit celui de Rodolphe qui se sauve de la bohème parce qu’il a compris, comme Rastignac, qu’il fallait impérativement, pour survivre, trahir sa jeunesse et perdre ses illusions. Bien plus que la chronique humoristique d’une époque, Henry Murger a écrit une profonde méditation sur la jeunesse et la fin de la jeunesse. Sur un mode mineur certes, Scènes de la vie de bohème rejoint les grands romans d’apprentissage du 19e siècle et vaut largement qu’on le lise. Et qu’on découvre – ou redécouvre – dans la foulée tous ceux qui, dans le siècle de la bourgeoisie, ont chanté la bohème avec Henry Murger, entre autres Charles Nodier (Histoire du roi de Bohème et de ses sept châteaux), Balzac (Un prince de la bohème), Rimbaud (Ma Bohème), Huysmans (A rebours). On comprendra mieux alors – ou l’on se rappellera – ce qu’est vraiment la bohème et pourquoi elle est étape essentielle de notre vie, comme l’a si bien chanté Charles Aznavour qui, dans sa fameuse et très belle chanson, en a repris tous les stéréotypes:
Le roman d’Henry Murger (1851) – qui n’est pas un roman, précise l’auteur, mais de petites histoires, des scènes – malgré le succès qu’il connut à sa parution, dans les journaux d’abord, puis en recueil, est largement oublié de nos jours, éclipsé dès la fin du 19e siècle par l’opéra de Puccini, La Bohème (1896), qui s’est alors approprié à lui seul ce répertoire emblématique du romantisme. Oubli regrettable à plus d’un titre. Non seulement parce que l’opéra en est l’adaptation – ou plutôt l’adaptation de l’adaptation, puisque le livret s’inspire non du texte original de Murger mais de la pièce, La Vie de bohème, que ce dernier en a tirée en collaboration avec Théodore Barrière. Non seulement parce que sa préface, prolégomènes semés de noms célèbres, des ménestrels en passant par Villon, Marot, Rabelais, Shakespeare et Molière, tous illustres bohémiens, nous fait mieux comprendre la genèse de la bohème et son importance historique et artistique. Mais surtout parce que, même à notre époque où la bohème délaisse la mansarde pour le squat, le charme de ces petites scènes opère toujours avec cette magie qui leur avait valu l’admiration de tous les écrivains contemporains, et la reconnaissance de Victor Hugo. Si les quatre personnages principaux, sortes de mousquetaires des arts, Rodolphe le poète, Schaunard le musicien, Marcel le peintre et Gustave Colline le philosophe, ressemblent davantage à des caricatures qu’à des constructions psychologiques réalistes (ils pourraient être en ce sens les ancêtres des Pieds Nickelés ou de Bibi Fricotin), les véritables protagonistes sont surtout les instances sociales emblématiques de la vie de bohème à l’intérieur desquelles se meuvent les personnages: la mansarde, le café, l’atelier, la rue, l’hôpital… Et Murger, avec une lucidité clinique derrière le masque de l’humour et de la légèreté qui enrobe plaisamment le désespoir, montre superbement comment, d’une génération l’autre, la notion même de bohème a évolué entre 1830 et 1850. Si les Dumas, Nodier, Petrus Borel, Gautier, Nerval donnaient au romantisme un souffle nouveau dans l’atmosphère fervente de l’impasse du Doyenné (où habitaient Gautier et Nerval), un souffle qui trouvait dans la bataille d’Hernani son sens et sa légitimation, la génération suivante, celle décrite par Murger, s’est retrouvée aliénée par une morale publique qui a envoyé Baudelaire et Flaubert devant le tribunaux, livrée à elle-même, sans convictions ni croyances, sans autres horizons qu’un ciel désespérément vide au dessus d’une bohème menant inéluctablement en enfer pour peu que la Muse de l’artiste ne se pliât aux exigences du marché. Pas de liberté ni de bonheur dans cette bohème mais une errance subie qui n’offre d’autres issues pour sortir de la jeunesse que la mort prématurée ou l’embourgeoisement. Soit le destin de Jacques, le sculpteur, qui meurt avant trente ans, inconnu et solitaire, à l’hôpital, soit celui de Rodolphe qui se sauve de la bohème parce qu’il a compris, comme Rastignac, qu’il fallait impérativement, pour survivre, trahir sa jeunesse et perdre ses illusions. Bien plus que la chronique humoristique d’une époque, Henry Murger a écrit une profonde méditation sur la jeunesse et la fin de la jeunesse. Sur un mode mineur certes, Scènes de la vie de bohème rejoint les grands romans d’apprentissage du 19e siècle et vaut largement qu’on le lise. Et qu’on découvre – ou redécouvre – dans la foulée tous ceux qui, dans le siècle de la bourgeoisie, ont chanté la bohème avec Henry Murger, entre autres Charles Nodier (Histoire du roi de Bohème et de ses sept châteaux), Balzac (Un prince de la bohème), Rimbaud (Ma Bohème), Huysmans (A rebours). On comprendra mieux alors – ou l’on se rappellera – ce qu’est vraiment la bohème et pourquoi elle est étape essentielle de notre vie, comme l’a si bien chanté Charles Aznavour qui, dans sa fameuse et très belle chanson, en a repris tous les stéréotypes:![antonio_lobo_antunes[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/02/02/2956809343.jpg)