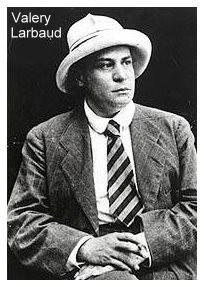Vanité ou la germination du silence
Par Pierre Béguin
![serna[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/01/01/3251353653.jpg) Une longue nouvelle de l’écrivain mexicain Enrique Serna a merveilleusement bercé ma dernière insomnie: Vanité (in Des Nouvelles du Mexique, Ed Métailié, 2009). L’écrivain y décrit avec une verve cinglante, un humour – ou une auto dérision – féroce et chirurgical, les compromissions, les lâchetés, les vanités surtout, du milieu littéraire. Auto complaisance, club d’éloges mutuels qui permettent d’accaparer les butins les plus convoités des prix littéraires ou des subventions publiques aux belles-lettres.
Une longue nouvelle de l’écrivain mexicain Enrique Serna a merveilleusement bercé ma dernière insomnie: Vanité (in Des Nouvelles du Mexique, Ed Métailié, 2009). L’écrivain y décrit avec une verve cinglante, un humour – ou une auto dérision – féroce et chirurgical, les compromissions, les lâchetés, les vanités surtout, du milieu littéraire. Auto complaisance, club d’éloges mutuels qui permettent d’accaparer les butins les plus convoités des prix littéraires ou des subventions publiques aux belles-lettres.
Le narrateur enseigne dans une petite ville de province. Il appartient au cercle des artistes rejetés ou marginalisés par la directrice de l’Institut régional de la culture qui ne le compte pas parmi ses protégés. Sous l’impulsion d’amis, il envoie son recueil de poèmes, Tir dans l’obscurité, à Octavio Paz. Qui lui tresse, contre toute attente, une lettre de louanges. Les éloges du maître enflent aussitôt l’ego de l’élève: don Octavio le traite en frère, cadet sans doute, mais en frère tout de même. De quoi naviguer toutes voiles dehors dans la haute mer de l’orgueil. Et, pour commencer ce périple annoncé avec fifres et tambours, une grande fête afin d’exhiber la fameuse lettre devant tout ce que la petite ville compte de prétendants aux honneurs de la poésie. Et de les faire crever d’envie! Tous! Surtout ceux qui le méprisent. Seulement voilà, notre Perrette laisse son pot au lait à portée de crayons de sa fille. Qui profane la lettre avec l’énergie avide de ses trois ans, au point que la missive sacrée en devient illisible. Incapable de produire la preuve qui le consacrerait au pinacle de la poésie, il devient la risée de la fête. Honneur perdu. Les premiers couteaux de la médisance ne tardent guère à briller, les plumes trempées dans les sécrétions biliaires à s’activer, sans parler des commentaires sous cape ou des regards en coin. Humilié, notre poète veut se venger par le vers, écorcher vif tous ces médiocres littérateurs régionaux dans une satire rimée au vitriol. Mais ses mots naissent paralysés ou morts dans les boursouflures d’orgueil. Octavio Paz le lui avait bien dit dans sa lettre: «Avant de prendre la plume, il faut attendre la germination du silence». La colère ne fait qu’assécher la source profonde du chant. Un mauvais poème donnerait des armes à l’ennemi. Mieux vaut le jeter. Dès lors tout s’enchaîne pour le pire. Sa vie de famille se défait. Il sombre dans le bovarysme. Il en veut à sa fille, à sa femme, à cette vie qui l’empêche d’exprimer son génie en le retenant aux rives lénifiantes de la normalité, c’est-à-dire de la médiocrité. Il ne lui reste plus qu’à encaisser les baffes de l’humiliation comme un clown impuissant, et à plonger sa disgrâce dans le mauvais alcool de bars minables, aussi seul qu’un rat noyé dans les latrines. Jusqu’à ce qu’il lui vienne une idée: pourquoi ne pas téléphoner à Octavio Paz sous le prétexte de lui demander une recommandation? Cette nouvelle preuve remplacerait la lettre déficiente. Un ami journaliste lui fournit le numéro du maître. Qui est en conférence à New-York. Tant pis, on précise tout de même à son secrétaire la nature de notre requête et on rappellera la semaine prochaine. Commence alors une étrange convergence de destins, une chaîne d’événements tragiques traçant un parallèle entre la vie du maître et celle de notre poète de province. Une chaîne qui empêche, avec un entêtement ironique, ce contact salvateur qui, seul, lui permettrait de restaurer son honneur perdu. D’abord, l’appartement d’Octavio Paz brûle. Puis les journaux annoncent que le maître est atteint d’un cancer, qu’il est admis à l’hôpital pour y suivre une chimiothérapie. Il tente un ultime baroud d’honneur pour approcher son sauveur lors de l’inauguration d’une fondation culturelle au nom du grand écrivain. Une cérémonie très officielle, en compagnie du président Zedillo et de tout le gratin, où il ne fait que se ridiculiser davantage. Alors, seulement, il abdique son orgueil. Au fond du ridicule, de l’humiliation, il retrouve sa sérénité. De retour chez lui, il demande pardon, en larmes, à sa fille, à sa femme, qui lui annonce triomphante que don Octavio, malgré ses malheurs, sa maladie, a finalement pris le temps de lui envoyer la fameuse lettre de recommandation. De laquelle il ressort clairement que le grand génie reconnaît ce nouveau talent de la poésie mexicaine. Honneur lavé! Les mots du souverain pontife lui donnent enfin la possibilité de piétiner la vermine du Parnasse local, de savourer les plates excuses de tous ces vermisseaux du vers, ces mirlitons de la rime, qui vont bientôt faire la queue pour lui lécher la semelle. Honneurs, prix, postes publics bien rémunérés, hommages présidentiels, gloire internationale, statues de bronze, rues portant son nom…
Non! Car dans son orgueil piétiné, le narrateur a compris que la poésie est un royaume spirituel, non pas une cour avec rois et chambellans. Il fait jurer à sa femme de ne jamais dire un mot à quiconque de cette lettre. Deux nuits plus tard, la tête sur l’oreiller, il entend à nouveau ce grondement qu’il avait oublié dans les vapeurs de sa vanité blessée, le fameux grondement qui annonce la germination du silence…
![ecrivain1[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/02/00/2436431346.jpg)
![pingeon[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/02/01/2441800981.jpg)
 PAR ANTONIN MOERI
PAR ANTONIN MOERI 
 Il y a une ambition globalisante dans Après la comète, le dernier recueil de poèmes d’Olivier Beetschen.
Il y a une ambition globalisante dans Après la comète, le dernier recueil de poèmes d’Olivier Beetschen.