Par Pierre Béguin


Qu’est-ce qui différencie une biographie sur les Rolling Stones écrite par François Bon des dizaines, voire des centaines d’autres déjà parues?
Tout. Et c’est ce que nous allons démontrer.
Le style d’abord, celui d’un écrivain, un vrai (et non pas du traditionnel journaliste de service), constituerait en soi une raison suffisante, même pour ceux qui n’ont jamais compté parmi les fans des Rolling Stones (c’est mon cas), de se lancer dans ce millier de pages passionnantes retraçant de manière exhaustive et minutieuse la construction d’une légende déjà solidement ancrée dans nos mythologies modernes: l’histoire romanesque du plus grand groupe de rock.
Car là réside surtout l’objectif de François Bon: interroger notre mythologie, celle des générations dont les repères, depuis les 60’s, sont intimement (exclusivement?) liés à la musique rock, de ses sources à ses prolongements (après les Rolling Stones, il s’attaquera à d’autres légendes comme Led Zeppelin et Bob Dylan).
Interrogation sur les mythologies modernes, donc, mais aussi questionnement sur le processus de création et ses alchimies mystérieuses qu’il cherche à saisir, le travail de François Bon va bien au-delà de l’alignement des faits, des potins d’arrière-boutique ou autres pseudo révélations. Jamais hagiographique, ni dithyrambe ni palinodie, la biographie construit patiemment, détail par détail, jusqu’à l’élaboration du mythe, ce destin exceptionnel, sans cesse secoué par les scandales (sexe, alcool, drogue), où ceux qui s’inondent de gloire oublient avec une indifférence stupéfiante les victimes qu’ils ont contribué à fabriquer (Brian Jones, mais aussi Gram Pearsons (The Byrds), Ian Stewart, le Sixième Stone, et bien d’autres dans cette énorme constellation Rolling Stones qui pouvait inclure des musiciens comme Eric Clapton, Jimmy Page, Ry Cooder ou Ian MacLagan), ou simplement laissent sans scrupule au bord du chemin, après les avoir pressés jusqu’au trognon, les indésirables, les désormais inutiles ou les concurrents qui auraient pu faire de l’ombre aux rois Richards et Jagger (les procès contre le groupe pour «vol artistique» furent nombreux, à commencer par Mick Taylor, le successeur de Brian Jones avant Ron Wood). Les glimmer twins, décidément, sont des types dangereux pour qui s’accrochent à eux. Mais le mythe est aussi à ce prix.
Au prix également de nombreuses distorsions de vérités, conscientes ou non, que les membres du groupe et leur entourage proche créent et entretiennent à foison, au point que tous se rapportent spontanément, lors d’interviews, à ces récits extérieurs plutôt qu’à leur mémoire personnelle. Ainsi la légende prend-elle le pas sur la réalité, compliquant à l’extrême la tâche du biographe. François Bon effectue là un travail de bénédictin pour démêler le vrai du faux, mettant en scène sa propre enquête et édictant les règles même du genre qu’il rénove en l’investissant: «Le biographe doit composer avec ces traces éloignées, les rapporter à la comptabilité et la chronologie des télégrammes et billets d’avions (…) et savoir ce qui, dans le flou des versions, quand ce flou est entretenu par le protagoniste lui-même, ramène un peu de visible et de concret ». Et plus loin: «Les livres se citent les uns les autres et les protagonistes eux-mêmes, quand on les interroge, répéteront ces versions existantes, sur la foi de l’imprimé». Preuve qu’on n’est pas forcément soi-même le meilleur dépositaire en mémoire de ce qu’on représente. Et obstacle supplémentaire à surmonter pour cette rareté qu’est le biographe consciencieux: qui croire si l’on ne peut se fier ni aux principaux protagonistes, ni aux témoignages des proches, ni aux livres déjà imprimés sur le sujet? Ainsi le doute, la mise à distance, la suspicion sont-ils compagnons inséparables du biographe honnête, et François Bon n’hésite pas à les exposer: «Pas question de prendre ces assertions pour parole d’évangile».
 Deux anecdotes parmi des dizaines d’autres qui soulignent cette tâche monstrueuse. Pour témoigner de la tournée américaine de 1972, les Stones demandent à un journaliste (Robert Greenfield), un cinéaste (Robert Frank) et un écrivain (Truman Capote) d’inscrire la tournée dans la légende, comme Louis XIV demandait à Racine et à Boileau de fabriquer son Histoire. Le groupe (Charlie Watts et Bill Wyman se sont distancés de ces provocations infantiles) va alors s’ingénier à pratiquer l’excès systématique simplement parce qu’il a payé un écrivain pour le raconter et un cinéaste pour le filmer. Tel ce soir où Truman Capote les a rejoints au Kansas, accompagné par la sœur de Jackie Onassis, une princesse Lee Radziwill, qui partage sa chambre. Comme par hasard, une caméra a été installée dans le couloir quand Keith Richards cogne à la porte au milieu de la nuit en beuglant: «Princess Radish, come on! you old tart, there’s a party downstairs». Capote n’ouvre pas. Les autres font alors éclater des boîtes de concentré de tomates sur la porte…
Deux anecdotes parmi des dizaines d’autres qui soulignent cette tâche monstrueuse. Pour témoigner de la tournée américaine de 1972, les Stones demandent à un journaliste (Robert Greenfield), un cinéaste (Robert Frank) et un écrivain (Truman Capote) d’inscrire la tournée dans la légende, comme Louis XIV demandait à Racine et à Boileau de fabriquer son Histoire. Le groupe (Charlie Watts et Bill Wyman se sont distancés de ces provocations infantiles) va alors s’ingénier à pratiquer l’excès systématique simplement parce qu’il a payé un écrivain pour le raconter et un cinéaste pour le filmer. Tel ce soir où Truman Capote les a rejoints au Kansas, accompagné par la sœur de Jackie Onassis, une princesse Lee Radziwill, qui partage sa chambre. Comme par hasard, une caméra a été installée dans le couloir quand Keith Richards cogne à la porte au milieu de la nuit en beuglant: «Princess Radish, come on! you old tart, there’s a party downstairs». Capote n’ouvre pas. Les autres font alors éclater des boîtes de concentré de tomates sur la porte…
On laissera au journaliste le soin de l’hagiographie quand le romancier, on le comprend, versera dans le pamphlet: «Mick Jagger is about as sexy as a pissing load (aussi sexy qu’une pissotière)». Mais entre les excès soigneusement mis en scène par les uns, les légitimes ressentiments et les flatteries obligées des autres, comment fixer la vérité? Ainsi de cette fille dans l’avion, durant cette même tournée, levée à bout de bras et sucée là, en plein ciel, devant quinze types, qu’on renverra par un vol commercial retour et qui finira par porter plainte (on calmera l’affaire avec un chèque). Keith Richards: «Dès que ça a été filmé, une grande partie on l’a fait comme une performance. La fille dans l’avion c’était seulement à cause de la caméra (…) Robert Frank disait: Je n’ai pas de scènes d’orgie, ou bien: Je n’ai pas de beuverie, et jusqu’à un certain point on devait les lui fournir». Le film au titre révélateur, Cocksucker blues, ne sera jamais diffusé, même si de larges extraits ont circulé sous le manteau, apportant sa petite contribution à la légende en faisant passer l’artifice pour la vérité, la provocation pour l’authenticité.
Autre particularité qui fait aussi la saveur de cette biographie: François Bon glisse des éléments autobiographiques en filigrane (c’est la mode actuellement dans le genre), des bribes de vie liées de près ou de loin aux Rolling Stones mais qui ouvrent le texte à une toute autre lecture. Voilà que notre propre biographie émerge peu à peu en négatif, celle que l’histoire du rock et de ses légendes a contaminée inévitablement. Et bientôt, à l’imposante et glorieuse biographie en majeur des Rolling Stones se substituent sur le mode mineur les souvenirs de notre enfance, de notre adolescence, et le rappel finement décrit du contexte qui les a façonnés.
Ainsi, en cette année 1974, «les équilibres du monde se sont déplacés (…) Après Exile on Main Street, moi-même ne suivais plus qu’à peine les nouveaux avatars des Rolling Stones: on découvrait cette année-là le folk, Marc Perrone me vendait à Bordeaux un accordéon diatonique, avec un magnétophone cassette à piles j’enregistrais de vieux musiciens routiniers du Poitou». Et dans cette anecdote de l’auteur sur lui-même, c’est surtout notre propre biographie qui surgit et qu’on entend se plaindre de l’oubli où on la laissée. Car dans ces mêmes années 73-74, étudiant à Londres, moi aussi je découvrais le folk dans les arrière-salles enfumées des pubs, je me condamnais au sandwich quotidien contre le disque rare chez Dobell’s folk sur Shaftsbury Avenue, ou au jeûne contre un vieux banjo d’occasion près de Tottenham Court Road, je rêvais de l’inaccessible Martin D 35 à 1850 francs (je revois encore l’étiquette), j’ignorais l’existence des premières rengaines d’ABBA, des paillettes ou du rythme naissant du disco avec ce son énorme de batterie (sorte de charleston ouvert en contretemps sous une basse qui noie tout) sur lequel pourtant je n’allais pas tarder à m’éclater. Pour l’heure, je préférais cheminer religieusement along the coaly Tyne à l’écoute des chants de mineurs de fond dont les voix rauques, accompagnées du seul Northumbrian pipe ou du tin whistle, me semblaient le gage de cette absolue authenticité musicale qu’on recherchait alors.
Dans l’arc lémanique, le festival folk d’Epalinges précédait, en date comme en renommée, celui de Nyon, futur Paléo. On y campait le vendredi et samedi (et pour mieux copier la technique de John Renbourn, on avait «emprunté» les lorgnettes maternelles réservées à l’opéra). François Bon: «Les festivals d’été sont dans leur maturité. En France, on en a de très beaux où écouter pendant trois jours, près de Vierzon ou dans le Gers, en venant simplement avec son duvet, les meilleures pointures de la musique folk (…) Je ne suis même pas sûr de l’intérêt que nous pouvions garder, ces années-là, pour nos amours d’adolescence que furent les Rolling Stones. Il était de si bon ton, déjà, de dire que les Stones n’étaient plus ce qu’ils furent».
Cest vrai! Les Rolling Stones étaient alors comme un rendez-vous clandestin avec son propre passé: inavouable, ringard, artificiel. Pour autant, la musique folk nous ayant fait redécouvrir l’art des accords ouverts (ah! l’inimitable Renbourn), on reprenait sur une guitare sèche ceux, brutaux, de Street Fightin’ Man ou du Jumpin’ Jack Flash pour épater les filles, avant de les faire craquer avec Cat Stevens ou Maxime le Forestier dans la douceur d’une maison bleue au diapason de nos désirs.
Mais qui pourrait oublier le disque hexagonal en hommage à Brian Jones (où l’on a rajouté au dernier moment Honky Tonk Woman) avec ces cinq faces écrasées contre une vitre invisible sur fond bleu? Et ces instants de nos treize ans quand, le vinyle légèrement souple posé délicatement sur le microsillon en spirale, l’aiguille abaissée doucement, mais après l’inévitable bruit criard des sillons qu’on raye, surgissait le riff de la guitare et ces paroles qui, mieux qu’aucune autre, avaient su capter l’air du temps: I can’t get no satisfaction?
Alors oui! L’histoire des Rolling Stones, c’est beaucoup celle de ces cinquante dernières années. C’est Notre histoire. Et le détour magique par ces mille pages que nous offre François Bon jusqu’à cette société normalisée et sans légende qui désormais nous gouverne, vise surtout à comprendre, avec nos armes de pensée et de langage, notre propre et modeste énigme dans un monde qui nous fut donné et que nous avons traversé comme des pierres qui roulent…
François Bon, Rolling Stones, une biographie, Livre de Poche, Fayard, 2002

 J’ai retrouvé, avec un certain plaisir narcissique, dans l’essai de Michel Onfray, La Puissance d’exister (Grasset, 2006) l’exposition et le développement de ce postulat de jeunesse que le temps n’a jamais réussi à ébranler en moi. Le philosophe ouvre son propos par un chapitre intitulé Autoportrait de l’enfant, dans lequel il rapporte l’expérience traumatisante de son entrée en orphelinat, et du sentiment d’abandon qui lui est consubstantiel («Je suis mort à l’âge de dix ans»). Non pas comme une confidence autobiographique générant pathos et compassion, mais comme le rappel du lieu même où désormais puise sa parole, s’incarne sa pensée: «L’histoire de l’être s’écrit là, avec cette encre existentielle et cette chair qui se dérobe, ce corps qui enregistre animalement la solitude, l’abandon, l’isolement, la fin du monde». Point de départ d’un réquisitoire contre la philosophie phagocytée par le platonisme, contre le fantasme de l’ontologique désincarné, réhabilitation des philosophes sceptiques et manifeste hédoniste circonscrit à des propositions philosophiques modestes mais viables, permettant d’améliorer sa propre existence là où rien n’est donné et où tout reste à construire: «Refuser de faire de la douleur et de la souffrance des voies d’accès à la connaissance et à la rédemption personnelle; se proposer le plaisir, le bonheur, l’utilité commune, le contrat jubilatoire; composer avec le corps et ne pas proposer de le détester; dompter passions et pulsions, désirs et émotions, et non les extirper brutalement de soi. L’aspiration au projet d’Epicure? Le pur plaisir d’exister… Projet toujours d’actualité».
J’ai retrouvé, avec un certain plaisir narcissique, dans l’essai de Michel Onfray, La Puissance d’exister (Grasset, 2006) l’exposition et le développement de ce postulat de jeunesse que le temps n’a jamais réussi à ébranler en moi. Le philosophe ouvre son propos par un chapitre intitulé Autoportrait de l’enfant, dans lequel il rapporte l’expérience traumatisante de son entrée en orphelinat, et du sentiment d’abandon qui lui est consubstantiel («Je suis mort à l’âge de dix ans»). Non pas comme une confidence autobiographique générant pathos et compassion, mais comme le rappel du lieu même où désormais puise sa parole, s’incarne sa pensée: «L’histoire de l’être s’écrit là, avec cette encre existentielle et cette chair qui se dérobe, ce corps qui enregistre animalement la solitude, l’abandon, l’isolement, la fin du monde». Point de départ d’un réquisitoire contre la philosophie phagocytée par le platonisme, contre le fantasme de l’ontologique désincarné, réhabilitation des philosophes sceptiques et manifeste hédoniste circonscrit à des propositions philosophiques modestes mais viables, permettant d’améliorer sa propre existence là où rien n’est donné et où tout reste à construire: «Refuser de faire de la douleur et de la souffrance des voies d’accès à la connaissance et à la rédemption personnelle; se proposer le plaisir, le bonheur, l’utilité commune, le contrat jubilatoire; composer avec le corps et ne pas proposer de le détester; dompter passions et pulsions, désirs et émotions, et non les extirper brutalement de soi. L’aspiration au projet d’Epicure? Le pur plaisir d’exister… Projet toujours d’actualité».

 Deux anecdotes parmi des dizaines d’autres qui soulignent cette tâche monstrueuse. Pour témoigner de la tournée américaine de 1972, les Stones demandent à un journaliste (Robert Greenfield), un cinéaste (Robert Frank) et un écrivain (Truman Capote) d’inscrire la tournée dans la légende, comme Louis XIV demandait à Racine et à Boileau de fabriquer son Histoire. Le groupe (Charlie Watts et Bill Wyman se sont distancés de ces provocations infantiles) va alors s’ingénier à pratiquer l’excès systématique simplement parce qu’il a payé un écrivain pour le raconter et un cinéaste pour le filmer. Tel ce soir où Truman Capote les a rejoints au Kansas, accompagné par la sœur de Jackie Onassis, une princesse Lee Radziwill, qui partage sa chambre. Comme par hasard, une caméra a été installée dans le couloir quand Keith Richards cogne à la porte au milieu de la nuit en beuglant: «Princess Radish, come on! you old tart, there’s a party downstairs». Capote n’ouvre pas. Les autres font alors éclater des boîtes de concentré de tomates sur la porte…
Deux anecdotes parmi des dizaines d’autres qui soulignent cette tâche monstrueuse. Pour témoigner de la tournée américaine de 1972, les Stones demandent à un journaliste (Robert Greenfield), un cinéaste (Robert Frank) et un écrivain (Truman Capote) d’inscrire la tournée dans la légende, comme Louis XIV demandait à Racine et à Boileau de fabriquer son Histoire. Le groupe (Charlie Watts et Bill Wyman se sont distancés de ces provocations infantiles) va alors s’ingénier à pratiquer l’excès systématique simplement parce qu’il a payé un écrivain pour le raconter et un cinéaste pour le filmer. Tel ce soir où Truman Capote les a rejoints au Kansas, accompagné par la sœur de Jackie Onassis, une princesse Lee Radziwill, qui partage sa chambre. Comme par hasard, une caméra a été installée dans le couloir quand Keith Richards cogne à la porte au milieu de la nuit en beuglant: «Princess Radish, come on! you old tart, there’s a party downstairs». Capote n’ouvre pas. Les autres font alors éclater des boîtes de concentré de tomates sur la porte… e, parce que c'est tout de même moins cher que d'aller vivre à l'hôtel».
e, parce que c'est tout de même moins cher que d'aller vivre à l'hôtel».
 Au théâtre Les Salons, du 9 au 21 décembre, se joue des Scènes de la vie de bohème sur une idée de Christof Loy. Scènes chantées en italien, sur un accompagnement au piano, avec des textes en français, et qui constituent une introduction idéale à l’œuvre de Puccini, et à celle d’Henry Murger par la même occasion.
Au théâtre Les Salons, du 9 au 21 décembre, se joue des Scènes de la vie de bohème sur une idée de Christof Loy. Scènes chantées en italien, sur un accompagnement au piano, avec des textes en français, et qui constituent une introduction idéale à l’œuvre de Puccini, et à celle d’Henry Murger par la même occasion.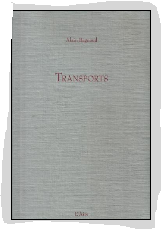 A quelle posture nous contraint la lecture de Transports, le dernier livre d’Alain Bagnoud? Au fil des textes qui se succèdent, et dont le rythme est donné par la juxtaposition d’instantanés, nous accompagnons des poses, des faits, des paroles, des gestes en apparence anodins.
A quelle posture nous contraint la lecture de Transports, le dernier livre d’Alain Bagnoud? Au fil des textes qui se succèdent, et dont le rythme est donné par la juxtaposition d’instantanés, nous accompagnons des poses, des faits, des paroles, des gestes en apparence anodins. Qui parle? Qui est ce «je» désabusé faisant une sorte de bilan de sa vie au travers du portrait de ses semblables, de la masse desquels il n’est pas parvenu à s’extraire comme ses rêves de jeunesse l’avaient imaginé? Un écrivain déçu, un professeur désillusionné, un bourgeois qui s’encanaille dans les zones floues des transports publics où s’agglutine les laissés-pour-compte, les marginaux, les hors normes, un propriétaire de vignes qui se donne bonne conscience en feignant l’empathie envers les déshérités ou les mendiants roms pour s’en dédouaner aussitôt: «Moi, je suis un nanti et je trouve, par confort, que la charité est égoïste». Qui? Bagnoud bien sûr, mais aussi vous, moi, tout le monde. Avoue-le! Tu ne la voyais pas comme ça, ta vie!
Qui parle? Qui est ce «je» désabusé faisant une sorte de bilan de sa vie au travers du portrait de ses semblables, de la masse desquels il n’est pas parvenu à s’extraire comme ses rêves de jeunesse l’avaient imaginé? Un écrivain déçu, un professeur désillusionné, un bourgeois qui s’encanaille dans les zones floues des transports publics où s’agglutine les laissés-pour-compte, les marginaux, les hors normes, un propriétaire de vignes qui se donne bonne conscience en feignant l’empathie envers les déshérités ou les mendiants roms pour s’en dédouaner aussitôt: «Moi, je suis un nanti et je trouve, par confort, que la charité est égoïste». Qui? Bagnoud bien sûr, mais aussi vous, moi, tout le monde. Avoue-le! Tu ne la voyais pas comme ça, ta vie!![rolin80[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/02/01/3831775332.jpg) Le roman d’Olivier Rolin, Un Chasseur de lion, appartient à un pan important de la littérature moderne depuis trois décennies: la fiction biographique, ensemble qui repose sur un personnage historique avéré, en l’occurrence «le vaste et rubicond Pertuiset», tour à tour et à la fois chasseur de lions, trafiquant d’armes, aventurier et, accessoirement, ami du peintre Manet. Ces caractéristiques très composites du héros Pertuiset ouvrent les multiples dimensions et registres de ce récit baroque qui se mélangent et se font écho.
Le roman d’Olivier Rolin, Un Chasseur de lion, appartient à un pan important de la littérature moderne depuis trois décennies: la fiction biographique, ensemble qui repose sur un personnage historique avéré, en l’occurrence «le vaste et rubicond Pertuiset», tour à tour et à la fois chasseur de lions, trafiquant d’armes, aventurier et, accessoirement, ami du peintre Manet. Ces caractéristiques très composites du héros Pertuiset ouvrent les multiples dimensions et registres de ce récit baroque qui se mélangent et se font écho.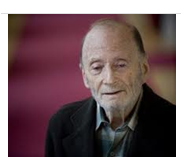 «Je pense que, aujourd’hui, on ne peut pas comprendre le monde, notre relation au monde, par le tragique.» Cette phrase de Michel Vinaver m’est revenue en mémoire durant les multiples commémorations du 10e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, notamment lors des nombreuses diffusions sur toutes les chaînes de télévision de reportages qui insistaient parfois un peu lourdement sur la pathos et le tragique des événements, là où l’on aurait souhaité peut-être davantage de recul.
«Je pense que, aujourd’hui, on ne peut pas comprendre le monde, notre relation au monde, par le tragique.» Cette phrase de Michel Vinaver m’est revenue en mémoire durant les multiples commémorations du 10e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, notamment lors des nombreuses diffusions sur toutes les chaînes de télévision de reportages qui insistaient parfois un peu lourdement sur la pathos et le tragique des événements, là où l’on aurait souhaité peut-être davantage de recul.![murakami[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/02/02/3662993828.jpg) Haruki Murakami, auquel même la Tribune de Genève de ce week end consacre une page pour la parution de son dernier roman, s’impose de plus en plus comme la nouvelle référence asiatique en occident. «Nobelisable» depuis plusieurs années, traducteur de Scott Fitzgerald et Raymond Carver, l’écrivain japonais cultive cette caractéristique insolite: il partage son temps entre l’écriture et la course de fond, s’imposant au moins un grand marathon (New-York, Boston ou Tokyo) par année. Si l’écriture l’a amené au sport – assis la plupart du temps, il fumait à outrance et prenait du poids – le sport ne cesse de le renvoyer à l’écriture. C’est le motif principal de son traité de sagesse original intitulé Autoportrait de l’auteur en coureur de fond, paru en 2007 (en 2009 chez Belfond pour la traduction française). Courir devient une métaphore du travail d’écrivain, non seulement en termes d’endurance, de persévérance, de patience (il faut aussi ces qualités pour écrire un roman) mais en termes d’hygiène de vie, de santé physique et, surtout, mentale.
Haruki Murakami, auquel même la Tribune de Genève de ce week end consacre une page pour la parution de son dernier roman, s’impose de plus en plus comme la nouvelle référence asiatique en occident. «Nobelisable» depuis plusieurs années, traducteur de Scott Fitzgerald et Raymond Carver, l’écrivain japonais cultive cette caractéristique insolite: il partage son temps entre l’écriture et la course de fond, s’imposant au moins un grand marathon (New-York, Boston ou Tokyo) par année. Si l’écriture l’a amené au sport – assis la plupart du temps, il fumait à outrance et prenait du poids – le sport ne cesse de le renvoyer à l’écriture. C’est le motif principal de son traité de sagesse original intitulé Autoportrait de l’auteur en coureur de fond, paru en 2007 (en 2009 chez Belfond pour la traduction française). Courir devient une métaphore du travail d’écrivain, non seulement en termes d’endurance, de persévérance, de patience (il faut aussi ces qualités pour écrire un roman) mais en termes d’hygiène de vie, de santé physique et, surtout, mentale.