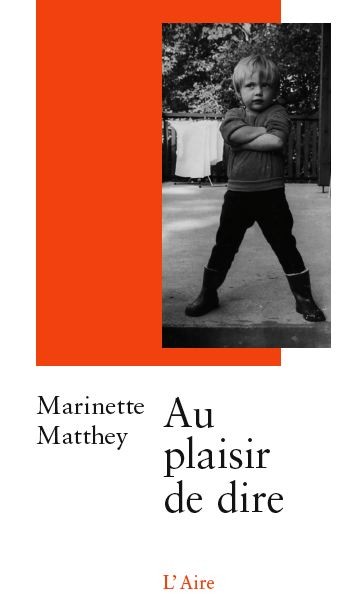Violence des jeunes: des solutions
Par Alain Bagnoud
 Donc, Sarkozy va fouiller les cartables. Ah, ça va y aller! Vous allez voir ça! Ceux qui auront des trucs dangereux, des compas et des ciseaux et des crayons trop bien taillés, tout de suite en garde à vue!
Donc, Sarkozy va fouiller les cartables. Ah, ça va y aller! Vous allez voir ça! Ceux qui auront des trucs dangereux, des compas et des ciseaux et des crayons trop bien taillés, tout de suite en garde à vue!
Et ce n'est pas la seule mesure du président qui sort toujours la même panoplie quand il veut gagner une élection (cette fois, c'est les européennes): il va te me les nettoyer, les banlieues! Il en a 25 sous les yeux, et ça va chauffer. « Aucune rue, aucune cave, aucune cage d'escalier ne doit être abandonnée aux petits voyous cupides. Nous ne les laisserons pas persécuter les travailleurs honnêtes et courageux. »
Le Kärcher n'est plus de mise, ça n'a pas marché. Ce qui va se passer, c'est que des agents du fisc vont repérer les signes de richesse anormaux qui vont les mener directement aux trafiquants. Si tu as une Rolex en banlieue, tu es foutu.
Bon, c'est de la gesticulation, d'accord. Mais il y a quand même une question intéressante derrière tout ça: la violence des jeunes. Il est indéniable qu'elle a augmenté. C'est ce que dit en tout cas le prudent Département fédéral de justice et police suisse: « Les statistiques ne permettent pas aujourd’hui de tirer des conclusions exactes quant à l’ampleur de ce phénomène, car elles ne révèlent pas le "chiffre noir" de la criminalité juvénile. Mais elles laissent néanmoins apparaître que la propension des jeunes à la violence s’est effectivement amplifiée. »
La faute évidemment à un quart de siècle de libéralisme, dont le message est clair: dans une société régie par ses règles, seuls les plus forts peuvent réussir, et c'est en écrasant les faibles.
Que voulez-vous? Quand tout, et jusqu'à l'hyperprésident cité plus haut vous le proclame et vous le répète sans cesse, vous finissez par agir en conséquence.
Il est temps, donc, de rappeler une vérité essentielle, qu'avait développée dans un livre Philippe Cotter, docteur en relations internationales. Ce qui suscite la violence est une chose simple et bien définie: le sentiment d'être humilié.
Et je ne suis pas sûr que Sarkozy et tous les va-t-en-guerre sécuritaires soient en train d'en diminuer les causes.
Philippe Cotter, Gilbert Holleufer, La vengeance des humiliés, Editions Eclectica
(Publié aussi dans Le blog d'Alain Bagnoud.)

![huysmans[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/01/01/1168405732.jpg) riture. Fugace. Météorite. Heureusement! Elle n’était pas de moi, cette idée. J’aurais eu l’air de quoi?
riture. Fugace. Météorite. Heureusement! Elle n’était pas de moi, cette idée. J’aurais eu l’air de quoi?