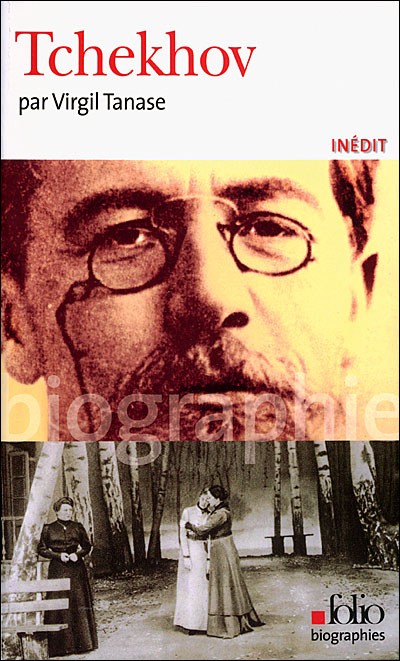Par Pierre Béguin
![murger[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/00/01/3472858476.jpg) Le roman d’Henry Murger (1851) – qui n’est pas un roman, précise l’auteur, mais de petites histoires, des scènes – malgré le succès qu’il connut à sa parution, dans les journaux d’abord, puis en recueil, est largement oublié de nos jours, éclipsé dès la fin du 19e siècle par l’opéra de Puccini, La Bohème (1896), qui s’est alors approprié à lui seul ce répertoire emblématique du romantisme. Oubli regrettable à plus d’un titre. Non seulement parce que l’opéra en est l’adaptation – ou plutôt l’adaptation de l’adaptation, puisque le livret s’inspire non du texte original de Murger mais de la pièce, La Vie de bohème, que ce dernier en a tirée en collaboration avec Théodore Barrière. Non seulement parce que sa préface, prolégomènes semés de noms célèbres, des ménestrels en passant par Villon, Marot, Rabelais, Shakespeare et Molière, tous illustres bohémiens, nous fait mieux comprendre la genèse de la bohème et son importance historique et artistique. Mais surtout parce que, même à notre époque où la bohème délaisse la mansarde pour le squat, le charme de ces petites scènes opère toujours avec cette magie qui leur avait valu l’admiration de tous les écrivains contemporains, et la reconnaissance de Victor Hugo. Si les quatre personnages principaux, sortes de mousquetaires des arts, Rodolphe le poète, Schaunard le musicien, Marcel le peintre et Gustave Colline le philosophe, ressemblent davantage à des caricatures qu’à des constructions psychologiques réalistes (ils pourraient être en ce sens les ancêtres des Pieds Nickelés ou de Bibi Fricotin), les véritables protagonistes sont surtout les instances sociales emblématiques de la vie de bohème à l’intérieur desquelles se meuvent les personnages: la mansarde, le café, l’atelier, la rue, l’hôpital… Et Murger, avec une lucidité clinique derrière le masque de l’humour et de la légèreté qui enrobe plaisamment le désespoir, montre superbement comment, d’une génération l’autre, la notion même de bohème a évolué entre 1830 et 1850. Si les Dumas, Nodier, Petrus Borel, Gautier, Nerval donnaient au romantisme un souffle nouveau dans l’atmosphère fervente de l’impasse du Doyenné (où habitaient Gautier et Nerval), un souffle qui trouvait dans la bataille d’Hernani son sens et sa légitimation, la génération suivante, celle décrite par Murger, s’est retrouvée aliénée par une morale publique qui a envoyé Baudelaire et Flaubert devant le tribunaux, livrée à elle-même, sans convictions ni croyances, sans autres horizons qu’un ciel désespérément vide au dessus d’une bohème menant inéluctablement en enfer pour peu que la Muse de l’artiste ne se pliât aux exigences du marché. Pas de liberté ni de bonheur dans cette bohème mais une errance subie qui n’offre d’autres issues pour sortir de la jeunesse que la mort prématurée ou l’embourgeoisement. Soit le destin de Jacques, le sculpteur, qui meurt avant trente ans, inconnu et solitaire, à l’hôpital, soit celui de Rodolphe qui se sauve de la bohème parce qu’il a compris, comme Rastignac, qu’il fallait impérativement, pour survivre, trahir sa jeunesse et perdre ses illusions. Bien plus que la chronique humoristique d’une époque, Henry Murger a écrit une profonde méditation sur la jeunesse et la fin de la jeunesse. Sur un mode mineur certes, Scènes de la vie de bohème rejoint les grands romans d’apprentissage du 19e siècle et vaut largement qu’on le lise. Et qu’on découvre – ou redécouvre – dans la foulée tous ceux qui, dans le siècle de la bourgeoisie, ont chanté la bohème avec Henry Murger, entre autres Charles Nodier (Histoire du roi de Bohème et de ses sept châteaux), Balzac (Un prince de la bohème), Rimbaud (Ma Bohème), Huysmans (A rebours). On comprendra mieux alors – ou l’on se rappellera – ce qu’est vraiment la bohème et pourquoi elle est étape essentielle de notre vie, comme l’a si bien chanté Charles Aznavour qui, dans sa fameuse et très belle chanson, en a repris tous les stéréotypes:
Le roman d’Henry Murger (1851) – qui n’est pas un roman, précise l’auteur, mais de petites histoires, des scènes – malgré le succès qu’il connut à sa parution, dans les journaux d’abord, puis en recueil, est largement oublié de nos jours, éclipsé dès la fin du 19e siècle par l’opéra de Puccini, La Bohème (1896), qui s’est alors approprié à lui seul ce répertoire emblématique du romantisme. Oubli regrettable à plus d’un titre. Non seulement parce que l’opéra en est l’adaptation – ou plutôt l’adaptation de l’adaptation, puisque le livret s’inspire non du texte original de Murger mais de la pièce, La Vie de bohème, que ce dernier en a tirée en collaboration avec Théodore Barrière. Non seulement parce que sa préface, prolégomènes semés de noms célèbres, des ménestrels en passant par Villon, Marot, Rabelais, Shakespeare et Molière, tous illustres bohémiens, nous fait mieux comprendre la genèse de la bohème et son importance historique et artistique. Mais surtout parce que, même à notre époque où la bohème délaisse la mansarde pour le squat, le charme de ces petites scènes opère toujours avec cette magie qui leur avait valu l’admiration de tous les écrivains contemporains, et la reconnaissance de Victor Hugo. Si les quatre personnages principaux, sortes de mousquetaires des arts, Rodolphe le poète, Schaunard le musicien, Marcel le peintre et Gustave Colline le philosophe, ressemblent davantage à des caricatures qu’à des constructions psychologiques réalistes (ils pourraient être en ce sens les ancêtres des Pieds Nickelés ou de Bibi Fricotin), les véritables protagonistes sont surtout les instances sociales emblématiques de la vie de bohème à l’intérieur desquelles se meuvent les personnages: la mansarde, le café, l’atelier, la rue, l’hôpital… Et Murger, avec une lucidité clinique derrière le masque de l’humour et de la légèreté qui enrobe plaisamment le désespoir, montre superbement comment, d’une génération l’autre, la notion même de bohème a évolué entre 1830 et 1850. Si les Dumas, Nodier, Petrus Borel, Gautier, Nerval donnaient au romantisme un souffle nouveau dans l’atmosphère fervente de l’impasse du Doyenné (où habitaient Gautier et Nerval), un souffle qui trouvait dans la bataille d’Hernani son sens et sa légitimation, la génération suivante, celle décrite par Murger, s’est retrouvée aliénée par une morale publique qui a envoyé Baudelaire et Flaubert devant le tribunaux, livrée à elle-même, sans convictions ni croyances, sans autres horizons qu’un ciel désespérément vide au dessus d’une bohème menant inéluctablement en enfer pour peu que la Muse de l’artiste ne se pliât aux exigences du marché. Pas de liberté ni de bonheur dans cette bohème mais une errance subie qui n’offre d’autres issues pour sortir de la jeunesse que la mort prématurée ou l’embourgeoisement. Soit le destin de Jacques, le sculpteur, qui meurt avant trente ans, inconnu et solitaire, à l’hôpital, soit celui de Rodolphe qui se sauve de la bohème parce qu’il a compris, comme Rastignac, qu’il fallait impérativement, pour survivre, trahir sa jeunesse et perdre ses illusions. Bien plus que la chronique humoristique d’une époque, Henry Murger a écrit une profonde méditation sur la jeunesse et la fin de la jeunesse. Sur un mode mineur certes, Scènes de la vie de bohème rejoint les grands romans d’apprentissage du 19e siècle et vaut largement qu’on le lise. Et qu’on découvre – ou redécouvre – dans la foulée tous ceux qui, dans le siècle de la bourgeoisie, ont chanté la bohème avec Henry Murger, entre autres Charles Nodier (Histoire du roi de Bohème et de ses sept châteaux), Balzac (Un prince de la bohème), Rimbaud (Ma Bohème), Huysmans (A rebours). On comprendra mieux alors – ou l’on se rappellera – ce qu’est vraiment la bohème et pourquoi elle est étape essentielle de notre vie, comme l’a si bien chanté Charles Aznavour qui, dans sa fameuse et très belle chanson, en a repris tous les stéréotypes:
La bohème, c’est la jeunesse, pas moins de vingt ans, pas plus de trente ans…
La bohème, c’est la vie d’artiste…
La bohème, c’est l’art comme religion et non comme moyen…
La bohème, c’est vivre la nuit et manger à la table du hasard…
La bohème, c’est la poésie, la peinture, la musique…
La bohème, c’est la mansarde, l’atelier, le bistrot…
La bohème, c’est l’amour, l’eau fraîche, la liberté…
La bohème, c’est l’insouciance, l’imprévu, le bonheur…
La bohème, c’est l’errance, la marginalité, le refus des règles…
La bohème, c’est l’inconscience, l’illusion, l’opportunisme…
La bohème, c’est l’aliénation, le vide, le désespoir…
La bohème, c’est la misère, le froid, la famine…
La bohème, c’est la contrainte, la prison, la mort…
La bohème, c’est l’encanaillement avant l’embourgeoisement…
La bohème, c’est refuser d’être notaire toute sa vie pour mieux supporter l’idée d’être notaire toute sa vie…
La bohème, c’est avoir la nostalgie de la bohème…
La bohème, c’est raconter à ses enfants, le soir, au coin d’un feu, après un bon repas, sa vie d’artiste miséreux ou de jeune marginal qui a fini par comprendre les nécessités de l’existence…
La bohème, c’est l’essence même du romantisme, le romantisme l’essence même de la jeunesse, la jeunesse l’essence même de la vie…
La bohème, c’est donc la vie… La vie de bohème

![murger[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/00/01/3472858476.jpg) Le roman d’Henry Murger (1851) – qui n’est pas un roman, précise l’auteur, mais de petites histoires, des scènes – malgré le succès qu’il connut à sa parution, dans les journaux d’abord, puis en recueil, est largement oublié de nos jours, éclipsé dès la fin du 19e siècle par l’opéra de Puccini, La Bohème (1896), qui s’est alors approprié à lui seul ce répertoire emblématique du romantisme. Oubli regrettable à plus d’un titre. Non seulement parce que l’opéra en est l’adaptation – ou plutôt l’adaptation de l’adaptation, puisque le livret s’inspire non du texte original de Murger mais de la pièce, La Vie de bohème, que ce dernier en a tirée en collaboration avec Théodore Barrière. Non seulement parce que sa préface, prolégomènes semés de noms célèbres, des ménestrels en passant par Villon, Marot, Rabelais, Shakespeare et Molière, tous illustres bohémiens, nous fait mieux comprendre la genèse de la bohème et son importance historique et artistique. Mais surtout parce que, même à notre époque où la bohème délaisse la mansarde pour le squat, le charme de ces petites scènes opère toujours avec cette magie qui leur avait valu l’admiration de tous les écrivains contemporains, et la reconnaissance de Victor Hugo. Si les quatre personnages principaux, sortes de mousquetaires des arts, Rodolphe le poète, Schaunard le musicien, Marcel le peintre et Gustave Colline le philosophe, ressemblent davantage à des caricatures qu’à des constructions psychologiques réalistes (ils pourraient être en ce sens les ancêtres des Pieds Nickelés ou de Bibi Fricotin), les véritables protagonistes sont surtout les instances sociales emblématiques de la vie de bohème à l’intérieur desquelles se meuvent les personnages: la mansarde, le café, l’atelier, la rue, l’hôpital… Et Murger, avec une lucidité clinique derrière le masque de l’humour et de la légèreté qui enrobe plaisamment le désespoir, montre superbement comment, d’une génération l’autre, la notion même de bohème a évolué entre 1830 et 1850. Si les Dumas, Nodier, Petrus Borel, Gautier, Nerval donnaient au romantisme un souffle nouveau dans l’atmosphère fervente de l’impasse du Doyenné (où habitaient Gautier et Nerval), un souffle qui trouvait dans la bataille d’Hernani son sens et sa légitimation, la génération suivante, celle décrite par Murger, s’est retrouvée aliénée par une morale publique qui a envoyé Baudelaire et Flaubert devant le tribunaux, livrée à elle-même, sans convictions ni croyances, sans autres horizons qu’un ciel désespérément vide au dessus d’une bohème menant inéluctablement en enfer pour peu que la Muse de l’artiste ne se pliât aux exigences du marché. Pas de liberté ni de bonheur dans cette bohème mais une errance subie qui n’offre d’autres issues pour sortir de la jeunesse que la mort prématurée ou l’embourgeoisement. Soit le destin de Jacques, le sculpteur, qui meurt avant trente ans, inconnu et solitaire, à l’hôpital, soit celui de Rodolphe qui se sauve de la bohème parce qu’il a compris, comme Rastignac, qu’il fallait impérativement, pour survivre, trahir sa jeunesse et perdre ses illusions. Bien plus que la chronique humoristique d’une époque, Henry Murger a écrit une profonde méditation sur la jeunesse et la fin de la jeunesse. Sur un mode mineur certes, Scènes de la vie de bohème rejoint les grands romans d’apprentissage du 19e siècle et vaut largement qu’on le lise. Et qu’on découvre – ou redécouvre – dans la foulée tous ceux qui, dans le siècle de la bourgeoisie, ont chanté la bohème avec Henry Murger, entre autres Charles Nodier (Histoire du roi de Bohème et de ses sept châteaux), Balzac (Un prince de la bohème), Rimbaud (Ma Bohème), Huysmans (A rebours). On comprendra mieux alors – ou l’on se rappellera – ce qu’est vraiment la bohème et pourquoi elle est étape essentielle de notre vie, comme l’a si bien chanté Charles Aznavour qui, dans sa fameuse et très belle chanson, en a repris tous les stéréotypes:
Le roman d’Henry Murger (1851) – qui n’est pas un roman, précise l’auteur, mais de petites histoires, des scènes – malgré le succès qu’il connut à sa parution, dans les journaux d’abord, puis en recueil, est largement oublié de nos jours, éclipsé dès la fin du 19e siècle par l’opéra de Puccini, La Bohème (1896), qui s’est alors approprié à lui seul ce répertoire emblématique du romantisme. Oubli regrettable à plus d’un titre. Non seulement parce que l’opéra en est l’adaptation – ou plutôt l’adaptation de l’adaptation, puisque le livret s’inspire non du texte original de Murger mais de la pièce, La Vie de bohème, que ce dernier en a tirée en collaboration avec Théodore Barrière. Non seulement parce que sa préface, prolégomènes semés de noms célèbres, des ménestrels en passant par Villon, Marot, Rabelais, Shakespeare et Molière, tous illustres bohémiens, nous fait mieux comprendre la genèse de la bohème et son importance historique et artistique. Mais surtout parce que, même à notre époque où la bohème délaisse la mansarde pour le squat, le charme de ces petites scènes opère toujours avec cette magie qui leur avait valu l’admiration de tous les écrivains contemporains, et la reconnaissance de Victor Hugo. Si les quatre personnages principaux, sortes de mousquetaires des arts, Rodolphe le poète, Schaunard le musicien, Marcel le peintre et Gustave Colline le philosophe, ressemblent davantage à des caricatures qu’à des constructions psychologiques réalistes (ils pourraient être en ce sens les ancêtres des Pieds Nickelés ou de Bibi Fricotin), les véritables protagonistes sont surtout les instances sociales emblématiques de la vie de bohème à l’intérieur desquelles se meuvent les personnages: la mansarde, le café, l’atelier, la rue, l’hôpital… Et Murger, avec une lucidité clinique derrière le masque de l’humour et de la légèreté qui enrobe plaisamment le désespoir, montre superbement comment, d’une génération l’autre, la notion même de bohème a évolué entre 1830 et 1850. Si les Dumas, Nodier, Petrus Borel, Gautier, Nerval donnaient au romantisme un souffle nouveau dans l’atmosphère fervente de l’impasse du Doyenné (où habitaient Gautier et Nerval), un souffle qui trouvait dans la bataille d’Hernani son sens et sa légitimation, la génération suivante, celle décrite par Murger, s’est retrouvée aliénée par une morale publique qui a envoyé Baudelaire et Flaubert devant le tribunaux, livrée à elle-même, sans convictions ni croyances, sans autres horizons qu’un ciel désespérément vide au dessus d’une bohème menant inéluctablement en enfer pour peu que la Muse de l’artiste ne se pliât aux exigences du marché. Pas de liberté ni de bonheur dans cette bohème mais une errance subie qui n’offre d’autres issues pour sortir de la jeunesse que la mort prématurée ou l’embourgeoisement. Soit le destin de Jacques, le sculpteur, qui meurt avant trente ans, inconnu et solitaire, à l’hôpital, soit celui de Rodolphe qui se sauve de la bohème parce qu’il a compris, comme Rastignac, qu’il fallait impérativement, pour survivre, trahir sa jeunesse et perdre ses illusions. Bien plus que la chronique humoristique d’une époque, Henry Murger a écrit une profonde méditation sur la jeunesse et la fin de la jeunesse. Sur un mode mineur certes, Scènes de la vie de bohème rejoint les grands romans d’apprentissage du 19e siècle et vaut largement qu’on le lise. Et qu’on découvre – ou redécouvre – dans la foulée tous ceux qui, dans le siècle de la bourgeoisie, ont chanté la bohème avec Henry Murger, entre autres Charles Nodier (Histoire du roi de Bohème et de ses sept châteaux), Balzac (Un prince de la bohème), Rimbaud (Ma Bohème), Huysmans (A rebours). On comprendra mieux alors – ou l’on se rappellera – ce qu’est vraiment la bohème et pourquoi elle est étape essentielle de notre vie, comme l’a si bien chanté Charles Aznavour qui, dans sa fameuse et très belle chanson, en a repris tous les stéréotypes: Une confrontation classique dans ce livre: le jeune noble provincial issu d'un milieu étroit, la grande dame. Il est jeune, beau, naïf, elle a quelques années de plus que lui, de l'expérience, de la rouerie. Il n'a bien entendu aucune chance.
Une confrontation classique dans ce livre: le jeune noble provincial issu d'un milieu étroit, la grande dame. Il est jeune, beau, naïf, elle a quelques années de plus que lui, de l'expérience, de la rouerie. Il n'a bien entendu aucune chance.![antonio_lobo_antunes[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/02/02/2956809343.jpg)
![perec[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/02/00/2067263762.jpg) Les Choses
Les Choses Par Alain Bagnoud
Par Alain Bagnoud Atlantique, le contraire de l'agenouillement: marche vers le neuf, agenouillement devant la polonité et la tradition.
Atlantique, le contraire de l'agenouillement: marche vers le neuf, agenouillement devant la polonité et la tradition.