BHL et moi
par Jean-Michel Olivier
 J'ai rencontré BHL en 1979, dans des circonstances particulières et peu glorieuses — pour lui. Le ministre de l'éducation de Giscard, René Haby, avait rédigé une loi (la « Loi Haby ») qui, au prétexte d'ouvrir les lycées à tout le monde, voulait supprimer les cours de philosophie des classes terminales. Bien sûr, la révolte avait grondé. Sous l'impulsion de quelques-uns (Jacques Derrida, Vladimir Jankélévitch, François Chatelet et d'autres), des Etats Généraux de la philosophie s'étaient tenus à la Sorbonne en juins 1979. Jeune étudiant (je n'avais pas 26 ans), j'y avais assisté et participé.
J'ai rencontré BHL en 1979, dans des circonstances particulières et peu glorieuses — pour lui. Le ministre de l'éducation de Giscard, René Haby, avait rédigé une loi (la « Loi Haby ») qui, au prétexte d'ouvrir les lycées à tout le monde, voulait supprimer les cours de philosophie des classes terminales. Bien sûr, la révolte avait grondé. Sous l'impulsion de quelques-uns (Jacques Derrida, Vladimir Jankélévitch, François Chatelet et d'autres), des Etats Généraux de la philosophie s'étaient tenus à la Sorbonne en juins 1979. Jeune étudiant (je n'avais pas 26 ans), j'y avais assisté et participé.
Tout se passait bien jusqu'au moment où BHL, accompagné de ses groupies, avait fait irruption dans l'auditorium et avait essayé de s'emparer du micro. Des étudiants s'étaient interposés. Et j'ai vu Derrida — par ailleurs, ancien prof de philo de BHL — furieux, descendre de l'estrade et faire le coup de poing avec l'intrus. Derrida, ancien gardien de but de foot, n'eut aucune peine à renvoyer le philosophe à la chemise blanche dans les cordes !
Et bientôt ce dernier sortit sous les huées de l'assemblée et on ne le revit plus…
Pourtant, j'ai fait l'effort de lire ses livres. Certains, d'ailleurs, sont excellents (La Pureté dangereuse). Je me suis même fait violence pour aller le trouver chez lui, Boulevard Saint-Germain, dans son modeste appartement de 300m2. J'y ai été accueilli par deux serviteurs en turban (des Sikhs) et, tandis que j'attendais dans le salon, j'ai pu entendre les vocalises d'Arielle dans la pièce d'à côté. Je l'ai donc rencontré deux fois et interviewé pour le journal La Suisse et le mensuel SCENES Magazine. Il m'a fait l'impression d'un beau parleur, une sorte de moulin à vent capable d'aborder tous les sujets, sans en connaître aucun. Mais la rencontre fut tout à fait charmante. J'eus même droit à une tasse de thé et à quelques biscuits.
Cela s'est gâté, quelques années plus tard, lors de la guerre dans les Balkans. BHL, ignorant tout de l'histoire de ces pays et de la géopolitique, prit d'emblée fait et cause pour les « sécessionnistes » (Croatie, Bosnie, etc.), gagnant à l'occasion son premier point Godwin en traitant les Serbes de nazis, et en comparant Milosevic à Hitler (depuis, il en a gagné des millions). Il oubliait (ou faisait semblait d'oublier) que les Serbes s'étaient battus férocement contre les Nazis, qu'ils avaient été arrêtés, torturés, exécutés, tandis que les fameux Oustachis croates étaient les fidèles séides des Allemands, dévolus aux basses œuvres. Mais passons. En envenimant un conflit complexe et très émotionnel, en diffusant de fausses informations, en pratiquant systématiquement le mensonge, BHL a fait beaucoup de mal aux uns comme aux autres.
 Je ne m'étendrai pas sur son rôle catastrophique dans le conflit libyen : on le connaît et d'autres ont analysé son influence néfaste (voir dossier du Monde diplomatique ici). Mais BHL aime fréquenter les grands de ce monde. Il croit pouvoir les convaincre, les aider, changer le cours de l'histoire. Au mieux, on l'écoute avec un sourire en coin. Au pire, il engendre des crimes et des injustices sans fin. Demandez aux Libyens ce qu'ils pensent de BHL, cet homme qui a précipité leur pays dans le chaos, fait assassiner son président, et semé, pour longtemps, les graines de la discorde entre les tribus du désert.
Je ne m'étendrai pas sur son rôle catastrophique dans le conflit libyen : on le connaît et d'autres ont analysé son influence néfaste (voir dossier du Monde diplomatique ici). Mais BHL aime fréquenter les grands de ce monde. Il croit pouvoir les convaincre, les aider, changer le cours de l'histoire. Au mieux, on l'écoute avec un sourire en coin. Au pire, il engendre des crimes et des injustices sans fin. Demandez aux Libyens ce qu'ils pensent de BHL, cet homme qui a précipité leur pays dans le chaos, fait assassiner son président, et semé, pour longtemps, les graines de la discorde entre les tribus du désert.
Là encore, on ne compte plus les mensonges, les images truquées, les discours délirants d'un homme qui s'est mis en tête de sauver le monde, alors qu'il cherche seulement à se sauver lui-même.  Le plus étrange, c'est qu'on le prenne encore au sérieux, tandis que chacun est au courant de son imposture (en 1978, Jacques Derrida, dont BHL a toujours cherché à se faire aimer, le traitait déjà d'imposteur). Mais s'il faut reconnaître une qualité à BHL, c'est bien la persévérance (certains diraient l'obstination).
Le plus étrange, c'est qu'on le prenne encore au sérieux, tandis que chacun est au courant de son imposture (en 1978, Jacques Derrida, dont BHL a toujours cherché à se faire aimer, le traitait déjà d'imposteur). Mais s'il faut reconnaître une qualité à BHL, c'est bien la persévérance (certains diraient l'obstination).
Je n'ai jamais revu BHL, sinon croisé furtivement en 2010, lors de la réception du Prix Interallié que j'ai reçu pour L'Amour nègre (de Fallois-l'Âge d'Homme). Il l'avait obtenu en 1988 pour Les derniers jours de Charles Baudelaire (Grasset), un très beau roman. Il connaissait tous les jurés ; je n'en connaissais aucun. On ne s'est pas parlé.
Depuis, je ne sais pas ce qu'il est devenu.
Quelqu'un a-t-il de ses nouvelles ?
 Ce qui arrive aujourd'hui à L'Hebdo (une catastrophe) est arrivé déjà à de nombreux journaux romands. Faute d'argent, le quotidien La Suisse a cessé de paraître en 1994. Le prestigieux Journal de Genève, comme son concurrent Le Nouveau Quotidien (lancé par Jacques Pilet pour torpiller le premier) a disparu en 1998 — pour se muer, tant bien que mal, dans le journal Le Temps.
Ce qui arrive aujourd'hui à L'Hebdo (une catastrophe) est arrivé déjà à de nombreux journaux romands. Faute d'argent, le quotidien La Suisse a cessé de paraître en 1994. Le prestigieux Journal de Genève, comme son concurrent Le Nouveau Quotidien (lancé par Jacques Pilet pour torpiller le premier) a disparu en 1998 — pour se muer, tant bien que mal, dans le journal Le Temps. 






 Il était temps d’intervenir!
Il était temps d’intervenir!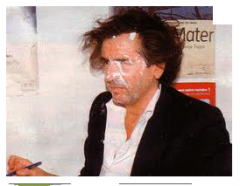 «Victime d’attentats pâtissiers /Ah! Qu’est-ce qu’il nous a fait marrer /Le philosophe des beaux quartiers /La chemise blanche en décolleté»
«Victime d’attentats pâtissiers /Ah! Qu’est-ce qu’il nous a fait marrer /Le philosophe des beaux quartiers /La chemise blanche en décolleté» entarteurs par milliers /J’vais moi-même apprendre le métier /C’est pas les cibles qui vont manquer»
entarteurs par milliers /J’vais moi-même apprendre le métier /C’est pas les cibles qui vont manquer»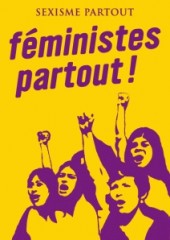 Une collègue écrivain – pardon! écrivaine –, peu après la création de «Blogres» à propos d’une note sur les quotas, m’envoyait un mail dans lequel elle précisait notamment: «Je reste rêveuse en lisant la composition de votre groupe de Blogres… Grands dieux, m’imaginerais-je qu’un beau jour vous vous êtes réunis et vous avez décrété: "pas de femmes parmi nous !" (…) Eh oui, même dans votre esprit progressiste, le masculin reste la norme».
Une collègue écrivain – pardon! écrivaine –, peu après la création de «Blogres» à propos d’une note sur les quotas, m’envoyait un mail dans lequel elle précisait notamment: «Je reste rêveuse en lisant la composition de votre groupe de Blogres… Grands dieux, m’imaginerais-je qu’un beau jour vous vous êtes réunis et vous avez décrété: "pas de femmes parmi nous !" (…) Eh oui, même dans votre esprit progressiste, le masculin reste la norme». Ainsi donc la Banque centrale européenne (BCE) a décidé de rendre l’argent moins cher en réduisant son principal taux directeur à 1%, le plus bas jamais atteint historiquement. Comme, dans le même temps, les agences de notation (américaines) s’efforcent d’abaisser la note des pays européens (même celle de l’Allemagne!), c’est donc une excellente nouvelle pour le système bancaire privé qui pourra emprunter moins cher et prêter plus cher. Il est vrai qu’après tous leurs excès et leurs âneries, leurs nécessités en recapitalisation sont (sous?) estimées à 114 milliards d’euro. Il faut bien aider les plus riches!
Ainsi donc la Banque centrale européenne (BCE) a décidé de rendre l’argent moins cher en réduisant son principal taux directeur à 1%, le plus bas jamais atteint historiquement. Comme, dans le même temps, les agences de notation (américaines) s’efforcent d’abaisser la note des pays européens (même celle de l’Allemagne!), c’est donc une excellente nouvelle pour le système bancaire privé qui pourra emprunter moins cher et prêter plus cher. Il est vrai qu’après tous leurs excès et leurs âneries, leurs nécessités en recapitalisation sont (sous?) estimées à 114 milliards d’euro. Il faut bien aider les plus riches! Un article paru le 22 novembre dans 24 Heures relate un fait divers représentatif d’une petite combine locale mais qui, en bout de course, reflète le mépris dans lequel on tient l’œuvre d’un artiste peintre : la fresque commandée en 1981 à Jean Lecoultre, pour l’inauguration du théâtre de l’Octogone à Pully, a été recouverte de plastique blanc 31 ans plus tard. Sur proposition de la directrice du théâtre, le syndic actuel, M. Gil Reichen, en charge des affaires culturelles, s’arroge le droit de faire recouvrir l’œuvre d’un plastique, sans doute pour être plus en phase avec les préoccupations actuelles ! Et tout cela s’est passé sans avertir l’artiste, qui habite à deux pas du théâtre, et sans en parler davantage aux pouvoirs politiques. Voilà qui rappelle les temps anciens où des « fous de Dieu » enduisaient de chaux les peintures dans les églises, au mépris des messages que les siècles précédents leur avaient transmis.
Un article paru le 22 novembre dans 24 Heures relate un fait divers représentatif d’une petite combine locale mais qui, en bout de course, reflète le mépris dans lequel on tient l’œuvre d’un artiste peintre : la fresque commandée en 1981 à Jean Lecoultre, pour l’inauguration du théâtre de l’Octogone à Pully, a été recouverte de plastique blanc 31 ans plus tard. Sur proposition de la directrice du théâtre, le syndic actuel, M. Gil Reichen, en charge des affaires culturelles, s’arroge le droit de faire recouvrir l’œuvre d’un plastique, sans doute pour être plus en phase avec les préoccupations actuelles ! Et tout cela s’est passé sans avertir l’artiste, qui habite à deux pas du théâtre, et sans en parler davantage aux pouvoirs politiques. Voilà qui rappelle les temps anciens où des « fous de Dieu » enduisaient de chaux les peintures dans les églises, au mépris des messages que les siècles précédents leur avaient transmis.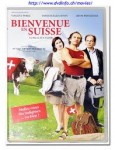 On l'attendait, avec un peu d'angoisse et beaucoup d'impatience, ce volume consacré à la Suisse dans la prestigieuse collection Découvertes-Gallimard. Et il est arrivé. Pas tout de suite, d'ailleurs, puisqu'il est seulement le 573e de la collection ! Il est signé François Walter, un professeur d'histoire moderne et contemporaine à l'Université de Genève depuis 1986.
On l'attendait, avec un peu d'angoisse et beaucoup d'impatience, ce volume consacré à la Suisse dans la prestigieuse collection Découvertes-Gallimard. Et il est arrivé. Pas tout de suite, d'ailleurs, puisqu'il est seulement le 573e de la collection ! Il est signé François Walter, un professeur d'histoire moderne et contemporaine à l'Université de Genève depuis 1986. Dont tout le monde vante l'inexprimable beauté. Signe, sans doute, d'une Nature encore intacte, proche de sa pureté originelle. Vantées par les premiers touristes anglais au XIXe siècle, ces « beautés naturelles » attireront, plus tard, le tourisme de masse vers les stations de sports d'hiver, transformant la Suisse en pays de cartes postales.
Dont tout le monde vante l'inexprimable beauté. Signe, sans doute, d'une Nature encore intacte, proche de sa pureté originelle. Vantées par les premiers touristes anglais au XIXe siècle, ces « beautés naturelles » attireront, plus tard, le tourisme de masse vers les stations de sports d'hiver, transformant la Suisse en pays de cartes postales. Tout n'est pas à jeter, sans doute, dans ce petit livre où l'on retrouve toutes les finesses, mais aussi toutes les naïvetés de la « nouvelle histoire suisse. » Un bémol, cependant : l'absence, quasi totale, mais effarante, de la culture (au sens large) qui s'est développée dans ce pays. Quelques noms d'écrivains, jetés ici ou là (Rousseau 1712-1778), à la sauvette, mais jamais développés, ni interrogés. Aucune mention de Georges Haldas, de Nicolas Bouvier, de Corinna Bille ! Idem pour Albert Cohen ou Denis de Rougemont, grand penseur de l'Europe. Les mêmes lacunes s'appliquent à la peinture, à la musique ou encore à l'architecture, complètement oubliées dans ce panorama de cartes postales. De telles lacunes étonnent, surtout chez un professeur d'Université.
Tout n'est pas à jeter, sans doute, dans ce petit livre où l'on retrouve toutes les finesses, mais aussi toutes les naïvetés de la « nouvelle histoire suisse. » Un bémol, cependant : l'absence, quasi totale, mais effarante, de la culture (au sens large) qui s'est développée dans ce pays. Quelques noms d'écrivains, jetés ici ou là (Rousseau 1712-1778), à la sauvette, mais jamais développés, ni interrogés. Aucune mention de Georges Haldas, de Nicolas Bouvier, de Corinna Bille ! Idem pour Albert Cohen ou Denis de Rougemont, grand penseur de l'Europe. Les mêmes lacunes s'appliquent à la peinture, à la musique ou encore à l'architecture, complètement oubliées dans ce panorama de cartes postales. De telles lacunes étonnent, surtout chez un professeur d'Université.