Hystérie voyeuriste
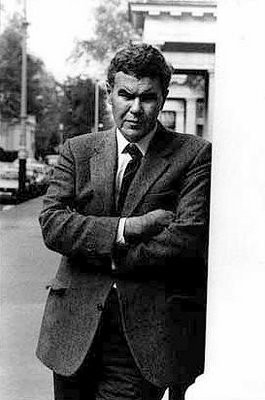 PAR ANTONIN MOERI
PAR ANTONIN MOERI
Selon le Robert, le mot « voyeur » est apparu au 18e pour désigner un spectateur attiré par une curiosité malsaine. Dès 1883, ce mot aurait désigné une personne qui assiste pour sa satisfaction et sans être vu à quelque scène érotique. Depuis 1957, on emploie le mot « voyeurisme » pour désigner le comportement des voyeurs considéré comme une perversion sexuelle. Nul doute, ces deux mots sentent mauvais (malsain, érotique, pervers). Faites l’expérience quand vous serez invité chez Madame Rinsoz : vous vous vantez d’être un voyeur, d’éprouver un vif plaisir à guetter (sans être vu) les caresses que se prodiguent deux individus. Vous serez servi. On ne vous invitera plus jamais. Faut-il en conclure que le voyeurisme est une maladie honteuse que tout citoyen se doit d’éradiquer ? Faut-il vraiment considérer cette part d’ombre chez les humains comme un crime ?
Dans « The Idea », Carver met en scène deux personnages qui assument totalement leur voyeurisme, qui prennent du plaisir à guetter un voisin, lui aussi voyeur. Mais lorsque la jouissance induite par ce comportement n’est pas purement « érotique », elle peut relever d’un besoin pathologique de dénoncer, de contrôler, assez répandu dans les classes moyennes américaines. L’envie du pénis devient alors envie du pénal, pour reprendre les termes de Philippe Muray. L’excitation que recherche la narratrice de « The Idea » relève de cette seconde envie.
Depuis trois mois, elle guette avec son mari les agissements suspects d’un voisin. Accroupis dans l’obscurité, ils ne se lassent pas d’assister à un étrange rituel : un type en bermuda se poste à l’extérieur de sa maison pour reluquer sa femme en train de se déshabiller. La narratrice ne supporte pas la conduite déviante de ces gens : « Un de ces jours, je lui dirai ma façon de penser à cette traînée. Elle ne perd rien pour attendre ». Elle a déjà songé à appeler la police.
En attendant, la faim se fait sentir malgré le dîner pris en début de soirée. Vern et sa femme se jettent sur le pâté, les crackers, la viande, les cornichons, les pommes chips et les corn flakes. En raclant les assiettes au-dessus de la poubelle, elle voit des fourmis. Elle les asperge d’insecticide. Elle imagine qu’il y en a partout. Elle vaporise dans tous les coins. Cette hantise d’une contagion signale un être qui a peur de l’autre. L’intrusion de ce type en bermuda reluquant sa femme à poil dérange l’ordre qu’elle se doit de préserver compulsivement. Elle se sent directement menacée par ces gens bizarres.
Aux trois définitions données par le Robert, on pourrait en ajouter une quatrième. Le mot « voyeurisme » peut être employé pour désigner le comportement citoyen d’une personne qu’épouvantent toute déviance, tout plaisir non homologué, qui guette jusqu’au fond des chaumières la moindre parcelle d’ombre non prévue par la Loi.
![goncourt[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/02/02/2487959116.jpg)



![Quête[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/01/00/2759578949.jpg)

![jonasz[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/02/00/102181628.jpg) En v’là du sot en v’là…
En v’là du sot en v’là… Ce livre, rédigé pour servir d’introduction aux œuvres complètes de Genet, a provoqué chez Genet l’impossibilité de continuer à écrire des romans. C'est lui-même qui l'a dit. Pendant dix ans, bloquage complet. Puis il s’est voué au théâtre, si on excepte son récit posthume, Un captif amoureux, sur les Palestiniens.
Ce livre, rédigé pour servir d’introduction aux œuvres complètes de Genet, a provoqué chez Genet l’impossibilité de continuer à écrire des romans. C'est lui-même qui l'a dit. Pendant dix ans, bloquage complet. Puis il s’est voué au théâtre, si on excepte son récit posthume, Un captif amoureux, sur les Palestiniens.