Par Pierre Béguin
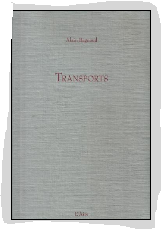 A quelle posture nous contraint la lecture de Transports, le dernier livre d’Alain Bagnoud? Au fil des textes qui se succèdent, et dont le rythme est donné par la juxtaposition d’instantanés, nous accompagnons des poses, des faits, des paroles, des gestes en apparence anodins.
A quelle posture nous contraint la lecture de Transports, le dernier livre d’Alain Bagnoud? Au fil des textes qui se succèdent, et dont le rythme est donné par la juxtaposition d’instantanés, nous accompagnons des poses, des faits, des paroles, des gestes en apparence anodins.
En surface, le texte se présente comme un ensemble de clichés pris sur le vif du réel dans les transports publics (trams, trains, bus, et même téléphériques), ou les endroits qui en constituent les étapes (gares, cafés, arrêts de bus). Derniers lieux démocratiques où s’égalisent les différences, où marginaux, travailleurs, bourgeois, jeunes, vieux, pauvres, aisés se côtoient sans se rencontrer, sans se parler, sans se comprendre, chacun dans sa bulle ou «chez» son Natel, comme disait Nougaro de l’automobile. Des lieux où l’absence d’agressivité n’est que la marque d’une profonde indifférence («Comment tant d’individus peuvent-ils tenir dans un espace si étroit sans qu’ils s’entretuent?»), des lieux où passe, s’attarde, erre, selon les heures du jour ou de la nuit, une population hétéroclite, nomade, «multiculturelle», une sorte de microcosme de l’humanité soustraite uniquement de sa partie la plus privilégiée. Un point d’observation idéal. En artiste, Bagnoud ne s’y est pas trompé.
Un texte impressionniste donc, où se dessine, par traits légers ou petites touches successives, le portrait d’une modernité dont on ne perçoit ni sens ni cohérence. C’est que l’auteur adopte une écriture de type «behaviouriste», qui s’attache essentiellement aux comportements, aux gestes, à «l’extériorité», sans jamais s’aventurer dans l’intériorité des personnages. Ainsi désincarnée, amputée de ses motivations, sentiments ou intérêts qui en justifieraient les actions, cette humanité semble réduite à l’absurdité de ses mouvements répétés sans rimes ni raisons. D’où une vague impression de nausée, judicieusement contenue par l’humour du trait et la dérision du portrait.
Voilà pour la surface. Car l’important semble ailleurs. Derrière tous ces personnages qui hantent les transports et lieux publics, qui en occupent le premier plan, il faut induire celui par qui ces personnages sont vus. Le perçu renvoie à celui qui perçoit, l’impliquant et le désignant en creux. Comme si l’état d’âme du photographe importait plus que le sujet photographié. En ce sens, le texte ne se réduit pas à des tranches de descriptions mais à une succession d’états de conscience qui font émerger peu à peu, en négatif, un narrateur et son histoire. Dans Transports, ce n’est pas le sujet qui construit son objet, mais l’objet qui désigne le sujet.
D’abord relégué dans les coulisses ou dissous dans la neutralité du «on», le narrateur envahit peu à peu l’espace pour en occuper la première place. Si nous sommes contraints de voir par ses yeux sans le voir vraiment, c’est lui, avant tout, que nous découvrons en filigrane d’une galerie de portraits hétéroclites, lui dont on accroche brièvement la silhouette au hasard d’un reflet dans la vitre d’un tram.
Cette émergence d’un «je» qui se met progressivement en scène trace un parcours contenant son propre échec. Le parcours d’une désillusion: «Je n’y arrive plus. Prendre facilement des notes (…) A force est venue l’impression que ça se répète. Les mêmes gens, les mêmes trajets, les mêmes phrases». L’échec commence par l’entreprise littéraire elle-même pour s’étendre bientôt au statut de l’écrivain: «Je ne pensais pas que vouloir devenir écrivain, c’était également ça. Etre appelé parfois dans une autre ville (…) Dans le meilleur, on vous glisse une enveloppe. Souvent, le trajet seul est remboursé, en deuxième classe, en demi-tarif. Il arrive aussi que ce n’était pas prévu, ils n’y ont pas pensé, ce sera difficile». Mais il contamine très vite d’autres secteurs pour s’attaquer à l’âme: «Puis dans ces trains, je compare ma vie avec celle dont je rêvais», «Je sais qu’il est temps de changer de vie. Mais il me semble que retrouver le poison en moi ne me mènerait à rien».
 Qui parle? Qui est ce «je» désabusé faisant une sorte de bilan de sa vie au travers du portrait de ses semblables, de la masse desquels il n’est pas parvenu à s’extraire comme ses rêves de jeunesse l’avaient imaginé? Un écrivain déçu, un professeur désillusionné, un bourgeois qui s’encanaille dans les zones floues des transports publics où s’agglutine les laissés-pour-compte, les marginaux, les hors normes, un propriétaire de vignes qui se donne bonne conscience en feignant l’empathie envers les déshérités ou les mendiants roms pour s’en dédouaner aussitôt: «Moi, je suis un nanti et je trouve, par confort, que la charité est égoïste». Qui? Bagnoud bien sûr, mais aussi vous, moi, tout le monde. Avoue-le! Tu ne la voyais pas comme ça, ta vie!
Qui parle? Qui est ce «je» désabusé faisant une sorte de bilan de sa vie au travers du portrait de ses semblables, de la masse desquels il n’est pas parvenu à s’extraire comme ses rêves de jeunesse l’avaient imaginé? Un écrivain déçu, un professeur désillusionné, un bourgeois qui s’encanaille dans les zones floues des transports publics où s’agglutine les laissés-pour-compte, les marginaux, les hors normes, un propriétaire de vignes qui se donne bonne conscience en feignant l’empathie envers les déshérités ou les mendiants roms pour s’en dédouaner aussitôt: «Moi, je suis un nanti et je trouve, par confort, que la charité est égoïste». Qui? Bagnoud bien sûr, mais aussi vous, moi, tout le monde. Avoue-le! Tu ne la voyais pas comme ça, ta vie!
Ces Transports, à l’image de l’existence, ne mènent nulle part. Ils reviennent immanquablement au point de départ, comme le souligne l’éternel retour des forains dans les scènes initiale et finale, symbole du vain divertissement face au vide de l’existence. Pourtant, entre ces deux scènes, deux différences de taille: l’irruption, à la fin, du tragique par la mort accidentelle d’un adolescent téméraire dont seul le casque reste au bord de la route, et l’interrogation angoissée sur la solitude et l’exil irrémédiables du vieillard auquel le «je» semble s’identifier par projection. On pense à Gaspard de la nuit, du dijonnais Alyosus Bertrand, où le retour des petits ramoneurs savoyards marquait le rythme des saisons, des us et coutumes qui donnaient sens au réel. Sauf qu’entre 1841 et 2011, la modernité s’est repue du sens des traditions pour n’en laisser qu’une triste carcasse sur laquelle ne se pose plus que le conformisme des distractions de masse. La fête terminée, «il semble que rien ne se soit passé de ce qu’on voulait qu’il se passe». Conclusion d’un premier instantané déjà prophétique des suivants…
«Est-ce que les choses nous dévoilent d’autres aspects si on les observe souvent?» s’interroge le narrateur, énonçant ainsi le fondement même de son entreprise littéraire. Non, semble-t-il répondre. Du moins «quand on est hors jeu et le monde dans sa représentation». Car le véritable lieu du tragique reste l’absence totale de communication, de communion, entre les êtres. Narrateur, personnages, chacun est posé l’un à côté de l’autre, dans sa cage de verre, construisant sa propre réalité fantasmée ou enfoncé dans une solitude ontologique qui annihile toute possibilité d’empathie. Le narrateur, pour s’extirper de cette absurdité, en vient à souhaiter sa dissolution dans l’informe ou l’abstrait, «n’être plus rien que le regard qui contemple ces chaussures rouges en forme de souris», pour le moins son émancipation des contraintes temporelles, «vivre dans le présent, loin des regrets et des projections».
Projet vain. Fuite vaine. Mais il reste une acceptation possible dans l’humour et l’autodérision: «J’aimerais percer le mystère des gens grâce à leur apparence. Pourtant, lorsque je me regarde dans la glace, je me trouve un air de boxeur dandy qui aurait fini misérablement sa carrière et travaillerait comme videur dans une boîte de nuit. Raté, mais content de son gilet de velours».
Alain Bagnoud, Transports, l’Aire, 2011
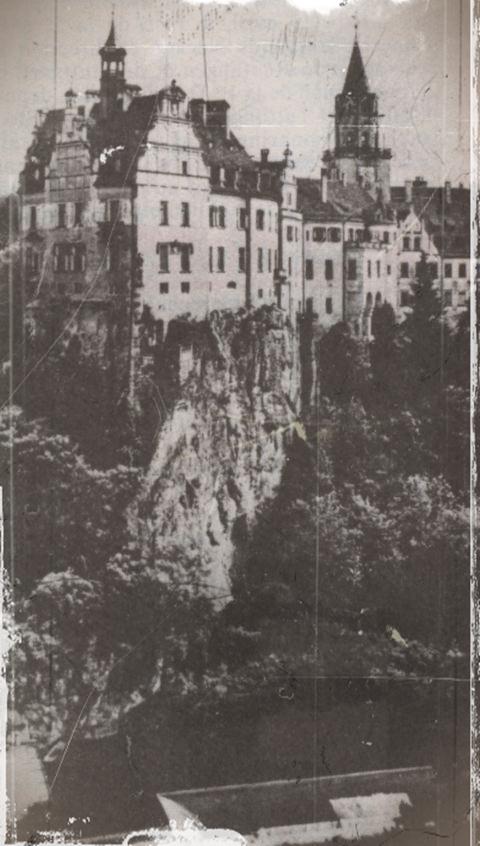 Au début de D'un château l'autre, Céline se trouve dans une situation où se reconnaîtront pas mal de ceux qui se piquent d'écrire.
Au début de D'un château l'autre, Céline se trouve dans une situation où se reconnaîtront pas mal de ceux qui se piquent d'écrire. e se réfugier en Argentine, est chargé d'encaisser le droit de passage.
e se réfugier en Argentine, est chargé d'encaisser le droit de passage.
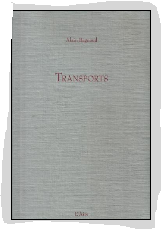 A quelle posture nous contraint la lecture de Transports, le dernier livre d’Alain Bagnoud? Au fil des textes qui se succèdent, et dont le rythme est donné par la juxtaposition d’instantanés, nous accompagnons des poses, des faits, des paroles, des gestes en apparence anodins.
A quelle posture nous contraint la lecture de Transports, le dernier livre d’Alain Bagnoud? Au fil des textes qui se succèdent, et dont le rythme est donné par la juxtaposition d’instantanés, nous accompagnons des poses, des faits, des paroles, des gestes en apparence anodins. Qui parle? Qui est ce «je» désabusé faisant une sorte de bilan de sa vie au travers du portrait de ses semblables, de la masse desquels il n’est pas parvenu à s’extraire comme ses rêves de jeunesse l’avaient imaginé? Un écrivain déçu, un professeur désillusionné, un bourgeois qui s’encanaille dans les zones floues des transports publics où s’agglutine les laissés-pour-compte, les marginaux, les hors normes, un propriétaire de vignes qui se donne bonne conscience en feignant l’empathie envers les déshérités ou les mendiants roms pour s’en dédouaner aussitôt: «Moi, je suis un nanti et je trouve, par confort, que la charité est égoïste». Qui? Bagnoud bien sûr, mais aussi vous, moi, tout le monde. Avoue-le! Tu ne la voyais pas comme ça, ta vie!
Qui parle? Qui est ce «je» désabusé faisant une sorte de bilan de sa vie au travers du portrait de ses semblables, de la masse desquels il n’est pas parvenu à s’extraire comme ses rêves de jeunesse l’avaient imaginé? Un écrivain déçu, un professeur désillusionné, un bourgeois qui s’encanaille dans les zones floues des transports publics où s’agglutine les laissés-pour-compte, les marginaux, les hors normes, un propriétaire de vignes qui se donne bonne conscience en feignant l’empathie envers les déshérités ou les mendiants roms pour s’en dédouaner aussitôt: «Moi, je suis un nanti et je trouve, par confort, que la charité est égoïste». Qui? Bagnoud bien sûr, mais aussi vous, moi, tout le monde. Avoue-le! Tu ne la voyais pas comme ça, ta vie!
 Ce dialogue, Baptiste et Angèle, est sous-titré Rwanda 2008. On se trouve en effet dans ce pays, 14 ans après qu'un million de Tutsis ont été tués à la machette. 10'000 meurtres par jour en moyenne, on a fait le calcul.
Ce dialogue, Baptiste et Angèle, est sous-titré Rwanda 2008. On se trouve en effet dans ce pays, 14 ans après qu'un million de Tutsis ont été tués à la machette. 10'000 meurtres par jour en moyenne, on a fait le calcul. Qu’est-ce que le champ littéraire par rapport à la production livresque? Une goutte d’eau. Qu’est-ce qui distingue cette goutte d’eau dans la mer? Peut-on définir des critères pour accorder à un texte le label «littéraire»? Ou plutôt, quelles caractéristiques doit-il revendiquer pour prétendre à ce statut? En d’autres termes, comment séparer le bon grain littéraire de l’ivraie scribouillarde dans la masse des productions contemporaines?
Qu’est-ce que le champ littéraire par rapport à la production livresque? Une goutte d’eau. Qu’est-ce qui distingue cette goutte d’eau dans la mer? Peut-on définir des critères pour accorder à un texte le label «littéraire»? Ou plutôt, quelles caractéristiques doit-il revendiquer pour prétendre à ce statut? En d’autres termes, comment séparer le bon grain littéraire de l’ivraie scribouillarde dans la masse des productions contemporaines?
 L'Isle Adam dialogue avec les quotidiens actuels, Georges Perec permet de se demander « si l’éducation à la démocratie et la toute-puissance du marché sont compatibles ».
L'Isle Adam dialogue avec les quotidiens actuels, Georges Perec permet de se demander « si l’éducation à la démocratie et la toute-puissance du marché sont compatibles ».
 Tout est étrange dans le roman utopique de Philippe Le Bé, Du Vin d’ici à l’Au-Delà. Le titre d’abord, bien sûr, mais aussi le contenu, le nom de l’auteur, l’auteur lui-même peut-être. Enquêtons.
Tout est étrange dans le roman utopique de Philippe Le Bé, Du Vin d’ici à l’Au-Delà. Le titre d’abord, bien sûr, mais aussi le contenu, le nom de l’auteur, l’auteur lui-même peut-être. Enquêtons. à des théories philosophiques, économiques et politiques étudiées sur Terre.
à des théories philosophiques, économiques et politiques étudiées sur Terre. De Félicien, je ne possède qu'une dizaine de photos prises je ne sais quand, je ne sais où. Sur mon bureau, j'ai posé un portrait de lui enchâssé dans un médaillon doré. Il est tel que je ne l'ai jamais connu : jeune, les cheveux gominés, la raie au milieu. C'est en regardant ce portrait qu'est venue l'envie d'écrire sur lui comme si je savais tout de lui. Cela lui aurait certainement plu à Félicien, cette liberté prise avec sa vie. Il était rêveur, cela transparaît dans son regard sur ce portrait jauni. Un regard flou, sans lunettes. Félicien s'extrayait de la réalité en ôtant, cassant ou perdant ses lunettes. Cela pouvait durer quelques minutes, un jour ou plus avant qu'il ne les rechausse. A mon tour maintenant d'oublier mes lunettes et de transcrire ce que je vois. Pour qu'une fois encore, Félicien me serre contre lui.
De Félicien, je ne possède qu'une dizaine de photos prises je ne sais quand, je ne sais où. Sur mon bureau, j'ai posé un portrait de lui enchâssé dans un médaillon doré. Il est tel que je ne l'ai jamais connu : jeune, les cheveux gominés, la raie au milieu. C'est en regardant ce portrait qu'est venue l'envie d'écrire sur lui comme si je savais tout de lui. Cela lui aurait certainement plu à Félicien, cette liberté prise avec sa vie. Il était rêveur, cela transparaît dans son regard sur ce portrait jauni. Un regard flou, sans lunettes. Félicien s'extrayait de la réalité en ôtant, cassant ou perdant ses lunettes. Cela pouvait durer quelques minutes, un jour ou plus avant qu'il ne les rechausse. A mon tour maintenant d'oublier mes lunettes et de transcrire ce que je vois. Pour qu'une fois encore, Félicien me serre contre lui. Nora et Antonio vivent à Trieste, puis à Turin, puis sillonnent l'Italie sur les traces d'un certain Mussolini, dont Antonio devient le photographe attitré. Émilie et Julien vivent à Nyon, sur la côte vaudoise, et rêvent depuis toujours d'ouvrir une auberge de campagne. Ils ne se connaissent pas. Ils ne parlent pas la même langue. Ils n'ont pas les mêmes rêves. Mais leurs destins -- tout d'abord parallèles -- vont se croiser, puis s'épouser au cours de la première moitié du XXe siècle. Quatre « vies minuscules », silencieuses, dédaignées, héroïques, dont l'enfant secret (vous, moi) sera le témoin ébloui, et l'unique héritier.
Nora et Antonio vivent à Trieste, puis à Turin, puis sillonnent l'Italie sur les traces d'un certain Mussolini, dont Antonio devient le photographe attitré. Émilie et Julien vivent à Nyon, sur la côte vaudoise, et rêvent depuis toujours d'ouvrir une auberge de campagne. Ils ne se connaissent pas. Ils ne parlent pas la même langue. Ils n'ont pas les mêmes rêves. Mais leurs destins -- tout d'abord parallèles -- vont se croiser, puis s'épouser au cours de la première moitié du XXe siècle. Quatre « vies minuscules », silencieuses, dédaignées, héroïques, dont l'enfant secret (vous, moi) sera le témoin ébloui, et l'unique héritier.