Par Pierre Béguin
![murakami[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/02/02/3662993828.jpg) Haruki Murakami, auquel même la Tribune de Genève de ce week end consacre une page pour la parution de son dernier roman, s’impose de plus en plus comme la nouvelle référence asiatique en occident. «Nobelisable» depuis plusieurs années, traducteur de Scott Fitzgerald et Raymond Carver, l’écrivain japonais cultive cette caractéristique insolite: il partage son temps entre l’écriture et la course de fond, s’imposant au moins un grand marathon (New-York, Boston ou Tokyo) par année. Si l’écriture l’a amené au sport – assis la plupart du temps, il fumait à outrance et prenait du poids – le sport ne cesse de le renvoyer à l’écriture. C’est le motif principal de son traité de sagesse original intitulé Autoportrait de l’auteur en coureur de fond, paru en 2007 (en 2009 chez Belfond pour la traduction française). Courir devient une métaphore du travail d’écrivain, non seulement en termes d’endurance, de persévérance, de patience (il faut aussi ces qualités pour écrire un roman) mais en termes d’hygiène de vie, de santé physique et, surtout, mentale.
Haruki Murakami, auquel même la Tribune de Genève de ce week end consacre une page pour la parution de son dernier roman, s’impose de plus en plus comme la nouvelle référence asiatique en occident. «Nobelisable» depuis plusieurs années, traducteur de Scott Fitzgerald et Raymond Carver, l’écrivain japonais cultive cette caractéristique insolite: il partage son temps entre l’écriture et la course de fond, s’imposant au moins un grand marathon (New-York, Boston ou Tokyo) par année. Si l’écriture l’a amené au sport – assis la plupart du temps, il fumait à outrance et prenait du poids – le sport ne cesse de le renvoyer à l’écriture. C’est le motif principal de son traité de sagesse original intitulé Autoportrait de l’auteur en coureur de fond, paru en 2007 (en 2009 chez Belfond pour la traduction française). Courir devient une métaphore du travail d’écrivain, non seulement en termes d’endurance, de persévérance, de patience (il faut aussi ces qualités pour écrire un roman) mais en termes d’hygiène de vie, de santé physique et, surtout, mentale.
De fait, la conception selon laquelle un écrivain doit mener une vie déréglée pour pouvoir créer est largement partagée depuis le 19e siècle et les poètes maudits. En adoptant un mode de vie malsain, un écrivain se retirerait du monde profane et atteindrait une espèce de pureté doublée de valeur artistique. Vision romantique stéréotypée de l’artiste ou de l’écrivain décadent certes, largement réactivée depuis le rock, les années 60 et les idoles mortes prématurément par abus de drogues et d’alcool, que Murakami partage cependant de manière plutôt originale: «Lorsque nous nous lançons dans un projet d’écriture, une sorte de substance toxique, tapie au plus profond de chaque être humain, ressort à la surface, que cela nous plaise ou non. Tous les écrivains ont à faire face, plus ou moins, à ce principe délétère et, conscients du danger qu’il recèle, doivent se débrouiller pour transiger avec.» Le postulat est donc admis: écrire est une activité dangereuse; comme toute activité artistique, elle comporte des éléments malsains, antisociaux, que l’écrivain doit affronter au risque de se perdre. Le poète anglais John Keats, mort à 26 ans, appelait cela la capacité négative, une formule qui désigne la force nécessaire à l’écrivain pour se couper du monde social et s’aventurer dans des territoires imaginaires malsains, aux confins de la folie, puis d’en revenir, de retourner à volonté dans le monde «normal» (j’ai toujours considéré le récit d’Hemingway Le vieil Homme et la mer comme une parfaite illustration de cette negative capacity inhérente à toute quête artistique).
Si, donc, écrire est une activité dangereuse, tout auteur, s’il entend durer, doit se constituer un système immunitaire susceptible de le préserver des toxines parfois mortelles qui résident en lui-même. Pour se confronter à quelque chose de malsain, il convient d’être aussi sain que possible. A chaque écrivain de trouver à cette «devise» la forme qui lui sied. Certains – beaucoup –, tel Garcia Marquez, lui donnent celle d’une femme qui joue le rôle d’amarres et prend sur elle tous les aspects pratiques de l’existence. Pour Murakami, elle se transpose en ces termes: une âme malsaine, ou exposée à la toxicité, a besoin d’un corps en bonne santé. Le marathon, la course de fond, un entraînement intensif, méthodique, régulier, sont les éléments indispensables à la constitution de son système auto-immune. Car pour lui, «le sain et le malsain ne sont pas nécessairement antagonistes. Ils ne se situent pas dans l’opposition l’un vis-à-vis de l’autre, mais plutôt dans la complémentarité et même, dans certains cas, ils agissent naturellement ensemble.» Sans l’énergie et le soin apportés à la constitution de son système auto-immune, un artiste est voué au déclin, comme un marathonien s’exposerait aux crampes et à l’abandon, faute d’une préparation adéquate. Ainsi explique-t-il l’essoufflement rapide de certains écrivains, leur difficulté à durer (que pourrions-nous dire des chanteurs, chanteuses ou groupes de rock dont la phase créative semble limitée à quelques années, et qui sombrent avant même la trentaine dans la déchéance et le néant!): «Cette régression vient de ce que leur vigueur physique ne parvient plus à contrer les toxines auxquelles elle doit faire face. Leur vitalité a dépassé son pic, elle qui jusqu’alors pouvait naturellement vaincre les éléments mauvais, et son efficacité sur leur système immunitaire s’est dégradée peu à peu.» Un écrivain ne peut rester créatif par sa seule volonté. Il en serait alors réduit à utiliser les techniques et les méthodes qu’il a cultivées autrefois, mais vidées du génie – ou simplement de l’étincelle – qui en avait fait la grandeur. Les exemples de ce type pullulent, notamment parmi les auteurs les plus prolixes, ceux qui ne savent pas «se mettre en jachère» et qui s’acharnent à publier un livre par année pour exister.
Car la création n’est pas un sprint, c’est une course de fond. Murakami nous le rappelle, elle se gère comme un marathon, avec ses pics et ses phases dépressives (le fameux 35e kilomètre redouté des marathoniens). Il faut une parfaite connaissance de soi et de ses limites pour éviter le surmenage créatif et la dépression, voire la déchéance, qui en est souvent la conséquence, comme il faut une parfaite connaissance de son corps et de ses limites pour parcourir les 42,195 kilomètres du marathon. Reculer au maximum le moment de la défaite inexorable, voilà l’objectif de Murakami et le sens de son traité de sagesse qui se veut un mode d’emploi à usage strictement personnel: «J’aimerais retarder, autant que je le peux, le moment où ma vitalité sera vaincue et dépassée par les toxines. Tel est mon objectif en tant que romancier. Par ailleurs, à ce moment-là, je n’aurais pas le loisir d’être surmené. Voilà la raison exacte pour laquelle, même lorsque les gens disent de moi: "Il n’est pas un artiste", je continue à courir.»
Haruki Murakami, Autoportrait de l’auteur en coureur de fond, 10/18 domaine étranger, 2009
 C’est un roman victorien, a-t-on dit. A l’esthétique victorienne. Paru en 2001, il raconte en trois volets la formation d’une romancière, ses manipulations et les distorsions qu’elle apporte à la réalité.
C’est un roman victorien, a-t-on dit. A l’esthétique victorienne. Paru en 2001, il raconte en trois volets la formation d’une romancière, ses manipulations et les distorsions qu’elle apporte à la réalité. La troisième partie est une sorte de post-scriptum aux deux premières. En 1999, Briony explique qu’elle vient de terminer ce roman, lui donne une conclusion, évoque ce qui est arrivé postérieurement aux personnages et explique quels gauchissements de la réalité elle a assumés et pourquoi.
La troisième partie est une sorte de post-scriptum aux deux premières. En 1999, Briony explique qu’elle vient de terminer ce roman, lui donne une conclusion, évoque ce qui est arrivé postérieurement aux personnages et explique quels gauchissements de la réalité elle a assumés et pourquoi.
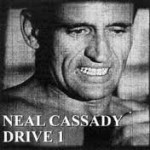
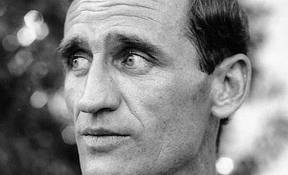
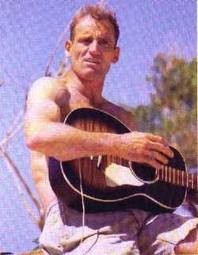

![murakami[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/02/02/3662993828.jpg) Haruki Murakami, auquel même la Tribune de Genève de ce week end consacre une page pour la parution de son dernier roman, s’impose de plus en plus comme la nouvelle référence asiatique en occident. «Nobelisable» depuis plusieurs années, traducteur de Scott Fitzgerald et Raymond Carver, l’écrivain japonais cultive cette caractéristique insolite: il partage son temps entre l’écriture et la course de fond, s’imposant au moins un grand marathon (New-York, Boston ou Tokyo) par année. Si l’écriture l’a amené au sport – assis la plupart du temps, il fumait à outrance et prenait du poids – le sport ne cesse de le renvoyer à l’écriture. C’est le motif principal de son traité de sagesse original intitulé Autoportrait de l’auteur en coureur de fond, paru en 2007 (en 2009 chez Belfond pour la traduction française). Courir devient une métaphore du travail d’écrivain, non seulement en termes d’endurance, de persévérance, de patience (il faut aussi ces qualités pour écrire un roman) mais en termes d’hygiène de vie, de santé physique et, surtout, mentale.
Haruki Murakami, auquel même la Tribune de Genève de ce week end consacre une page pour la parution de son dernier roman, s’impose de plus en plus comme la nouvelle référence asiatique en occident. «Nobelisable» depuis plusieurs années, traducteur de Scott Fitzgerald et Raymond Carver, l’écrivain japonais cultive cette caractéristique insolite: il partage son temps entre l’écriture et la course de fond, s’imposant au moins un grand marathon (New-York, Boston ou Tokyo) par année. Si l’écriture l’a amené au sport – assis la plupart du temps, il fumait à outrance et prenait du poids – le sport ne cesse de le renvoyer à l’écriture. C’est le motif principal de son traité de sagesse original intitulé Autoportrait de l’auteur en coureur de fond, paru en 2007 (en 2009 chez Belfond pour la traduction française). Courir devient une métaphore du travail d’écrivain, non seulement en termes d’endurance, de persévérance, de patience (il faut aussi ces qualités pour écrire un roman) mais en termes d’hygiène de vie, de santé physique et, surtout, mentale.
 Ce récit d’errances, on l’a dit, est également un roman d’amour, ou d’amours. Celui qui unit désormais Anteo à Solange, une femme qui l’équilibre. Celui qui a lié les deux jeunes amants, trop différents pour que leur passion puisse surmonter leurs oppositions. Les noms des personnages le suggèrent: étymologiquement, Anteo fait évidemment référence au passé que revit le personnage, et Nomia à la loi qui triomphe finalement du vagabondage de la jeune fille. Mais si on les accole, comme le découvre un personnage étonnant du livre, ça donne antinomie. La contradiction, l’opposition.
Ce récit d’errances, on l’a dit, est également un roman d’amour, ou d’amours. Celui qui unit désormais Anteo à Solange, une femme qui l’équilibre. Celui qui a lié les deux jeunes amants, trop différents pour que leur passion puisse surmonter leurs oppositions. Les noms des personnages le suggèrent: étymologiquement, Anteo fait évidemment référence au passé que revit le personnage, et Nomia à la loi qui triomphe finalement du vagabondage de la jeune fille. Mais si on les accole, comme le découvre un personnage étonnant du livre, ça donne antinomie. La contradiction, l’opposition. L'ancien voyou, habitué des prisons de haute sécurité pour braquage de banques et de bijouteries, continue son cheminement littéraire. Il écrit des livres singuliers, qui ne sont fondus dans aucun moule. Autobiographie, autofiction, roman policier, essai? Un mélange de tout ça. Ses livres à la composition singulière sont des ovnis lucides et âpres.
L'ancien voyou, habitué des prisons de haute sécurité pour braquage de banques et de bijouteries, continue son cheminement littéraire. Il écrit des livres singuliers, qui ne sont fondus dans aucun moule. Autobiographie, autofiction, roman policier, essai? Un mélange de tout ça. Ses livres à la composition singulière sont des ovnis lucides et âpres.
 par Jean-Michel Olivier
par Jean-Michel Olivier