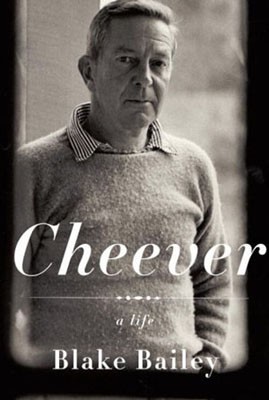Par Pierre Béguin
 Blogres est avant tout un blog littéraire. En ce sens, il défend la littérature. Et cette défense commence par l'école. A plus forte raison quand celle-ci marche sur la tête.
Blogres est avant tout un blog littéraire. En ce sens, il défend la littérature. Et cette défense commence par l'école. A plus forte raison quand celle-ci marche sur la tête.
Pourquoi ces tautologies en guise d'introduction? Parce qu'après les menaces qui pèsent sur le latin, voici venues celles qui visent l'enseignement des langues vivantes. Si le latin possède heureusement ses ardents défenseurs, si la presse a servi opportunément de caisse de résonnance contre les attaques régulières dont il est victime, les pressions qui s'exercent maintenant sur la conception même de l'enseignement des langues vivantes sont beaucoup plus discrètes, pour ne pas dire sournoises. De quoi s'agit-il?
Je l'ai déjà écrit sur ce blog (cf. extension des nouvelles tyrannies II), le nouveau joujou du DIP, sa pierre philosophale actuelle, c'est l'uniformisation. Uniformiser certes, me direz-vous, mais selon quelle norme? La norme européenne, voyons! Il faut être le plus euro-compatible possible. Dans le cas qui nous occupe, il s'agit de mettre en adéquation nos programmes d'enseignement des langues vivantes (anglais, allemand, italien, espagnol) avec le cadre européen (ou, pour dire les choses plus crûment, il s'agit de faire aussi mal que les autres, à savoir de trouver le PMDC, le Plus Mauvais Dénominateur Commun). En ce sens, des organismes, des commissions, des instruments sont régulièrement constitués. Parmi eux, le CECR. A savoir, le Cadre Européen Commun de Référence, dont le libellé indique assez clairement l'objectif. Initialement, le CECR se voulait un instrument essentiellement descriptif, se limitant à encourager le questionnement pédagogique et à faciliter les échanges d'informations entre praticiens et apprenants. Bien entendu, le glissement de la fonction descriptive à la fonction prescriptive était prévisible. Nous n'avons pas été déçu, comme souvent avec le DIP lorsqu'il s'agit de soutenir le pire. Car le CECR menace maintenant de devenir l'instrument de référence. Ainsi, les directeurs/trices du Collège de Genève semblent avoir récemment admis l'idée que le CECR doit servir de cadre référentiel à l'enseignement des langues vivantes.
Et c'est bien là le problème. Car le CECR milite pour une dimension purement utilitaire de l'enseignement des langues, à l'exclusion de sa dimension culturelle et littéraire, reléguée à une sous-catégorie de «congé et loisirs», une sorte de supermarché où elle côtoie, sur les rayons «thèmes de communication», les achats, la nourriture et la boisson. Une conception donc uniquement axée sur la pragmatique langagière, aux antipodes de toute incitation réflexive et analytique, à des années lumière des principes et des valeurs qui ont toujours régi la maturité gymnasiale, et selon lesquels l'enseignement des langues doit s'inscrire clairement dans un cadre élargi de culture générale et d'exercice de développement de la pensée.
Car dans l'enseignement de l'ignorance, dès qu'on entend le mot «culture», on sort son pistolet. Attention! Le moins possible de littérature! Cela pourrait contribuer à la maturité d'esprit et à la liberté de jugement. Le DIP doit se convertir en une gigantesque machine à décerveler, semblable à celle d'Ubu, capable de produire en masse une foule d'abrutis consuméristes se vautrant dans les divertissements les plus abêtissants et ne pouvant produire que des énoncés basiques. Alors focalisons l'enseignement des langues uniquement sur des activités communicationnelles, si possible dans des cadres d'énonciation à dimension commerciale, au détriment des contenus culturels, aussi dangereux qu'inutilement dispendieux! Avec en sus le label euro-compatible comme caution!
Tel est un des débats qui agitent les coulisses du DIP. Un débat qui n'est pas encore sur la place publique mais qui pourrait y venir par la politique du fait accompli si l'on y prend garde. La place publique, l'agora, maintenant, c'est aussi, et surtout, la blogosphère. Alors je pose la question: enseignement des langues portant sur une dimension essentiellement utilitaire, pragmatique, avec des énoncés situationnels à résonnance commerciale? Ou enseignement des langues incluant la dimension culturelle, littéraire, avec incitation réflexive et analytique?
Bon! Dite en ces termes, me direz-vous, la question reste purement rhétorique. Celle qu'on devrait plutôt se poser consisterait à savoir comment des personnes qui ont bénéficié d'un enseignement qualitatif se profilent en prédateurs des valeurs et des principes qui les ont hissés au niveau enviable où elles peuvent maintenant détruire l'instrument même de leur ascension. Non! Ce n'est pas pour rester les seules. Mais par opportunisme, par carriérisme. Exactement comme en politique! Les soutiens et les arrangements entre partis faisant le reste. Depuis plus de trente ans que je fais les cents pas dans ce département (et non pas, hélas, les quatre cents coups!), j'ai observé le mécanisme à maintes reprises: dès qu'une personne, à quelque échelon qu'elle se trouve, soutient une idée souvent délirante, parfois judicieuse, mais qui vole dans l'air du temps, c'est avant tout pour s'en servir. Si l'idée passe, son défenseur passe avec. Et un échelon de gravi, un! Le problème, c'est que l'idée reste et qu'il faut ensuite s'en accommoder. Voilà pourquoi les mauvaises idées rencontrent toujours leurs thuriféraires, voilà pourquoi il se trouve au Collège de Genève des défenseurs bien placés d'un appauvrissement de l'enseignement des langues vivantes, voilà pourquoi certains militent pour une évacuation de la dimension culturelle au profit d'une finalité essentiellement pragmatique. S'ils ne croient pas à l'idée, ils parient sur son pouvoir ascensionnel.
Chez l'être humain, la vanité est l'arme principale des mécanismes de prédation. Et si, à ce niveau, nous sommes tous plus ou moins armés, il en est de plus dangereux qui possèdent un véritable arsenal. Avec, souvent, la frustration en guise de détonateur...
 L'affaire est simple : vous avez un homme riche, brillant, marié à l'une des femmes les plus célèbres de France. Un homme de scène et de pouvoir. Directeur du FMI et grand stratège de la finance mondiale. En outre, le favori des sondages pour l'élection présidentielle française de 2012. Un homme à qui tout réussit…
L'affaire est simple : vous avez un homme riche, brillant, marié à l'une des femmes les plus célèbres de France. Un homme de scène et de pouvoir. Directeur du FMI et grand stratège de la finance mondiale. En outre, le favori des sondages pour l'élection présidentielle française de 2012. Un homme à qui tout réussit…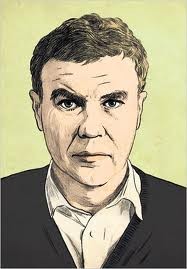
 Blogres est avant tout un blog littéraire. En ce sens, il défend la littérature. Et cette défense commence par l'école. A plus forte raison quand celle-ci marche sur la tête.
Blogres est avant tout un blog littéraire. En ce sens, il défend la littérature. Et cette défense commence par l'école. A plus forte raison quand celle-ci marche sur la tête. Michael Beard est un glandeur. Buveur, trompeur, coureur de femmes, il voit son cinquième mariage se finir par sa faute: onze liaisons en quatre ans. Il est petit, rondouillard, veule, il gagne de l’argent en prêtant son nom à des organismes de recherche et en déclinant la même conférence devant des auditoires complaisants.
Michael Beard est un glandeur. Buveur, trompeur, coureur de femmes, il voit son cinquième mariage se finir par sa faute: onze liaisons en quatre ans. Il est petit, rondouillard, veule, il gagne de l’argent en prêtant son nom à des organismes de recherche et en déclinant la même conférence devant des auditoires complaisants. Le roman, une satire, explore les milieux scientifiques et écologiques. Il y a toutes sortes d’épisodes et de milieux, qui se fondent tout compte fait dans l’ensemble et contribuent à l’avancée de l’intrigue. C’est très drôle. L’épisode sur la banquise où Beard est invité pour voir l’avancée du réchauffement!
Le roman, une satire, explore les milieux scientifiques et écologiques. Il y a toutes sortes d’épisodes et de milieux, qui se fondent tout compte fait dans l’ensemble et contribuent à l’avancée de l’intrigue. C’est très drôle. L’épisode sur la banquise où Beard est invité pour voir l’avancée du réchauffement! C'est un livre à la fois très « public » et très secret que nous donne aujourd'hui Jacqueline de Romilly, la grande spécialiste de la Grèce. Très secret, tout d'abord, parce que le livre était achevé de longue date et gardé soigneusement dans un tiroir de son éditeur, Bernard de Fallois, car il ne devait être publié qu'à la mort de l'académicienne, décédée le 18 décembre 2010 à l'âge de 97 ans. Pudique et secret : le texte magnifique de Jacqueline de Romilly l'est constamment. Mais aussi très « public ». À la fois accessible, écrit dans une langue somptueuse, rythmée, vivante, et ouvert sur le monde.
C'est un livre à la fois très « public » et très secret que nous donne aujourd'hui Jacqueline de Romilly, la grande spécialiste de la Grèce. Très secret, tout d'abord, parce que le livre était achevé de longue date et gardé soigneusement dans un tiroir de son éditeur, Bernard de Fallois, car il ne devait être publié qu'à la mort de l'académicienne, décédée le 18 décembre 2010 à l'âge de 97 ans. Pudique et secret : le texte magnifique de Jacqueline de Romilly l'est constamment. Mais aussi très « public ». À la fois accessible, écrit dans une langue somptueuse, rythmée, vivante, et ouvert sur le monde.
 Pas moins de deux livres de Jérôme Meizoz viennent de paraître, différents l’un de l’autre.
Pas moins de deux livres de Jérôme Meizoz viennent de paraître, différents l’un de l’autre. par Jean-Michel Olivier
par Jean-Michel Olivier