VOYAGER DANS SA CHAMBRE
Antonin Moeri
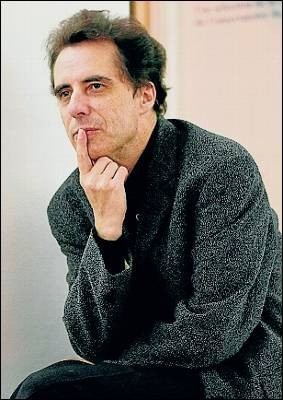
Jacques Mercanton raconte dans un petit livre un voyage à travers le pays de Vaud qu’il fit en compagnie de Joyce. Celui-ci s’est étendu sur la banquette du train et, étant aveugle, il pria Mercanton de lui dire à haute voix les noms des villages qu’ils traversaient. La musique des syllabes des noms de villages dans la bouche de l’écrivain lausannois suffisaient largement à Joyce pour entreprendre son voyage à lui, sa traversée d’un pays de Vaud sans doute plus palpitante que celle du touriste armé d’un BlackBerry dernier cri, l’oeil rivé sur le moindre clocher, la moindre auberge et le moindre tas de fumier.
Nous vivons à une époque où le récit de voyage est encensé. Ne nous parlez surtout pas de la chambre où vous tournez en rond avec vos aigreurs et vos borborygmes, parlez-nous je vous prie du désert de Gobi que vous avez parcouru, des crépuscules à Tahiti, de la traversée de la Californie que vous avez faite à moto, des minarets étincelants du Yémen que vous avez photographiés ou des rites séculaires de telle peuplade amazonienne que vous avez observée de près. Ce goût pour les relations de voyage à l’autre bout du monde m’a toujours semblé suspect, c’est pourquoi j’ai dévoré avec une voracité joyeuse l’essai de Pierre Bayard «Comment parler des lieux où l’on n’a pas été?»
Un livre m’intriguait énormément dans la bibliothèque paternelle: «Moeurs et sexualité en Océanie» de Margaret Mead. Je l’ouvrais souvent, au lieu de faire mes gammes au piano, et contemplais les images de filles nues. Un détail retint mon attention: le capuchon qui entoure le pénis des garçons. Tout ça m’excitait vivement et les scènes décrites par l’anthropologue américaine ne pouvaient que refléter une réalité concrète. Or Pierre Bayard nous apprend que Margaret Mead n’a séjourné que dix jours sur l’Île Samoa, préférant la villa d’un ami pour rédiger son livre à partir de témoignages de jeunes Samoannes émoustillées à l’idée de contribuer à une réflexion sur la liberté sexuelle des habitants de cette île.
En se basant sur les témoignages de jeunes informatrices qui venaient quotidiennement lui rendre visite, Margaret Mead a décrit une «île intérieure» qui lui servirait à faire avancer la thèse culturaliste qu’elle défendait et qui faisait alors rêver les Occidentaux. D’autres exemples (Marco Polo en Chine, Philéas Fogg autour du monde, Edouard Glissant visitant l’île de Pâques où il n’est jamais allé, Chateaubriand en Grèce et en Amérique) viennent corroborer l’hypothèse qu’il est littérairement beaucoup plus intéressant de décrire un lieu où l’on n’est pas allé que de décrire ce lieu après l’avoir systématiquement visité, exploré, photographié. L’invention étant plus passionnante que le document, le voyageur casanier faisant de plus belles descriptions que le pro du voyage, la puissance de l’imagination étant plus convaincante que l’observation participante.
Mais inventer un pays imaginaire pour déployer sa propre fantaisie peut relever de la mythomanie, comme ce fut le cas de Jean-Claude Romand, cet homme qui fit croire à sa famille qu’il était médecin et qu’il se rendait aux quatre coins du monde pour assister à des séminaires et à des colloques. Cet homme a construit un univers parallèle qui n’avait rien à voir avec l’habitacle de sa voiture rangée sur une aire de stationnement et dans lequel il feuilletait des prospectus d’agences de voyages et des guides de pays où le pseudo-docteur devait se rendre. On sait ce qu’il advint de ce mythomane. Emmanuel Carrère l’a plusieurs fois rencontré en prison avant de rédiger L’Adversaire, roman dans lequel l’auteur signale des points communs entre sa propre vie et l’existence falsifiée du tueur.
Pierre Bayard aurait pu ajouter Proust à sa liste de voyageurs casaniers. Proust qui préférait de loin la rêverie autour d’une ville italienne à la visite effective de cette même ville. Ce n’est pas pour contester ce que racontent les écrivains que Bayard propose de lire leurs récits sous un autre éclairage, mais pour apprécier ces récits «avec toute la force poétique et heuristique qu’ils possèdent dans l’invention des mondes possibles». Dans cet essai remarquablement écrit et allègrement mené, Bayard nous rappelle l’importance de la description littéraire, description qui peut se révéler utile quand vous devrez prouver, par exemple, qu’au moment de l’infraction, vous vous trouviez dans un lieu autre que celui où elle a été commise.
Pierre Bayard: Comment parler des lieux où l’on n’a pas été? Minuit, 2012
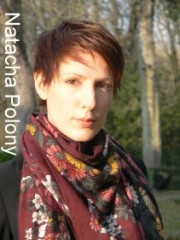 «Cette éviction de l’homme, autant que celle du père, est bien la pire défaite du féminisme. Car être débarrassé des hommes n’est certainement pas le meilleur facteur d’équilibre pour les femmes» (et inversement, pourrions-nous ajouter). Telle est la thèse principale de l’excellent essai de Natacha Polony, L’Homme est l’avenir de la femme, un brillant «droit d’inventaire» des travers et excès du féminisme, servi par un style et un sens de la formule remarquables, et qui a largement influencé ma démarche dans cette série de notes (une démarche que j’aurais entreprise dès la lecture de ce livre si la rédaction d’un roman m’en avait laissé le temps; c’est chose faite et justice rendue). Des positions «post féministes» à lire sans tarder pour celles ou ceux qui m’ont suivi cette semaine. On y découvre son auteur (sans «e», elle y tient) débarrassé de ce côté «maîtresse d’école» qu’elle montre parfois dans son rôle de sniper (snipeuse?) chez Laurent Ruquier, et qui pourrait en irriter plus d’un (moi, je l’adore même en maîtresse d’école).
«Cette éviction de l’homme, autant que celle du père, est bien la pire défaite du féminisme. Car être débarrassé des hommes n’est certainement pas le meilleur facteur d’équilibre pour les femmes» (et inversement, pourrions-nous ajouter). Telle est la thèse principale de l’excellent essai de Natacha Polony, L’Homme est l’avenir de la femme, un brillant «droit d’inventaire» des travers et excès du féminisme, servi par un style et un sens de la formule remarquables, et qui a largement influencé ma démarche dans cette série de notes (une démarche que j’aurais entreprise dès la lecture de ce livre si la rédaction d’un roman m’en avait laissé le temps; c’est chose faite et justice rendue). Des positions «post féministes» à lire sans tarder pour celles ou ceux qui m’ont suivi cette semaine. On y découvre son auteur (sans «e», elle y tient) débarrassé de ce côté «maîtresse d’école» qu’elle montre parfois dans son rôle de sniper (snipeuse?) chez Laurent Ruquier, et qui pourrait en irriter plus d’un (moi, je l’adore même en maîtresse d’école). Les mérites de l’auteur du Deuxième Sexe ne sont plus à souligner. Pourtant, les féministes de la deuxième génération n’ont pas ménagé leurs critiques envers la compagne de Sartre, accusée d’avoir voulu éradiquer la spécificité de la femme en l’affranchissant de son destin biologique et de sa fonction génitrice, considérée alors comme le point névralgique de sa soumission. Au fond, en voulant la conformer au modèle masculin, cette brave Simone serait passée à côté de ce qui constitue l’identité féminine et l’essence même du combat féministe.
Les mérites de l’auteur du Deuxième Sexe ne sont plus à souligner. Pourtant, les féministes de la deuxième génération n’ont pas ménagé leurs critiques envers la compagne de Sartre, accusée d’avoir voulu éradiquer la spécificité de la femme en l’affranchissant de son destin biologique et de sa fonction génitrice, considérée alors comme le point névralgique de sa soumission. Au fond, en voulant la conformer au modèle masculin, cette brave Simone serait passée à côté de ce qui constitue l’identité féminine et l’essence même du combat féministe. Combien de femmes (et d’hommes) ont assis leur notoriété sur le cadavre de l’émancipation qu’elles (ils) ont dépouillé de tout sens pour nourrir leur carrière? C’est cet état des lieux qu’établit Elisabeth Badinter dans un brillant petit essai intitulé Fausse route. Un titre évocateur pour une condamnation du nouvel ordre moral féminin constitué en ligue de vertu à coup d’oukases, d’anathèmes et de diabolisations. Car mettre sur le même plan les affres de la bourgeoise occidentale peinant à concilier vie privée et vie professionnelle, ou les dérives de publicités sexistes – cf. ma note sur Blogres:
Combien de femmes (et d’hommes) ont assis leur notoriété sur le cadavre de l’émancipation qu’elles (ils) ont dépouillé de tout sens pour nourrir leur carrière? C’est cet état des lieux qu’établit Elisabeth Badinter dans un brillant petit essai intitulé Fausse route. Un titre évocateur pour une condamnation du nouvel ordre moral féminin constitué en ligue de vertu à coup d’oukases, d’anathèmes et de diabolisations. Car mettre sur le même plan les affres de la bourgeoise occidentale peinant à concilier vie privée et vie professionnelle, ou les dérives de publicités sexistes – cf. ma note sur Blogres: 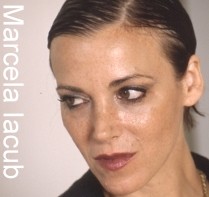 rogrès de l’humanité se mesurent dorénavant à l’aune de l’émancipation féminine, émancipation qui elle-même se mesure essentiellement aux pouvoirs qu’acquièrent nos consœurs et, surtout, à celui qu’elles retirent aux hommes. Finie la lutte des classes! Le sous-prolétariat exploité! Dans les années 80, face à l’essor du pan-libéralisme et au déclin du monde communiste, l’opposition hommes-femmes reste le seul paradigme de la domination. Et une riche bourgeoise sera toujours plus exploitée qu’un mineur de fond. La femme devient le porte-drapeau de l’idéologie victimaire qui s’est répandue dans cette période. Chaque homme doit faire son mea culpa public et confesser sa honte d’appartenir à une lignée d’hormones barbares. Il est ringard, caduc, triplement disqualifié: le passé l’accable, le présent l’accuse, le futur l’exclut. Il doit payer pour sa rédemption, surtout à son divorce, afin d’alimenter un assistanat qui, soudainement, n’est plus contradictoire avec émancipation (lire à ce sujet L’Empire du ventre de Marcela Iacub, juriste spécialisée en bioéthique et chantre du post féminisme, qui montre comment le système judiciaire éjecte le père pour laisser la place centrale à la relation mère-enfant). Des chanteurs de variété, dégoulinants de sincérité bêlante, célèbrent le genre qu’ils n’ont pas à grands coups de «Femmes je vous aime», de Julien Clerc à Sardou et son inénarrable «Femmes des années 80» en passant par Renaud et sa Miss Maggie: «Car aucune femme sur la planète n's'ra jamais plus con que son frère ni plus fière ni plus malhonnête à part, peut-être, Madame Thatcher». On avait connu Renaud plus inspiré en pourfendeur de clichés…
rogrès de l’humanité se mesurent dorénavant à l’aune de l’émancipation féminine, émancipation qui elle-même se mesure essentiellement aux pouvoirs qu’acquièrent nos consœurs et, surtout, à celui qu’elles retirent aux hommes. Finie la lutte des classes! Le sous-prolétariat exploité! Dans les années 80, face à l’essor du pan-libéralisme et au déclin du monde communiste, l’opposition hommes-femmes reste le seul paradigme de la domination. Et une riche bourgeoise sera toujours plus exploitée qu’un mineur de fond. La femme devient le porte-drapeau de l’idéologie victimaire qui s’est répandue dans cette période. Chaque homme doit faire son mea culpa public et confesser sa honte d’appartenir à une lignée d’hormones barbares. Il est ringard, caduc, triplement disqualifié: le passé l’accable, le présent l’accuse, le futur l’exclut. Il doit payer pour sa rédemption, surtout à son divorce, afin d’alimenter un assistanat qui, soudainement, n’est plus contradictoire avec émancipation (lire à ce sujet L’Empire du ventre de Marcela Iacub, juriste spécialisée en bioéthique et chantre du post féminisme, qui montre comment le système judiciaire éjecte le père pour laisser la place centrale à la relation mère-enfant). Des chanteurs de variété, dégoulinants de sincérité bêlante, célèbrent le genre qu’ils n’ont pas à grands coups de «Femmes je vous aime», de Julien Clerc à Sardou et son inénarrable «Femmes des années 80» en passant par Renaud et sa Miss Maggie: «Car aucune femme sur la planète n's'ra jamais plus con que son frère ni plus fière ni plus malhonnête à part, peut-être, Madame Thatcher». On avait connu Renaud plus inspiré en pourfendeur de clichés…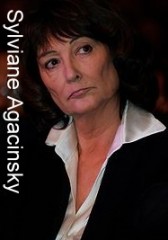 L’option naturaliste, très tendance à partir des années 1980-1990, d’abord à gauche de l’échiquier politique (le mouvement de libération de la femme a toujours été récupéré par la gauche: «Je suis socialiste, donc féministe» disait Jospin), qui se place, au contraire des culturalistes, sur le même terrain biologique que les discours essentialistes auxquels elle s’oppose. La femme a bel et bien un destin biologique qui, loin de la reléguer aux rôles subalternes, la propulse légitimement sur l’avant scène politique, et même économique: son utérus et ses deux chromosomes X fondent sa supériorité en ce qu’ils lui permettent d’accueillir l’Autre en elle, lui conférant ainsi, par essence, une richesse de dispositions inconnues des pauvres chromosomes XY. Voilà pourquoi elle est doublement l’avenir de l’homme. C’est l’option Sylviane Agacinsky dans Politique des sexes, grande inspiratrice du féminisme dans les années 90 et égérie de la politique féministe jospinienne.
L’option naturaliste, très tendance à partir des années 1980-1990, d’abord à gauche de l’échiquier politique (le mouvement de libération de la femme a toujours été récupéré par la gauche: «Je suis socialiste, donc féministe» disait Jospin), qui se place, au contraire des culturalistes, sur le même terrain biologique que les discours essentialistes auxquels elle s’oppose. La femme a bel et bien un destin biologique qui, loin de la reléguer aux rôles subalternes, la propulse légitimement sur l’avant scène politique, et même économique: son utérus et ses deux chromosomes X fondent sa supériorité en ce qu’ils lui permettent d’accueillir l’Autre en elle, lui conférant ainsi, par essence, une richesse de dispositions inconnues des pauvres chromosomes XY. Voilà pourquoi elle est doublement l’avenir de l’homme. C’est l’option Sylviane Agacinsky dans Politique des sexes, grande inspiratrice du féminisme dans les années 90 et égérie de la politique féministe jospinienne.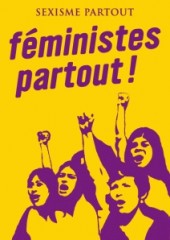 Une collègue écrivain – pardon! écrivaine –, peu après la création de «Blogres» à propos d’une note sur les quotas, m’envoyait un mail dans lequel elle précisait notamment: «Je reste rêveuse en lisant la composition de votre groupe de Blogres… Grands dieux, m’imaginerais-je qu’un beau jour vous vous êtes réunis et vous avez décrété: "pas de femmes parmi nous !" (…) Eh oui, même dans votre esprit progressiste, le masculin reste la norme».
Une collègue écrivain – pardon! écrivaine –, peu après la création de «Blogres» à propos d’une note sur les quotas, m’envoyait un mail dans lequel elle précisait notamment: «Je reste rêveuse en lisant la composition de votre groupe de Blogres… Grands dieux, m’imaginerais-je qu’un beau jour vous vous êtes réunis et vous avez décrété: "pas de femmes parmi nous !" (…) Eh oui, même dans votre esprit progressiste, le masculin reste la norme».


