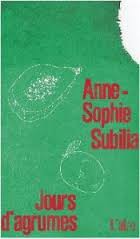L'Ami barbare (5)
C’est une journée étrange : comme nous, le soleil se lève tard. Les bois sont pleins de cris de bêtes. Il fait un froid presque sibérien, à ne pas mettre un Slave dehors. Un brouillard jaune monte des champs, imperceptiblement, comme l’haleine des morts.
On a dormi dans un bosquet, sur des lits de camp, près d’une route de campagne. Tu as fait du café sur le petit réchaud à gaz de la camionnette. On a mangé du pain et du lait caillé, des concombres au vinaigre, des tranches épaisses de salami coupées à l’opinel. Ensuite, on est allé faire un brin de toilette dans le petit ruisseau qui traverse la forêt.
Puis on se met en route. Mais on ne prend pas le chemin de la capitale.
« Où m’emmènes-tu encore, Roman ?
— J’aimerais passer par le village de Devic. Il y a là un monastère très important. L’un des rares à avoir échappé aux destructions.
— Mais notre rendez-vous ?
— Nous avons la journée devant nous. N’aie crainte, Pierre, nous serons à huit heures dans la capitale ! »
Nous roulons un bon moment, dans un paysage désolé, avant de traverser le village de Devic, abandonné par ses habitants. Aucun panneau pour indiquer la direction du monastère. Et personne à qui demander notre route. Nous croisons une jeep avec trois militaires en uniforme vert et rouge de l’armée de libération. À notre approche, ils ralentissent l’allure, nous lancent des regards soupçonneux.
« Si on leur demandait où se trouve le monastère ?
— Trop dangereux. »
Un peu plus loin, nous prenons un chemin de terre, plein de nids-de-poule et de flaques d’eau. Tu n’es jamais venu ici, mais on dirait que tu sais où tu vas. Le long du chemin défoncé, accrochés aux poteaux électriques ou cloués sur les portes des maisons, il y a des photos de femmes et d’enfants, portraits de morts ou de disparus.
Sous le regard silencieux des fantômes, nous arrivons enfin au monastère de Devic, une bâtisse imposante érigée au milieu du XIVe siècle. Avant la guerre, dix moniales y vivaient, cultivant les champs alentour pour subvenir à leurs besoins. Aujourd’hui, d’après ce que tu sais, elles ne sont plus que deux ou trois à vivre ici.
Nous frappons à la porte. Personne ne répond. À pied, dans le brouillard, nous faisons le tour du bâtiment.
Une aile du monastère a été défoncée par les roquettes. Le toit exhibe encore une large cicatrice noire. Les murs sont constellés d’impacts de balles. Nous revenons vers la porte principale. Nous frappons de nouveau.
Au bout de plusieurs minutes, un guichet au milieu de la porte s’ouvre et une voix de femme nous demande ce que nous voulons.
« Nous voulons visiter le monastère, dis-tu avec ta voix la plus chantante.
— D’où venez-vous ?
— De Suisse.
— Vous êtes de la police ?
— Non ! Nous sommes des pèlerins en voyage.
— Il n’y a plus rien à voir ici. Les Albanais ont tout détruit.
— Mais les icônes ?
— Quelles icônes ?
— Les fameuses icônes de Devic… »
La femme grommelle quelque chose derrière son guichet, hésite quelques instants, puis la porte s’ouvre.
C’est une petite femme sans âge, au visage sévère et pâle, encadré par un voile noir. Elle porte un habit de moniale. Malgré le froid, ses pieds sont nus et chaussés de sandales de cuir.
« Je vais voir si Sœur Anastasia, l’higoumène du monastère, peut vous recevoir. »
Nous suivons cette femme à travers les couloirs sombres, grimpons un escalier de pierre, pénétrons dans une pièce où brûle un feu de bois. Une autre femme, vêtue également d’un habit noir et le visage à demi voilé, nous fait signe de nous asseoir près de la cheminée.
« Que faites-vous par ici ?
— J’ai beaucoup entendu parler de votre monastère et, comme nous sommes dans la région, nous voulions voir vos fameuses icônes… »
Sœur Anastasia esquisse un sourire triste.
« Il n’y en a plus, hélas… »
D’une voix douce, elle appelle la petite moniale qui nous a ouvert la porte tout à l’heure, puis se tourne vers nous.
« Voulez-vous boire une tasse de thé pour vous réchauffer ?
— Avec plaisir. »
Quelques minutes plus tard, nous sommes assis tous les trois autour d’un thé brûlant, près d’un bon feu de bois.
« Nous n’avons pas de sucre, dit la religieuse. Mais, à la place, il y a cet excellent miel. »
Elle nous raconte l’histoire du monastère, détruit, puis reconstruit, puis détruit à nouveau.
« Depuis que je suis à Devic, j’ai tout vu et tout connu. Les récoltes brûlées, les attaques à coups de pierre, les bâtiments incendiés… La voiture du monastère visée par des tirs de fusils… Les roquettes sur le toit de l’église, alors que toutes les religieuses priaient…
— Vous n’avez jamais demandé de l’aide ?
— Au contraire, nous avons demandé aux soldats britanniques de nous protéger… Mais ils avaient sans doute des choses plus importantes à faire !
— Et alors ?
— Les autres sont revenus, ils nous ont menacés, battus, ils ont violé des religieuses… Ils étaient sûrs de leur impunité ! Ils nous ont laissé des jours sans manger, puis ils sont repartis… Mais avant de partir, ils ont cassé tout ce qu’ils pouvaient casser et volé les machines agricoles…
— Sur la route, nous avons vu ces photos de femmes et d’enfants…
— Ils ont tous disparu pendant la guerre.
— Ils ne sont jamais revenus ?
— Non. Ce sont des femmes ou des fils de paysans…
— Personne n’a jamais retrouvé leur trace ?
— Non. Mais tout le monde sait, ici, où ils ont disparu…
— Que voulez-vous dire ?
— On les a emmenés à la Maison Jaune…
— Quelle Maison Jaune ?
— Dans le hameau de Kureshi, au Sud de Burrel, en Albanie, il y a une maison aux murs peints en jaune. C’est là qu’on emmenait les civils, femmes et enfants, enlevés dans notre province. Là-bas, des chirurgiens prélevaient leurs organes, les yeux, les reins, le foie, qui étaient ensuite acheminés jusqu’à l’aéroport de Rinas pour être expédiés aux quatre coins du monde… »
La religieuse, prise de sanglots, ne peut aller plus loin.
« C’est incroyable ! dis-tu avec violence. Personne ne parle de ça…
— Un de vos compatriotes a écrit un rapport détaillé sur cette Maison Jaune. Mais personne ne l’a cru…
— Bien sûr, les gens ne pouvaient pas survivre à ces opérations effectuées dans des conditions précaires… D’ailleurs, ils ne devaient pas survivre : cela faisait partie du plan ! Ils succombaient à leurs blessures. Ensuite, on brûlait leur corps dans le jardin de la Maison Jaune. Certains ont été enterrés. C’est en retrouvant leurs restes qu’on a pu reconstituer l’histoire de ces disparitions… »
Assommés par ces révélations, nous gardons le silence, tête baissée, le nez dans notre tasse de thé brûlant.
« Personne n’est revenu ?
— Non, dit la vieille femme.
— On ne les a jamais retrouvés ?
— Non, jamais. Heureusement, il y a encore leur visage le long des routes de la province ! Ils nous sourient. Ils nous surveillent. Ils sont notre mauvaise conscience…
— Ils sont devenus des icônes, dis-tu.
— Oui. À la fois la preuve du Mal que l’homme faire et le signe que jamais, grâce à Dieu, ils ne disparaîtront tout à fait. »
La vieille femme se lève, comme pour nous signifier que nous devons partir. Nous nous levons à notre tour.
« Attendez-moi un instant ! »
Quelques instants plus tard, elle revient avec un petit panneau de carton sur lequel un artiste a peint un Christ crucifié. Le dessin est un peu maladroit ; le carton, effrangé et jauni. Mais les couleurs du Christ sont magnifiques. Comme souvent, le fils de Dieu sourit de sa douleur.
Elle te donne l’icône dans les mains.
Tu la regardes longuement en silence, tu poses tes lèvres sur le bout de carton et tu te mets à pleurer.
« C’est la dernière icône que nous possédons. Toutes les autres ont été brûlées pendant la guerre. »

 L’essai de Françoise Héritier est un petit bijou. L’auteur aime les mots et les a tourné et retourné dans tous les sens, avec sensualité et intelligence, afin de les examiner. Elle nous livre ses découvertes. En voici quelques-unes :
L’essai de Françoise Héritier est un petit bijou. L’auteur aime les mots et les a tourné et retourné dans tous les sens, avec sensualité et intelligence, afin de les examiner. Elle nous livre ses découvertes. En voici quelques-unes :
 it » de son père à qui il consacre quelques lignes d’un pur régal, n’omettant pas au passage de stigmatiser les faiseurs de mythes autour de la figure paternelle, ceux qui en ont fait un gourou, tous ces commentaires, ces livres, ces génuflexions, alors qu’en relation intime, le fils se souvient surtout de l’homme blessé, fragile et seul. Et il le retrouve ainsi, fumant une cigarette, dans un petit café de l’Oklahoma, le fils retrouve son père défunt dans leur présence au monde commune. Ciao, c’est fait, le fils peut repartir et son prénom désormais est son nom.
it » de son père à qui il consacre quelques lignes d’un pur régal, n’omettant pas au passage de stigmatiser les faiseurs de mythes autour de la figure paternelle, ceux qui en ont fait un gourou, tous ces commentaires, ces livres, ces génuflexions, alors qu’en relation intime, le fils se souvient surtout de l’homme blessé, fragile et seul. Et il le retrouve ainsi, fumant une cigarette, dans un petit café de l’Oklahoma, le fils retrouve son père défunt dans leur présence au monde commune. Ciao, c’est fait, le fils peut repartir et son prénom désormais est son nom.