L'Estrée
Par Anne Bottani-Zuber
Octobre venu, dire : « Et si on allait à l’Estrée ? » De la même manière qu’on dit, quand reviennent les beaux jours : « Et si on mangeait sur le balcon ? »
Quitter Lausanne direction Moudon, rouler une vingtaine de minutes, tourner à gauche, admirer un panorama, admirable justement – celui des Alpes fribourgeoises. Suivre en musardant – eh oui ! on peut musarder en voiture ! – le chemin des écoliers entre des fermes, des pommiers, des silos, des vaches brunes et blanches et grasses. Arriver à Ropraz.
Entrer dans le cimetière qui ressemble à une allée monumentale. A la place d’arbres d’ornement, des tombes. Se recueillir sur celle de Chessex avec la certitude que là où il est, les âmes sont moins tourmentées qu’ici-bas. Quitter le cimetière, les tombes fleuries de roses, de lierre et de bruyère.
Entrer à l’Estrée avec au cœur une délicieuse curiosité. Etre saisi par les hommes-troncs d’ Adrian Fahrländer, des hommes de bois brûlé, des hommes bleus qui avancent – ou chantent ? - chacun pour soi en même temps qu’on les sent vivre dans la plus grande des fraternités. S’arrêter devant l’homme à la rose, l’homme désarmé qui supplie, silencieux. Les hommes bleus dialoguent avec les œuvres de Nele Gesa Stürler. Des photographies de corps, de végétaux, de roche retravaillées à l’acrylique. Qui donnent à voir, au delà du visible, ce qui vibre en chacun de nous.
Les sculptures et les photos dialoguent avec des textes d’Haldas, celui-ci en particulier : « Homme de l’aube, de l’enfance, de la graine. Mais homme aussi des racines. Et qui habite avec les racines sous la terre, dans la nuit de la terre, la boue, la solitude. Car c’est dans cette zone invisible, obscure, ignorée de presque tous que s’élabore la plante avec sa tige et, au sommet de sa tige, la fleur … Le visible à l’invisible. »
De retour à la maison, relire quelques livres d’Haldas. Retrouver cet écrivain qui, grâce à un long et patient travail d’écriture, nous amène à sentir – ou nous conforte dans l’intuition - qu’à travers le visible nous pouvons entrevoir l’invisible. Haldas qui nous dit aussi que ce qui fonde notre fraternité est plus grand que nous. Et que nous sommes « pareils (…) à ces gouttes infimes mais qui ne brillent que par la lumière qui les traverse. Ces milliers de gouttes éparses rayonnant de la même lumière. Venues d’un même soleil » (Le Soleil et l’Absence, Ed. l’Age d’Homme, 1991).
Dimanche d’octobre. La nuit est tombée, trop tôt. Adrian Fahrländer, Nele Gelsa Stürler, Georges Haldas… Je vois des liens apparaître, se nouer, se défaire, puis reprendre. Trois artistes. Une même quête. Celle de dire « la fraternité de l’aube ».
Et qu’Haldas, qui a rejoint Chessex une année après lui dans le paradis des écrivains – qui soit dit en passant est le même paradis que celui de tout le monde - me pardonne le mot de quête s’il le trouve trop pompeux. C’est celui-là qui convient.
L’exposition « La fraternité de l’aube » a lieu à la Fondation l’Estrée à Ropraz du 7 septembre au 28 octobre 2013 – www.estree.ch
Anne Bottani-Zuber est écrivain. Dernier livre paru: Anne ou les cahiers de ma mère, Vevey : éditions de l'Aire, 2010
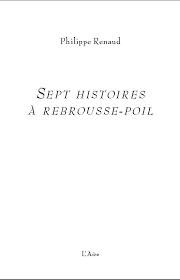 Le professeur Renaud, mon ami et mon maître, s'amuse et nous instruit. Ses histoires à rebrousse-poil, d'une fantaisie charmeuse et d'une plaisante érudition, interrogent quelques notions constitutives de l'identité (le nom, le lieu, le sexe, le rêve, le voyage...) sous une forme passionnante.
Le professeur Renaud, mon ami et mon maître, s'amuse et nous instruit. Ses histoires à rebrousse-poil, d'une fantaisie charmeuse et d'une plaisante érudition, interrogent quelques notions constitutives de l'identité (le nom, le lieu, le sexe, le rêve, le voyage...) sous une forme passionnante.







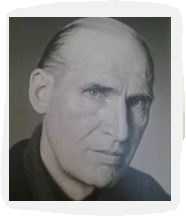 Le nom de C.– F. Landry se limitait dans ma mémoire à un vague rappel de ces livres d’école primaire où l’on apprenait vocabulaire et grammaire à l’aide d’un pot-pourri de phrases d’auteurs. Et c’est peut-être pour cette raison même que je n’ai jamais cherché à en savoir plus: C. – F. c’était forcément pour Charles-Ferdinand, un sous produit de l’autre – du nôtre donc –, du vrai, du seul, de l’unique... Jusqu’à ce que les Editions Campiche ne publient l’année dernière en collection de poche L’Affaire Henri Froment au moment où médias et lecteurs n’étaient préoccupés que par la vérité d’une autre Affaire (cet automne, c’est au tour La Devinaize, le roman le plus célèbre de C- F. Landry, de sortir en camPoche).
Le nom de C.– F. Landry se limitait dans ma mémoire à un vague rappel de ces livres d’école primaire où l’on apprenait vocabulaire et grammaire à l’aide d’un pot-pourri de phrases d’auteurs. Et c’est peut-être pour cette raison même que je n’ai jamais cherché à en savoir plus: C. – F. c’était forcément pour Charles-Ferdinand, un sous produit de l’autre – du nôtre donc –, du vrai, du seul, de l’unique... Jusqu’à ce que les Editions Campiche ne publient l’année dernière en collection de poche L’Affaire Henri Froment au moment où médias et lecteurs n’étaient préoccupés que par la vérité d’une autre Affaire (cet automne, c’est au tour La Devinaize, le roman le plus célèbre de C- F. Landry, de sortir en camPoche). Jean-Yves Dubath, dont j'apprécie l'écriture (voir
Jean-Yves Dubath, dont j'apprécie l'écriture (voir  C'est érudit, labyrinthique, étrange, charmeur, déconcertant, obscur, plein de nostalgie, d'amour et de désir, de noms à demi-oubliés et de scènes suggérées. Du coup, le lecteur est ravi, décontenancé ou complètement perdu, surtout si, comme moi, il n'a que quelques souvenirs vagues de certains des films de Rainer Werner Fassbinder.
C'est érudit, labyrinthique, étrange, charmeur, déconcertant, obscur, plein de nostalgie, d'amour et de désir, de noms à demi-oubliés et de scènes suggérées. Du coup, le lecteur est ravi, décontenancé ou complètement perdu, surtout si, comme moi, il n'a que quelques souvenirs vagues de certains des films de Rainer Werner Fassbinder.