essai sur Beckett paru en 2006
par antonin moeri
«Les vies silencieuses de Samuel Beckett». Non, ce n’est pas une biographie. Ce sont quelques séquences, «alternances de vides et de pleins», quelques détails ou incidents qui persistent sous forme d’images: les allées et venues entre Paris et Dublin (où vit sa mère sévère et jalouse, grande bourgeoise chic «le bibi vissé sur un oeil bleu qui luit dans l’ombre» et avec laquelle Sam eut les conflits les plus violents), les nombreuses séances chez le psychanalyste au cours desquelles Sam tressaille, pleure et claque des dents, sa tentative manquée de travailler avec Eisenstein qu’il aurait rencontré chez Joyce, ses tribulations à travers l’Allemagne nazie (1936-37) où il fréquente les zoos, les cimetières, les cabarets (Karl Valentin) et les musées (Sam était fou de peinture).
Il y a aussi la fascination pour l’oeuvre et le personnage de Joyce et, bien sûr, le plus important: «la recherche de la misère de ses mots, de la matière de sa parole, la recherche de sa langue impossible, de sa langue de dépossédé», une recherche que Beckett mènera dans la langue française (non dans la langue anglaise), la langue de Descartes, de Flaubert et de Proust dans laquelle il écrira coup sur coup, au septième étage d’un immeuble parisien: Mercier et Camier, Molloy, Malone meurt, L’innommable, Godot, Textes pour rien.
Nathalie Léger évoque également la rencontre avec Jérôme Lindon, lequel deviendra, grâce à Beckett, le grand éditeur français qu’il est devenu. Est également évoquée la banale petite maison grise que Sam fit construire à Ussy, où il allait se réfugier pour jardiner, écrire, «regarder les herbes essayant de pousser entre les pierres», où il construisit un haut mur rébarbatif autour du cube anodin pour se protéger des intrus. Il allait également à Ussy pour lire Leopardi et Maître Eckhart, traquer les taupes dans le jardin.
Le lecteur n’échappe pas aux séjours de Sam et Suzanne à Malte, à Tunis, à Tanger. Quelques mots sur Suzanne, cette professeur de piano qu’il a rencontrée sur un court de tennis, qui coud quand il écrit, qui achète de la nourriture bio, qui n’aime pas beaucoup les coquetèles, qui range la vaisselle quand il reste immobile dans le noir. Et puis, il y a la rencontre avec Roger Blin, leur collaboration, leur amitié indéfectible.
Ce petit essai est écrit avec beaucoup de tact et d’élégance. Style elliptique et clair pour essayer de cerner un éblouissement, ce qu’on pourrait appeler une conversion à l’écriture, pour essayer de comprendre comment ont pu naître des textes aussi parfaits que «Oh les beaux jours», «La dernière bande», «Premier amour» ou «L’innommable». Mais comment dire cet éblouissement? Sinon en rôdant inlassablement autour de l’essentiel, «comme si tourner autour d’une sorte de pot vous réservait des moments exquis». (R.Walser)
Nathalie Léger: Les vies silencieuses de Samuel Beckett, Allia, 2006


 Il se passe, dans ce petit livre d'Antoinette Rychner, ce que tous les propriétaires de chats craignent et attendent : la disparition de l'animal.
Il se passe, dans ce petit livre d'Antoinette Rychner, ce que tous les propriétaires de chats craignent et attendent : la disparition de l'animal. Donc, le chat Pépin a disparu. Prune, la petite fille, Aurélie, la mère, le coussin bleu puis le voisin placent des lettres dans la chatière. En creux, une histoire s'esquisse, du passé est évoqué, les relations évoluent. Ça donne un petit roman épistolaire charmant, doux, triste et cajoleur comme un félin de poche.
Donc, le chat Pépin a disparu. Prune, la petite fille, Aurélie, la mère, le coussin bleu puis le voisin placent des lettres dans la chatière. En creux, une histoire s'esquisse, du passé est évoqué, les relations évoluent. Ça donne un petit roman épistolaire charmant, doux, triste et cajoleur comme un félin de poche.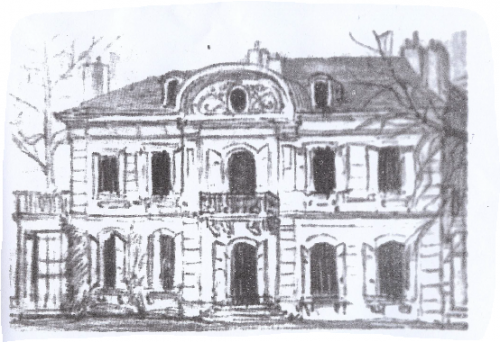

 Mais quelle forme ? Dans la deuxième histoire, le fils d'un père muré dans son travail invente un récit à partir d'une vieille photo : tsar, peinture, bague, poings serrés. Au cœur de celle-ci, le peintre André, au lieu de copier ce qu'il a sous les yeux, crée des scènes enchanteresses.
Mais quelle forme ? Dans la deuxième histoire, le fils d'un père muré dans son travail invente un récit à partir d'une vieille photo : tsar, peinture, bague, poings serrés. Au cœur de celle-ci, le peintre André, au lieu de copier ce qu'il a sous les yeux, crée des scènes enchanteresses.




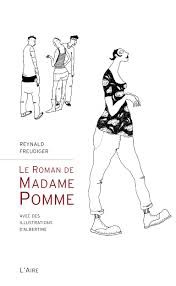 Il faut, d'abord, imposer Le roman de Madame Pomme à tous les centres de formation d'enseignants comme ouvrage principal. Deuxième mesure : les directions des lycées, collèges, etc. les offriront aux professeurs. Le livre sera également fourni aux parents d'élèves et aux élèves eux-mêmes. Et, bien entendu, il est conseillé à tous ceux qui ont étudié dans une école. C'est ainsi que tous ceux qui fréquentent ou ont fréquenté le monde scolaire acquerront la pointe de dérision et de malice qui leur permettra de relativiser les situations vécues et de réenchanter leur quotidien.
Il faut, d'abord, imposer Le roman de Madame Pomme à tous les centres de formation d'enseignants comme ouvrage principal. Deuxième mesure : les directions des lycées, collèges, etc. les offriront aux professeurs. Le livre sera également fourni aux parents d'élèves et aux élèves eux-mêmes. Et, bien entendu, il est conseillé à tous ceux qui ont étudié dans une école. C'est ainsi que tous ceux qui fréquentent ou ont fréquenté le monde scolaire acquerront la pointe de dérision et de malice qui leur permettra de relativiser les situations vécues et de réenchanter leur quotidien.