Le livre est plus passionnant que le film.
Par Antonin Moeri

On connaît l’antienne: l’école publique, en Europe, est un vaste chantier où les expériences les plus saugrenues sont encouragées au nom de... Les responsables sont fébriles. Après le laxisme, retour à l’autoritarisme. On crée des commissions pour rédiger des règlements: si la casquette n’est pas autorisée, le bandana le sera-t-il? Perplexité des intervenants. Si le mot clitoris est régulièrement tracé au feutre indélébile sur les pupitres, quelle stratégie adopter pour éradiquer cette mauvaise habitude? Y a des profs qui s’en foutent! hurle une débutante. Le principal la rassure: S’ils ne jouent pas le jeu, tu nous les signales, on leur fera comprendre!
C’est exactement ce que pourrait raconter François Bégaudeau dans son livre Entre les murs. Mais le pessimisme et le regard désabusé ne sont plus de mise. Le créneau a été pris trop souvent: Altschull, Barrot, Capel, Boutonnet, Kuntz, Milner, Michéa, Lurçat, Goyet... Tout le monde est au courant: on a cassé l’école républicaine, l’enseignement a été vidé de sa substance, l’horreur pédagogique a triomphé. Et pourtant, les ados continuent de fréquenter ces étranges lieux de vie, certains parents continuent d’assister à des réunions et de signer des carnets scolaires, les profs continuent d’évaluer le comportement des jeunes, d’écouter l’Autre, d’élever la voix, de corriger des textes argumentatifs. Des profs au crâne rasé, percings dans les sourcils et au bord des oreilles, jean déchiré, qui tombent en extase devant Matrix et Les Simpson, écoutent le même rap que leurs élèves, portent le même sweat que leurs élèves, sur lequel un vampire décrète Apocalypse now! Des profs qui, malgré la platitude de leurs propos et leur orthographe déficiente, se prennent très au sérieux. Voyons! Leur mission est d’éduquer!
Souleymane, Youssouf, Djibril et Hadia ne savent pas pourquoi ils vont à l’école. Après que... suivi du subjonctif ou de l’indicatif? Peu leur chaut. Et pourtant... Quand Aïcha décide d’y aller, c’est toujours avec une heure de retard... Or Ming se prend au jeu: les temps du récit au passé, ça l’intéresse... Et dans la salle dite des maîtres, Gilles avale son second Lexomil, Elodie lit son horoscope dans un journal. Le principal affirme qu’il faut rentabiliser les heures de français. Il ouvre des pistes de réflexion. Il propose de changer les horaires fixés par son prédécesseur... On se croirait dans une farce... On imagine Céline mettant en scène cette bande de guignols: le perpétuel boudeur qui refuse de tomber sa capuche, celle qui va se plaindre de la dureté d’un prof auprès de la nouvelle psy, l’enseignante d’histoire bien fringuée qui fait la morale “avec une miette de pepito collée à la lèvre inférieure”. Le vacarme, la gabegie, la difficile transmission du sens des mots, les acrobaties chaplinesques du pion se contorsionnant entre les cultures, les règles de grammaire, les races, les règles de vie, les droits de l’homme et les montagnes d’emmerdements, la componction compatissante du conseiller social faisant la collecte pour payer les frais d’enterrement du père de Salimata, les coups de pied de l’intendant dans la photocopieuse, le racisme anti-Blanc des enfants de victimes du colonialisme français, la “pétasse” qui lit La République offrent un matériau idéal pour écrire un roman.
Viens, on va regarder la télé! dit un père à sa fille qui se sent obligée de voir avec lui les tétons énormes, les cuisses qui s’ouvrent, le membre turgescent. Quant à Soumaya, elle préfère regarder la télé en Egypte, parce que là-bas,”on est tranquille, on n’a pas toujours la main sur la télécommande des fois qu’y aurait du sexe”. Excellent sujet pour débattre, exprimer un désaccord, écouter l’Autre, transmettre des valeurs et produire, in fine, un texte argumentatif. Mais un récalcitrant casse l’ambiance. Il trouve que, le onze septembre, les terroristes ont eu raison de planter les avions dans les tours. Alors là, trop c’est trop! Carnet de correspondance! Il est convoqué chez la psy. Elle aurait passé un contrat avec lui. Il ne devra plus dire des choses pareilles. Et voilà que le sang a pissé. Souleymane a frappé un camarade. L’encapuchonné doit comparaître devant un conseil de discipline. L’éducatrice lui trouve des circonstances atténuantes: le père vient de... !
Vous l’aurez compris, ce qui intéresse Bégaudeau, ce sont surtout les chaînes sonores qui se croisent dans ce lieu déterritorialisé qu’est l’école publique actuelle. Il scrute attentivement et passionnément une langue vivante qui s’articule au plus près des pulsions. Pour capter les ondes émotives, il transcrit les tics langagiers, les éructations et les mélodies dans son laboratoire, chambre d’échos où le lecteur perçoit les voix claires ou enrouées de Khoumba, Gibran et Jiajia, toutes ces affirmations maladroites, ces phrases syncopées et ces hoquets de rage voués à l’oubli, ce non-dit où prolifèrent les germes de ressentiment, d’aigreur, de haine et de violence... La meilleure posture à adopter devant ce sidérant lieu de vie ou hôpital de jour que les décideurs politiques nomment Ecole-Santé (sic) est sans doute celle de l’écrivain: montrer les choses avec précision et légèreté, ne pas les commenter. En cela, l’entreprise de Bégaudeau est réussie.
Son travail sur la langue me semble beaucoup plus intéressant que la vague racoleuse sur laquelle surfe le film de Cantet.
François Bégaudeau: “Entre les murs”, Folio 2007
![calvin3[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/01/00/2394101857.jpg) piration syntaxique (la grammaire du 16e siècle ne fait pas la distinction entre les conjonctions de coordinations et de subordinations). Par opposition, lisez Calvin. Des phrases courtes, sans rhétorique, un vocabulaire simple, une syntaxe ordonnée, une volonté d’argumenter par la multiplication des coordinations («car») et de s’accommoder aux petits (un style qui ressemble à celui de Mathurin Cordier, son professeur de latin): «Or il convient estendre ce qui a esté faict en un sainct à tous les autres, veu que c’est une mesme raison. Mais encore que nous laissions là les sainctz, advisons que dit sainct Paul de Jesus Christ mesmes. Car il proteste de ne le congnoistre…». Oui, Calvin a inventé la phrase courte et fait évoluer la langue française vers une langue de débat. Son empreinte stylistique ira jusqu’à Malherbe dont on sait qu’il fut à l’origine de la mode du classicisme.
piration syntaxique (la grammaire du 16e siècle ne fait pas la distinction entre les conjonctions de coordinations et de subordinations). Par opposition, lisez Calvin. Des phrases courtes, sans rhétorique, un vocabulaire simple, une syntaxe ordonnée, une volonté d’argumenter par la multiplication des coordinations («car») et de s’accommoder aux petits (un style qui ressemble à celui de Mathurin Cordier, son professeur de latin): «Or il convient estendre ce qui a esté faict en un sainct à tous les autres, veu que c’est une mesme raison. Mais encore que nous laissions là les sainctz, advisons que dit sainct Paul de Jesus Christ mesmes. Car il proteste de ne le congnoistre…». Oui, Calvin a inventé la phrase courte et fait évoluer la langue française vers une langue de débat. Son empreinte stylistique ira jusqu’à Malherbe dont on sait qu’il fut à l’origine de la mode du classicisme. Une réputation, bonne ou mauvaise, est toujours un atout. C'est à cause de la sienne, exécrable, que j'ai lu du Robert Brasillach.
Une réputation, bonne ou mauvaise, est toujours un atout. C'est à cause de la sienne, exécrable, que j'ai lu du Robert Brasillach.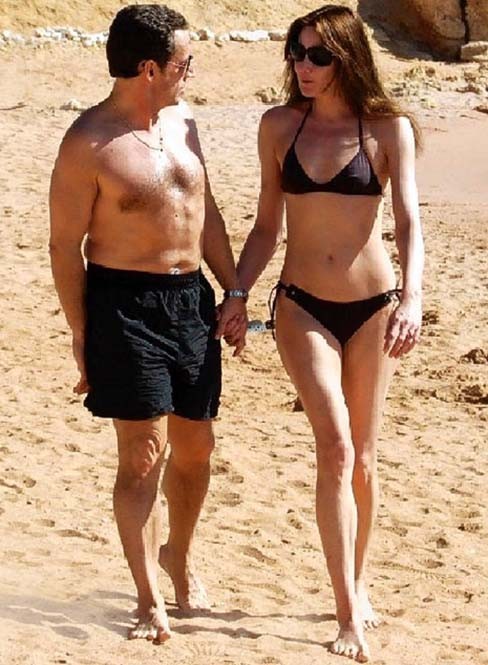 PAR ANTONIN MOERI
PAR ANTONIN MOERI![praille5[2].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/02/00/3935330282.jpg)
 Je suis donc allé voir, comme beaucoup de gens, l'exposition que la fondation Gianadda a montée pour les 100 ans de la naissance de Balthus.
Je suis donc allé voir, comme beaucoup de gens, l'exposition que la fondation Gianadda a montée pour les 100 ans de la naissance de Balthus.