Littérature et catégories
Par Pierre Béguin
Le premier travail du chercheur consiste à créer des catégories. Pas de processus analytique sans les opérations de base: dénoter, classer, nominaliser, structurer. En Sciences comme en Art. La littérature n'échappe pas à ce processus. Ainsi, lorsqu'on parle littérature, à plus forte raison littérature contemporaine, si l'on veut savoir de quoi on parle, il faut commencer par catégoriser, malgré la part inévitable d'arbitraire et de subjectif qu'implique cette démarche.
Roland Barthes distinguait deux types de textes: d'un côté, le texte de plaisir, celui qui contente, emplit, donne de l'euphorie, qui s'inscrit dans une continuité culturelle en évitant toute tentative de rupture et qui «est lié à une pratique confortable de la lecture»; de l'autre, le texte de jouissance, celui qui déstabilise, déconforte - peut-être jusqu'à un certain ennui - qui fait vaciller «les assises historiques, culturelles, psychologiques du lecteur, la consistance de ses goûts, de ses valeurs, de ses souvenirs, et qui met en crise son rapport au langage». Durant l'hégémonie de la littérature intransitive instaurée par le nouveau roman, cette distinction se radicalisa parfois dans les milieux universitaires au point que, par opposition à la mythification du «texte de jouissance», le «texte de plaisir» se vit reléguer, au mieux, dans les toilettes pour autant que sa fonction n'y fût pas celle de la lecture.
Plus proche de nous, le professeur Dominique Viart, spécialiste de cette littérature contemporaine qui émerge à la fin des 70's et qui postule un nouveau type d'enjeux et de pratiques esthétiques, apporte une nuance supplémentaire en distinguant trois types de littérature qu'il nomme «consentante», «concertante» et «déconcertante» (cf. La littérature française au présent, Ed. Bordas).
La littérature «consentante» est celle qui correspond aux attentes de la société, sans pour autant être essentiellement caractéristique de notre époque. Elle vise le plaisir, le divertissement (au sens noble), dans une sorte d'atemporalité et s'inscrit dans une forme plutôt académique. Les romans qu'elle produit suivent des modèles institués par l'histoire littéraire depuis le 19e siècle et ses auteurs, souvent avec talent, travaillent un peu comme un ébéniste qui fabriquerait un buffet Henri IV ou un fauteuil Voltaire. C'est la tradition de l'Académie, des Goncourt et des prix littéraires.
La littérature «concertante» est plus marchande qu'artisanale. Elle est un produit fabriqué autour de standards reconnus pour une clientèle cible. Elle capte l'air du temps sans vraiment l'interroger, elle s'avance à grand bruit médiatique et elle ne vit que le temps d'une rose avant de tomber dans la fosse commune de l'oubli en compagnie des objets de mode les plus hétéroclites auxquels, en fin de compte, elle appartient.
La littérature «déconcertante» ne recherche ni public cible ni conventions. Elle bouscule le lecteur, le prend à rebrousse-poil («La lecture, cette habitude» disait Mallarmé), elle le déplace, le prive de repères. Bref, elle le «déconcerte». Ses textes sont difficiles. Ils soumettent le lecteur à l'épreuve de l'étrangeté en réinventant la langue («Tous les beaux livres sont écrits en langue étrangère» prétendait Proust). Contrairement à la littérature «consentante» où la langue est avant tout instrument, moyen, aussi séduisant soit-il, à la littérature «concertante» où elle n'est qu'emprunt à la mode, la langue, dans la littérature «déconcertante», se pose comme finalité absolue et comme principal sujet d'exploration.
Bien entendu, des auteurs peuvent circuler d'une catégorie à l'autre. Ainsi est-il de bon ton d'affirmer dans «les milieux autorisés» que Houellebecq est passé de la littérature «déconcertante» - Extension du domaine de la lutte - à la littérature «concertante» -Plateforme. De même, un livre peut emprunter aux différentes catégories, voire se situer à leur carrefour, au bénéfice potentiel de ratisser plus large mais au risque de déplaire fortement à la critique spécialisée qui préfère les pures races aux bâtards.
Car une fois ces catégories répertoriées, la tentation est grande de les hiérarchiser. L'Université et les intellectuels n'échappent pas à ce travers, parfois avec un parti pris irritant, se tournant résolument vers ce qui nourrit le mieux la glose (la littérature «déconcertante») et dédaignant les autres catégories, comme si la qualité d'un texte dépendait essentiellement de la quantité d'éléments interprétatifs susceptibles de lui donner sens. A mon humble avis, si l'on accepte ces distinctions, le plus pertinent serait d'en souligner les phénomènes de circulation: si la littérature «déconcertante» finit par féconder les autres genres au même titre que la recherche finit par trouver des applications dans notre quotidien - et, en ce sens, elle peut légitimement revendiquer un statut à part -, elle existe aussi parce que les deux autres catégories le lui permettent, ne serait-ce qu'économiquement. Et surtout parce que l'initiation à la lecture doit passer par des textes accessibles au grand public, aussi «concertants», calibrés et médiatisés soient-ils. La survie de la littérature comme sujet d'étude, déjà remise en cause au nom de l'utilitarisme, en dépend. N'en déplaise à l'Université. Et à beaucoup de professeurs de l'enseignement secondaire qui feraient bien de s'en aviser parfois dans le choix de leurs textes...
 Il semble un peu paradoxal de lire aujourd’hui des textes publiés sur un blog à l’occasion de l’Euro 2008. Surtout si, comme moi, on n’est pas un amateur de foot.
Il semble un peu paradoxal de lire aujourd’hui des textes publiés sur un blog à l’occasion de l’Euro 2008. Surtout si, comme moi, on n’est pas un amateur de foot. De plus, on ressort de ce petit livre plus intelligent qu’on y est entré. Les larmes d’Arshavin ne se compose pas seulement de commentaires sur la compétition, mais aussi de réflexions sur le football et ses à-côtés: pub, femmes de joueurs, présentatrices sportives, politique et marques déposées...
De plus, on ressort de ce petit livre plus intelligent qu’on y est entré. Les larmes d’Arshavin ne se compose pas seulement de commentaires sur la compétition, mais aussi de réflexions sur le football et ses à-côtés: pub, femmes de joueurs, présentatrices sportives, politique et marques déposées...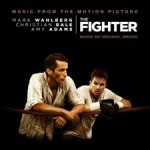 par Jean-Michel Olivier
par Jean-Michel Olivier La vie est un combat, certes. Contre soi-même, contre la société. Contre sa famille, d'abord. Il faut tuer son frère, dont l'ombre envahissante menace à chaque instant de vous engloutir. Il faut s'arracher aux griffes de sa mère qui préférera toujours son frère junkie parce qu'ainsi, shooté à mort, il n'échappe pas à sa toute-puissance castratrice . Oui, The Fighter est un film œdipien. Pour advenir à soi-même, il faut d'abord tuer les autres. Ceux qui sont le plus proches. Dans le film, Micky y parvient grâce à Charlene (délicieuse Amy Adams) qui l'aide à rompre les amarres.
La vie est un combat, certes. Contre soi-même, contre la société. Contre sa famille, d'abord. Il faut tuer son frère, dont l'ombre envahissante menace à chaque instant de vous engloutir. Il faut s'arracher aux griffes de sa mère qui préférera toujours son frère junkie parce qu'ainsi, shooté à mort, il n'échappe pas à sa toute-puissance castratrice . Oui, The Fighter est un film œdipien. Pour advenir à soi-même, il faut d'abord tuer les autres. Ceux qui sont le plus proches. Dans le film, Micky y parvient grâce à Charlene (délicieuse Amy Adams) qui l'aide à rompre les amarres.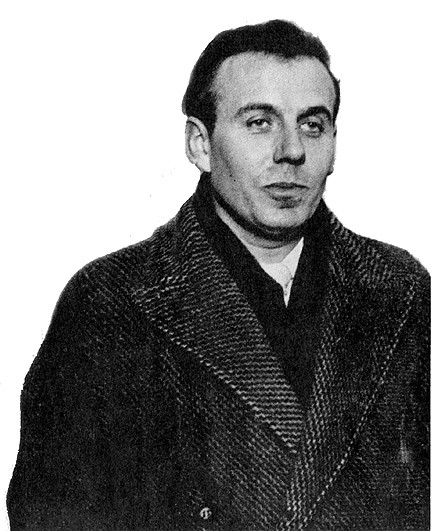
 La Cour des grands, c’est l’histoire d’un bug informatique. Trois auteurs de livres de gare, habitués à produire des romans industriels qui parlent de voyage, de sport ou de pornographie, sont invités par erreur à participer à une tournée d’écrivains romands. Ils y sont confrontés à l’ire du Grand Homme du lieu, reconnu par Paris, pour qui on parle de Pléiade et de Prix Nobel, et qui refuse que ces pitres l’approchent.
La Cour des grands, c’est l’histoire d’un bug informatique. Trois auteurs de livres de gare, habitués à produire des romans industriels qui parlent de voyage, de sport ou de pornographie, sont invités par erreur à participer à une tournée d’écrivains romands. Ils y sont confrontés à l’ire du Grand Homme du lieu, reconnu par Paris, pour qui on parle de Pléiade et de Prix Nobel, et qui refuse que ces pitres l’approchent.
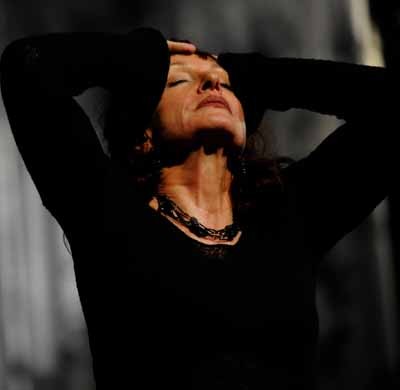

![rolin90[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/00/02/339086602.jpg) Tigre en papier est une sorte de temps retrouvé, celui des années 70, plongeant le lecteur en plein mysticisme d'un engagement politique qui entendait alors, par une rupture sociale radicale, faire communiquer - communier? - deux extrêmes hétérogènes de la toile sociale: l'élite bourgeoise de la jeunesse intellectuelle et la frange ouvrière prolétarienne à peine scolarisée (l'image phare de cette utopie reste la venue très médiatisée de Sartre aux usines Renault).
Tigre en papier est une sorte de temps retrouvé, celui des années 70, plongeant le lecteur en plein mysticisme d'un engagement politique qui entendait alors, par une rupture sociale radicale, faire communiquer - communier? - deux extrêmes hétérogènes de la toile sociale: l'élite bourgeoise de la jeunesse intellectuelle et la frange ouvrière prolétarienne à peine scolarisée (l'image phare de cette utopie reste la venue très médiatisée de Sartre aux usines Renault).
 Delerm, Michel Vinaver, etc. Leur apparition est rappelée dans une liste finale. En tout trente-deux auteurs pour trente-quatre petits textes délectables, classés dans un ordre alphabétique qui est bien entendu un leurre.
Delerm, Michel Vinaver, etc. Leur apparition est rappelée dans une liste finale. En tout trente-deux auteurs pour trente-quatre petits textes délectables, classés dans un ordre alphabétique qui est bien entendu un leurre.