exterminons les vieux!
par antonin moeri
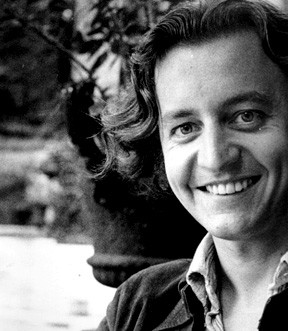
«Chasseurs de vieux» est une nouvelle de Buzzati que le lecteur a envie de «relire trois cents fois», comme dit une journaliste culturelle de la radio romande. C’est l’histoire de Roberto Saggini, un séduisant quadra qui, vers deux heures du matin, arrête sa voiture pour aller acheter des cigarettes. Quand il sort du bar-tabac, une bande de voyous lui tombe dessus. Ce sont des jeunes animés par la haine des vieux qu’ils rendent responsables «de leur mélancolie, de leurs désillusions». Des ados flattés par les journaux, la radio, la télé, le cinéma. Leur slogan: «L’âge est un crime». Roberto s’enfuit entre les roulottes d’une fête foraine. Il cogne durement un des crânes rasés qui se révèle être son propre fils. Il court dans un bois, descend une colline, traverse une rivière, se retrouve au bord d’un gouffre et tombe dans le vide. Cette course folle a tellement épuisé les rebelles que Regora, leur chef, s’est brusquement transformé en vieillard édenté, aux joues flasques et aux paupières flétries. Désormais, c’est lui que poursuivront les cailleras en colère.
Cette petite fable réserve un rare bonheur de lecture. En effet, je partage avec Regora et ses potes l’idée que les vieux sont répugnants et qu’il faut à tout prix les supprimer. C’est d’ailleurs ce que suggère Théraulaz dans son spectacle: comment peut-on supporter la crasse sénile, les dents qui tombent, le diabète, les cheveux blancs, la prostate enflammée, la ménopause avilissante, l’hypertension déroutante, l’alzheimer, le cancer sournois, l’ulcère douteux, le fibrome sidérant, les céphalées chroniques, les flatulences désobligeantes, l’hémorroïde du désastre, la fistule infamante, le filet de bave au coin de la gueule? Il serait tellement plus simple de placer des containers au coin des rues, dans lesquels on verserait les cadavres de vieux torturés, étranglés ou égorgés au préalable. La municipalité recevrait l’ordre d’acheminer leur contenu vers un gigantesque crématoire.
On vivrait enfin sur une planète zéro défaut, une planète propre peuplée d’enfants prodiges encensés par les publicitaires, «encouragés à s’imposer de n’importe quelle façon», qu’on pourra remuer devant les caméras et faire parler «avec un vocabulaire jeune, des arguments jeunes, des valeurs jeunes». Ce que raconte Buzzati avec son humour raffiné, Muray le développe, avec l’efficacité guerrière de son style flamboyant, dans «La jeunesse est un naufrage».
Dino Buzzati: Le K,, Pocket, 1992
Philippe Muray: Exorcismes spirituels, Les belles lettres, 1997
 Reporter, écrivaine et photographe, Laurence Deonna est l’invitée le 4 avril de Serge Bimpage qui préside désormais la Compagnie des Mots. Depuis 45 ans, elle arpente le Proche et le Moyen-Orient et observe d’un œil attentif les révolutions qui couvent dans ces régions. Le rôle des femmes occupe une place essentielle dans ses réflexions. Avec la surprise de Vincent Aubert, comédien. Lundi 4 avril, 18h30, au restaurant de la Mère Royaume,
Reporter, écrivaine et photographe, Laurence Deonna est l’invitée le 4 avril de Serge Bimpage qui préside désormais la Compagnie des Mots. Depuis 45 ans, elle arpente le Proche et le Moyen-Orient et observe d’un œil attentif les révolutions qui couvent dans ces régions. Le rôle des femmes occupe une place essentielle dans ses réflexions. Avec la surprise de Vincent Aubert, comédien. Lundi 4 avril, 18h30, au restaurant de la Mère Royaume,
 Variation des personnages de Lawrence Durrell dans
Variation des personnages de Lawrence Durrell dans  Même chose pour l'Anglais Darley. Sa compagne à lui, Mélissa a été entretenue par un homme impliqué dans le trafic d'armes. Si celui-ci a fait des confidences à sa maîtresse, qu'elles ont été répétées à Darley, il devient dangereux. L'amour de Justine a donc pour but de le sonder, de le contrôler.
Même chose pour l'Anglais Darley. Sa compagne à lui, Mélissa a été entretenue par un homme impliqué dans le trafic d'armes. Si celui-ci a fait des confidences à sa maîtresse, qu'elles ont été répétées à Darley, il devient dangereux. L'amour de Justine a donc pour but de le sonder, de le contrôler.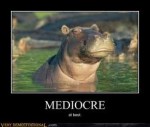 Prenez le train, l'avion, le paquebot! N'ésitez pas à passer les frontières ! Quittez votre fauteuil cossu pour aller respirer l'air du dehors, ailleurs, loin de vos Alpes…
Prenez le train, l'avion, le paquebot! N'ésitez pas à passer les frontières ! Quittez votre fauteuil cossu pour aller respirer l'air du dehors, ailleurs, loin de vos Alpes…
 Que faire alors ? Multiplier les passerelles. Ouvrir des brèches (comme les blogs, par exemple). Briser cette conjuration étrange du silence et de l'incompétence. Le complot triste des éteignoirs. Lire et faire lire les ouvrages qu'on aime.
Que faire alors ? Multiplier les passerelles. Ouvrir des brèches (comme les blogs, par exemple). Briser cette conjuration étrange du silence et de l'incompétence. Le complot triste des éteignoirs. Lire et faire lire les ouvrages qu'on aime.

 par Jean-Michel Olivier
par Jean-Michel Olivier Car tout, dans le livre écrit à quatre mains d'Olivier Adam et d'Arnaud Auzouy, appartient aux fantômes. L'atmosphère, les images, l'air même qu'on y respire. Nous sommes dans un pays marqué par la disparition.
Car tout, dans le livre écrit à quatre mains d'Olivier Adam et d'Arnaud Auzouy, appartient aux fantômes. L'atmosphère, les images, l'air même qu'on y respire. Nous sommes dans un pays marqué par la disparition. On le voit : ce livre est sans doute prophétique. Comme Simon Steiner, son héros, erre à travers une forêt de fantômes, il nous montre un pays qui, déjà, n'existe plus. Bien sûr, Kyoto n'est pas Fukushima. Mais il est facile d'imaginer ce qu'elle serait après un tremblement de terre ou une catastrophe nucléaire. Les photos d'Arnaud Auzouy en portent témoignage. On dirait que ce livre a été écrit juste avant la catastrophe. Et qu'il garde intacte la trace de ce qui va disparaître. De ce que nous avons perdu.
On le voit : ce livre est sans doute prophétique. Comme Simon Steiner, son héros, erre à travers une forêt de fantômes, il nous montre un pays qui, déjà, n'existe plus. Bien sûr, Kyoto n'est pas Fukushima. Mais il est facile d'imaginer ce qu'elle serait après un tremblement de terre ou une catastrophe nucléaire. Les photos d'Arnaud Auzouy en portent témoignage. On dirait que ce livre a été écrit juste avant la catastrophe. Et qu'il garde intacte la trace de ce qui va disparaître. De ce que nous avons perdu.