Le 20 septembre, à la Fondation de l'Estrée, à Ropraz, le prix Edouard-Rod 2014 a été remis à Antoine Jaquier pour son formidable roman Ils sont tous morts. Voici la laudatio que Corine Renevey, membre du Jury, prononça à cette occasion.
Henri Crisinel : « C’est là que m’attend Satan »
Il n’y a pas de drogués heureux (1977) disait le docteur Claude Olivenstein en 1977, Antoine Jaquier nous le rappelle et son roman qui n’est ni un témoignage ni une autobiographie, s’inscrit 36 ans plus tard dans cette lignée d’œuvres qui évoquent de manière saisissante l’univers des drogués, telles que Flash ou le Grand Voyage de Charles Duchaussois (1971), L’Herbe bleue ou Moi Christiane F (1978). L’humour, la vivacité du style et la poésie en plus !
 « Qui de Dieu ou du diable est le plus puissant ? » D’entrée de jeu, Antoine Jaquier ouvre le roman sur la question que pose Manu, l’autiste de la bande d’adolescents et qui trouve la réponse entre deux flots de fumée : « Dieu créa l’homme, Satan le flingue ». On pourrait peut-être ajouter à la lecture de ce roman : l’homme créa les paradis artificiels, la femme le salut, Satan la dépendance qui balise la descente en enfer. Dès lors s’amorce un combat inégal entre les forces du bien et du mal, entre la liberté et les dépendances trop chères payées, entre l’amour salutaire et l’esclavage, voire le tourisme sexuel, une lutte disproportionnée qui sera le fil rouge du roman. L’originalité de ce récit est justement de montrer avec drôlerie et lucidité, cette lente dérive de jeunes paumés qui rêvent d’expériences inédites et d’horizons lointains. L’auteur sait nous garder à distance de ce milieu glauque et désespéré.
« Qui de Dieu ou du diable est le plus puissant ? » D’entrée de jeu, Antoine Jaquier ouvre le roman sur la question que pose Manu, l’autiste de la bande d’adolescents et qui trouve la réponse entre deux flots de fumée : « Dieu créa l’homme, Satan le flingue ». On pourrait peut-être ajouter à la lecture de ce roman : l’homme créa les paradis artificiels, la femme le salut, Satan la dépendance qui balise la descente en enfer. Dès lors s’amorce un combat inégal entre les forces du bien et du mal, entre la liberté et les dépendances trop chères payées, entre l’amour salutaire et l’esclavage, voire le tourisme sexuel, une lutte disproportionnée qui sera le fil rouge du roman. L’originalité de ce récit est justement de montrer avec drôlerie et lucidité, cette lente dérive de jeunes paumés qui rêvent d’expériences inédites et d’horizons lointains. L’auteur sait nous garder à distance de ce milieu glauque et désespéré.
 Dans cette bande d’adolescents désœuvrés, il y a d’abord, Jack, le narrateur de 17 ans dont le frère aîné est héroïnomane et sidéen. C’est lui qui va raconter le destin tragique de ses camarades mêlant humour, autodérision et poésie. Ensuite il y a Manu qui n’a pas inventé la poudre et qui a pour seule amie une télévision. Il boit, il fume, même ses ongles de pieds pour connaître l’autarcie (36), touche à l’héroïne pour conjurer sa peur. « On le surnommera Bhopal du nom de la ville sinistrée (87) ». Et puis, il y a Bob, apprenti agricole, qui vit l’autarcie grâce à son champ de ganja, c’est un ami qu’on ne choisit pas qui tient des propos racistes mais avec qui on fait avec, car il a toujours un truc à rouler. Il pratique la cruauté animale en fixant à l’aide de pinces à linge, les ailes de moineaux effarouchés sur un fil d’étendage (31). C’est lui qui va encourager Jack à se faire tatouer un dragon japonais sur le bras et l’initier aux champignons hallucinogènes. Et puis il y a Steph, le philosophe de la bande et Tony qui vit dans un appartement qui ressemble à une jungle : « la vraie avec la verdure et les bêtes ». Ensemble, on zone, on commence par la fumette (joint, narguilé, pipe à eau), on se réjouit déjà du prochain trip, on fait des mélanges de toutes sortes, on chasse le dragon et on se rend vite compte que tous ne sont pas égaux face aux dépendances. Il y a ceux qui s’en sortent en fumant occasionnellement et ceux qui, comme Jack, le narrateur sont incapables de maîtriser leur consommation. « Si j’y touche, dit Jack, je m’inscris sur une liste d’attente pour l’enfer » (88). Malgré cette lueur de lucidité, Jack va y toucher et c’est à travers son expérience que l’on comprend que les effets de la dope le transportent loin, très loin dans un déni de réalité.
Dans cette bande d’adolescents désœuvrés, il y a d’abord, Jack, le narrateur de 17 ans dont le frère aîné est héroïnomane et sidéen. C’est lui qui va raconter le destin tragique de ses camarades mêlant humour, autodérision et poésie. Ensuite il y a Manu qui n’a pas inventé la poudre et qui a pour seule amie une télévision. Il boit, il fume, même ses ongles de pieds pour connaître l’autarcie (36), touche à l’héroïne pour conjurer sa peur. « On le surnommera Bhopal du nom de la ville sinistrée (87) ». Et puis, il y a Bob, apprenti agricole, qui vit l’autarcie grâce à son champ de ganja, c’est un ami qu’on ne choisit pas qui tient des propos racistes mais avec qui on fait avec, car il a toujours un truc à rouler. Il pratique la cruauté animale en fixant à l’aide de pinces à linge, les ailes de moineaux effarouchés sur un fil d’étendage (31). C’est lui qui va encourager Jack à se faire tatouer un dragon japonais sur le bras et l’initier aux champignons hallucinogènes. Et puis il y a Steph, le philosophe de la bande et Tony qui vit dans un appartement qui ressemble à une jungle : « la vraie avec la verdure et les bêtes ». Ensemble, on zone, on commence par la fumette (joint, narguilé, pipe à eau), on se réjouit déjà du prochain trip, on fait des mélanges de toutes sortes, on chasse le dragon et on se rend vite compte que tous ne sont pas égaux face aux dépendances. Il y a ceux qui s’en sortent en fumant occasionnellement et ceux qui, comme Jack, le narrateur sont incapables de maîtriser leur consommation. « Si j’y touche, dit Jack, je m’inscris sur une liste d’attente pour l’enfer » (88). Malgré cette lueur de lucidité, Jack va y toucher et c’est à travers son expérience que l’on comprend que les effets de la dope le transportent loin, très loin dans un déni de réalité.
« Bon voilà c’est fait, dit Jack, j’ai touché aux drogues dures. Je concrétise ces années de préparation subliminale de la pub, de la mode, de l’école, du catéchisme, du cinéma et de la téloche. Ridicule expérience. Les mises en gardes de Maman, des copains, de Chloé, des éducateurs et des flics me paraissent bien hors de proportion face à l’effet dérisoire de cette étrange substance… Quel tintouin autour de cette poudre, c’est juste cool et ça m’apaise, j’en reprendrai demain. » (146)
Attente démesurée et surmédiatisée, déni des effets des drogues de la part de Jack devenu accro dès la première prise.
En découvrant le milieu de la drogue, Jack vit ses premières expériences, d’abord avec Cynthia, la copine de Tony. Trop angoissé par cette soudaine intimité et trahison, Jack se soûle au whisky et finira dans un coma éthylique le jour de ses 17 ans. Il rencontrera lors d’une soirée chez Manu, la blonde Peggy, une esclave sexuelle prête à tout pour un snif de poudre blanche (82), et la belle Andalouse, sexy en diable, qui n’arrive pas à se faire un fix et que Jack aidera en dirigeant l’aiguille de la seringue dans sa jugulaire.
« J’ai hélas compris à quoi je dois servir ; elle n’arrive pas à s’injecter elle-même. (…) La fille est donc offerte, attendant mon office. (…) J’appuie sur la peau, l’aiguille perce d’abord puis pénètre la chair de quelques millimètres et soudain, le sang fait irruption dans la seringue. Sans hésitation, je tire un peu le piston, le sang et le liquide brunâtre se mélangent, puis je sais que c’est bon. Je balance la sauce, direct vers le cerveau sans passer par le start. (…)
Je viens de faire un shoot dans la gorge d’une junky, sans avoir même appris. (…) Je me tourne vers la fille, elle est en petite culotte et machinalement, je lui soupèse un sein. Que la chair est misère sans son soufle vital. Je couvre l’Andalouse et rejoins le plumard. (…) J’avale deux Rohypnols et en quelques minutes, je m’endors paisiblement. (84-85) »
Dans cette métaphore sexuelle, tout est dit de la misère humaine : l’utilisation de l’autre comme moyen, l’apocalypse du désir et la fulgurance du fix ephémère et non partagé. Pourtant Jack ne renonce pas totalement à l’amour.
Il tombe amoureux de Chloé prénom qui signifie en grec, la « verdoyante », « l’herbe naissante ». C’est une employée de commerce de 23 ans, un peu paumée elle aussi, qui couche avec un mécène de 40 ans son aîné pour payer ses études et continue la relation avec lui même si elle devient financièrement indépendante. Elle rêve de changer de vie, de partir en Thaïlande, de travailler pour l’humanitaire et économise les 50 000 francs nécessaires au voyage. Jack et sa bande rêvent également d’évasion et doivent trouver un moyen rapide de se procurer l’argent. Ils planifient ainsi un double braquage à main armée avec prise d’otage. Pour réussir le coup du siècle, il leur faut un chef, ce sera Tony, le plus âgé de la bande, ancien taulard qui s’occupera pendant le double braquage d’attaquer le poste de police, un plan élaboré à la seconde près, un pacte scellé de leur sang, une consigne très stricte : pas de drogue avant l’action, une date, deux faux flingues, car il n’est pas question de blesser voire de buter quelqu’un. Pour cette bande de rigolos, habitués au vol à l’étalage dans l’épicerie du coin, il n’est plus question de voler des friandises et des carambars. On devient bien plus ambitieux et audacieux sous l’emprise de Tony.
Reste à gérer l’attente interminable, le manque et le trac. Avec les 365 000 francs volés, ils vont organiser leur départ pour Bangkok, la ville des anges. 
Mais surtout, ils vont employer toute leur énergie pour organiser le manque qui guette à tout instant et qui finit par occuper entièrement leur esprit. De la Thäilande, ils ne connaîtront que le triangle d’or et les plages du sud, les dealeurs et leurs clients essentiellement occidentaux, les courses de tuk-tuk, les bars minables à GI’s, les pubs touristiques où se mélangent non sans violence les Thaïs et les farangs, le tourisme sexuel… Cette gangrène qui mine les rapports entre indigènes et occidentaux.
Chloé, le personnage lumineux qui porte en elle la vie naissante, s’inquiète de cette consommation permanente, et se sent exclue du groupe. Elle veut profiter de son voyage, rencontrer les habitants, visiter les sites, aider les enfants démunis. Elle tentera de sauver Jack en lui demandant instamment d’entreprendre une cure de désintoxication dans le monastère de Tham Kabrok. Sans succès, Jack sait qu’il est devenu un toxico, un homme possédé par le manque, parano et solitaire, un handicapé du registre de la compassion (43) incapable de retenir la femme qu’il aime.
C’est à travers cette bande de pieds nickelés, rigolards et pathétiques, qu’Antoine Jaquier nous décrit le parcours d’une génération sacrifiée, la génération qui avait 17 ans en 1985. Soyons clairs, malgré son ton humoristique, ce livre n’est pas une incitation aux drogues. Bien au contraire, l’auteur décortique avec l’œil lucide de ceux qui connaissent le terrain, les pièges qui mènent de l’autre côté du bon sens et de la raison. Et c’est pour cela qu’il faut le lire, nous les adultes, les parents, les enseignants et le transmettre aux nouvelles générations.
* Antoine Jaquier, Ils sont tous morts, l'Âge d'Homme, 2013.



 « Qui de Dieu ou du diable est le plus puissant ? » D’entrée de jeu, Antoine Jaquier ouvre le roman sur la question que pose Manu, l’autiste de la bande d’adolescents et qui trouve la réponse entre deux flots de fumée : « Dieu créa l’homme, Satan le flingue ». On pourrait peut-être ajouter à la lecture de ce roman : l’homme créa les paradis artificiels, la femme le salut, Satan la dépendance qui balise la descente en enfer. Dès lors s’amorce un combat inégal entre les forces du bien et du mal, entre la liberté et les dépendances trop chères payées, entre l’amour salutaire et l’esclavage, voire le tourisme sexuel, une lutte disproportionnée qui sera le fil rouge du roman. L’originalité de ce récit est justement de montrer avec drôlerie et lucidité, cette lente dérive de jeunes paumés qui rêvent d’expériences inédites et d’horizons lointains. L’auteur sait nous garder à distance de ce milieu glauque et désespéré.
« Qui de Dieu ou du diable est le plus puissant ? » D’entrée de jeu, Antoine Jaquier ouvre le roman sur la question que pose Manu, l’autiste de la bande d’adolescents et qui trouve la réponse entre deux flots de fumée : « Dieu créa l’homme, Satan le flingue ». On pourrait peut-être ajouter à la lecture de ce roman : l’homme créa les paradis artificiels, la femme le salut, Satan la dépendance qui balise la descente en enfer. Dès lors s’amorce un combat inégal entre les forces du bien et du mal, entre la liberté et les dépendances trop chères payées, entre l’amour salutaire et l’esclavage, voire le tourisme sexuel, une lutte disproportionnée qui sera le fil rouge du roman. L’originalité de ce récit est justement de montrer avec drôlerie et lucidité, cette lente dérive de jeunes paumés qui rêvent d’expériences inédites et d’horizons lointains. L’auteur sait nous garder à distance de ce milieu glauque et désespéré.

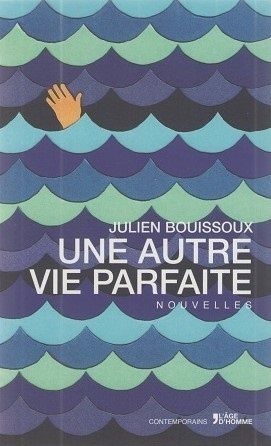 Une autre vie parfaite, c'est la vie qu'on aurait pu vivre, qu'on aurait voulu vivre, qui est à côté, ailleurs, derrière le temps ou derrière l'écran, et qui nous échappe. C'est ainsi que je comprends le titre du recueil de Julien Bouissoux, une suite de nouvelles prenantes, d'une tonalité sourde, lancinante, tendre et
Une autre vie parfaite, c'est la vie qu'on aurait pu vivre, qu'on aurait voulu vivre, qui est à côté, ailleurs, derrière le temps ou derrière l'écran, et qui nous échappe. C'est ainsi que je comprends le titre du recueil de Julien Bouissoux, une suite de nouvelles prenantes, d'une tonalité sourde, lancinante, tendre et  lus loin dans le live, un employé est oublié par sa boîte dans un bureau, continue à toucher de l'argent sans avoir rien à faire. Un autre se perd volontairement en mer, sur un rocher, au fond d'une grotte, se cache des secours qui le cherchent. Des hommes jouent à des jeux vidéos, substituts plus excitants que la réalité. La seule femme héroïne d'une nouvelle a couché avec une star de cinéma, quand ils étaient tous deux ados, et attend son déclin pour qu'il lui revienne.
lus loin dans le live, un employé est oublié par sa boîte dans un bureau, continue à toucher de l'argent sans avoir rien à faire. Un autre se perd volontairement en mer, sur un rocher, au fond d'une grotte, se cache des secours qui le cherchent. Des hommes jouent à des jeux vidéos, substituts plus excitants que la réalité. La seule femme héroïne d'une nouvelle a couché avec une star de cinéma, quand ils étaient tous deux ados, et attend son déclin pour qu'il lui revienne.

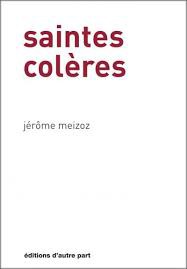 Jérôme Meizoz se met en colère. Ou plutôt, il y a quelques années qu'il l'est, si on se base sur les textes réunis dans Saintes colères.
Jérôme Meizoz se met en colère. Ou plutôt, il y a quelques années qu'il l'est, si on se base sur les textes réunis dans Saintes colères.  S'il est attentif aux auteurs de France, Meizoz ne dédaigne pas non plus de ferrailler chez nous. Il critique ainsi Le Miel de Slobodan Despot, en ciblant les enjeux idéologiques de son livre, qui tourne autour de la guerre en ex-Yougoslavie. On connaît la position pro-serbe qu'avait prise jadis Despot. Le combat continue, semble dire Meizoz en analysant son livre : « Après avoir échoué à convaincre dans sa revue et par ses paroles dans les années 90, S.Despot recourt désormais à la littérature comme discrète perfusion idéologique. »
S'il est attentif aux auteurs de France, Meizoz ne dédaigne pas non plus de ferrailler chez nous. Il critique ainsi Le Miel de Slobodan Despot, en ciblant les enjeux idéologiques de son livre, qui tourne autour de la guerre en ex-Yougoslavie. On connaît la position pro-serbe qu'avait prise jadis Despot. Le combat continue, semble dire Meizoz en analysant son livre : « Après avoir échoué à convaincre dans sa revue et par ses paroles dans les années 90, S.Despot recourt désormais à la littérature comme discrète perfusion idéologique. »