Ubu au Grütli
«Ubu Roi. La journée d’enthousiasme finit dans le grotesque. Dès le milieu du premier acte on sent que ça va devenir sinistre. Au cri de «merdre», quelqu’un répond: «Mangre!» Et tout sombre. Si Jarry n’écrit pas demain qu’il s’est moqué de nous, il ne s’en relèvera pas» écrit Jules Renard dans son journal, le 10 décembre 1896, au soir même de la première représentation d’Ubu Roi au Théâtre de l’Œuvre, un théâtre qui se distinguait alors par son esprit de recherche, ses choix novateurs et souvent risqués. «Un scandale ! – Il n’y a pas d’autre mot. Les premières répliques déchaînèrent le chahut. Des spectateurs s’en allèrent dès le début; certains révoltés restèrent. Courteline, debout sur un strapontin, criait: «Vous ne voyez pas que l’auteur se fout de nous!» Jean Lorrain, également furieux, s’enfuit. On se mit à brailler, à hurler» précise Lugné-Poe, le metteur en scène et directeur du Théâtre de l’Œuvre. Et encore Catulle Mendès: «Des sifflets? oui; des hurlements de rage et des râles de mauvais rires? oui; des loges vociférantes et tendant les poings? oui; et, en un mot, toute une foule furieuse d’être mystifiée, bondissante en sursaut vers la scène.» Jarry aurait par ailleurs contribué à attiser le scandale en demandant à des amis de jeter des projectiles sur les fauteuils d’orchestre. Hormis cette fameuse représentation du 10 décembre 1896, la pièce ne fut plus jamais jouée au Théâtre de l’Œuvre. Elle restera dans l’histoire du théâtre français comme sa troisième bataille après celles du Cid (1637) et d’Hernani (1830).
Jarry expliquait le scandale par le fait que cet horrible bonhomme nous ressemblait. Le public aurait contemplé dans le miroir du théâtre, non pas, comme Narcisse, sa face idéale, mais son double ignoble. On comprend dès lors les réactions de rejet: Ubu, avec son insatiable désir de posséder, sa goinfrerie, sa couardise, sa grossièreté et son sadisme, ne ferait qu’incarner nos pulsions inconscientes et refoulées, celles que l’on ne veut surtout pas voir et que, pour la première fois vraiment, selon Jarry, on exposait impudiquement sur scène: «L’éternelle imbécillité humaine, l’éternelle luxure, l’éternelle goinfrerie, la bassesse de l’instinct érigé en tyrannie; des pudeurs, des vertus, du patriotisme et de l’idéal des gens qui ont bien dîné» (Catulle Mendès). Des contemporains de Jarry virent dans Ubu l’image à peine caricaturale d’un anarchiste (à la fin du XIXe siècle, l’Europe connaissait une vague d’attentats anarchistes) qui ne tolère aucune loi, sauf celles qu’il édicte lui-même à son avantage, aucune limite, aucune règle de société. D’autres virent dans ce gros bonhomme la figure la plus radicalement opposée à celle de l’anarchiste: le bourgeois, figure consacrée par le XIXe siècle et systématiquement dénoncée par les artistes, avec son gros ventre, sa canne (son bâton à physique) et, surtout (selon ses détracteurs), ses attributs psychologiques: la bêtise, l’avidité et l’avarice. D’autres encore virent dans celui qui s’emparait illégitimement de territoires une satire de Bismarck ou de Guillaume 1e, ce que confirment quelques répliques renvoyant directement à l’une ou l’autre de ces figures historiques (la défaite de 1870 face à la Prusse est encore dans tous les esprits). D’autres enfin virent dans cette satire une métaphore même de la machine à décerveler (le bourgeois), élément principal de la chanson qui clôt la pièce en l’inscrivant dans la mouvance de la contre-culture ouvrière. Pour nous, avec le recul, Ubu revêt une dimension prophétique: ce comploteur qui s’empare de la Pologne avant de mener une folle politique de destruction systématique annonce le plus sinistre chef d’Etat du XXe siècle. Ubu devient alors l’incarnation du tyran absolu et universel, évoluant dans un univers dépourvu de toutes nos valeurs, de tous nos repères habituels: plus de distinctions entre le beau et le laid, le bien et le mal; la vie et la mort même ont volé en éclats et, avec elles, le temps, l’espace, les règles d’orthographe, de syntaxe et de lexique usuel. Aucune logique ne subsiste, aucun sens. Première figure de l’absurde, Ubu annonce aussi Dada et la dimension iconoclaste que prend l’art au début du XXe siècle.
J’ai pensé à tout cela, début mai, au Théâtre du Grütli. J’ai pensé à tout cela en voyant Phèdre sur scène incarnée en homme nu, à l’instar des autres personnages: vaine provocation à laquelle je ne parvenais pas à donner sens, hors clichés ou niaiseries. J’ai pensé à tout cela en lorgnant du coin de l’œil les quelques spectateurs dociles, immobiles, respectueux, attendant impatiemment la fin du spectacle (ou alors n’était-ce que l’effet d’une projection toute personnelle?) J’y pensais encore lorsque l’assistance est sortie lentement, sans bruit, sans réaction, en ordre dispersé. Mais où sont les théâtres d’antan? Au Grütli, ce soir-là, je me suis ennuyé avec Phèdre et distrait avec Ubu au milieu d’une salle amorphe.
Le Théâtre du Grütli est une salle d’expérimentation dédiée à la création locale. Un lieu de recherche, de travail… peut-on lire sur son site internet. Et si le Théâtre du Grütli s’était tout simplement trompé d’époque?




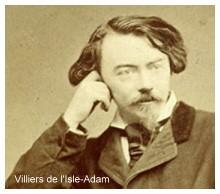
 Il y a quelque chose d’étonnant dans Viola, le texte que Silvia Ricci Lempen a donné au recueil
Il y a quelque chose d’étonnant dans Viola, le texte que Silvia Ricci Lempen a donné au recueil 

 Il faut rappeler, pour ceux qui vivraient sur une autre planète, ce qui agite la presse suisse ces jours-ci. Une vidéo qui montre un député valaisan nu et sniffant de la coke, filmé par une de ses maîtresses. Pour ceux qui ne l’auraient pas encore vue, elle est
Il faut rappeler, pour ceux qui vivraient sur une autre planète, ce qui agite la presse suisse ces jours-ci. Une vidéo qui montre un député valaisan nu et sniffant de la coke, filmé par une de ses maîtresses. Pour ceux qui ne l’auraient pas encore vue, elle est