Hommage à Muriel Cerf

par Jean-Michel Olivier
Pour les gens de ma génération, Muriel Cerf fut à la fois un modèle et un éblouissement. Un modèle, tout d'abord, parce que, née en 1950, elle est l'une des premières à prendre la route, à 17 ans, sur la trace des hippies, pour le fameux périple des trois K (Kaboul, Katmandou et Kuta). Voyage initiatique dont elle rapportera, un peu plus tard, deux livres extraordinaires : L'Antivoyage (1974) et Le Diable vert (1975), qui ont marqué une génération de voyageurs et d'écrivains (dont Nicolas Bouvier). Muriel Cerf nous a montrés les chemins de la liberté, quelquefois décevante ou illusoire, et la richesse du voyage.  Éblouissement, ensuite, d'un style unique dans la littérature française : ni relation de voyage au sens strict, ni récit purement imaginaire, ces deux livres nous proposent un tableau sensuel des impressions laissées par les lieux, les personnes, les événements rencontrés. L'écriture, déjà saluée par Malraux en 1974, est flamboyante, pleine de couleurs, d'odeurs, de saveurs insolites. Un éblouissement.
Éblouissement, ensuite, d'un style unique dans la littérature française : ni relation de voyage au sens strict, ni récit purement imaginaire, ces deux livres nous proposent un tableau sensuel des impressions laissées par les lieux, les personnes, les événements rencontrés. L'écriture, déjà saluée par Malraux en 1974, est flamboyante, pleine de couleurs, d'odeurs, de saveurs insolites. Un éblouissement.
 Muriel Cerf est décédée d'un cancer il y a dix jours. Aucun journal, en Suisse, n'en a parlé. Injustice scandaleuse, mais qui n'étonne personne, quand on connaît la presse de ce pays. Pourtant, elle a donné à la littérature française ses plus belles pages et incité de nombreux écrivains à partir sur ses traces. Elle a publié une trentaine de livres, essais et romans. Parmi les plus connus, citons Une passion (1981), hommage à Belle du Seigneur, d'Albert Cohen, ou encore Ils ont tué Vénus Ladouceur (éditions du Rocher, 2000).
Muriel Cerf est décédée d'un cancer il y a dix jours. Aucun journal, en Suisse, n'en a parlé. Injustice scandaleuse, mais qui n'étonne personne, quand on connaît la presse de ce pays. Pourtant, elle a donné à la littérature française ses plus belles pages et incité de nombreux écrivains à partir sur ses traces. Elle a publié une trentaine de livres, essais et romans. Parmi les plus connus, citons Une passion (1981), hommage à Belle du Seigneur, d'Albert Cohen, ou encore Ils ont tué Vénus Ladouceur (éditions du Rocher, 2000).
En hommage, je me permets de reproduire deux pages magnifiques de son Antivoyage.
« Jamais je n'ai vu tant d'étoiles et si près, sauf au Planétarium du Grand Palais; elles ont l'air accrochées si bas, juste un peu plus haut que des fruits sur un arbre, il suffit de se hausser sur la pointe des pieds pour les cueillir, faire un bouquet de nébuleuses spirales avec des queues en tentacules de gaz et des paillettes de strass autour, faucher une rivière de diamants qui brille trop pour être vraie, un peu de toc génial jeté aux quatre coins du ciel et qui reste figé là, dans un fourmillement à donner le vertige. Toutes les galaxies palpitent et tremblotent dans l'air si pur qu'on croit voir des pépites à travers un torrent de montagne. Regarde les étoiles, elles sont aussi grosses que les diamants en poire de la princesse Rosine, dis-je à Coulino qui n'a pas lu la comtesse de Ségur. On a nettoyé le vieux ciel usé par les regards des amoureux qui se chatouillent en regardant la lune, et on en a mis à la place un tout neuf, prêt pour de nouveaux poèmes.
 Les Himalayas, on les sent près, sans les voir. L'air de la nuit nous saoule de bouffées d'herbe humide. Les temples luisent sous la lune, recourbent les pointes dorées de leurs triples étages au milieu d'une mer de tuiles. De Katmandou, on ne distingue que le forme des toits qui lui donne déjà l'aspect d'une vraie cité asiatique, aussi différente des cités indiennes que des villes géantes d'Amérique. On respire l'haleine qui monte du fleuve proche, les parfums de santal brûlé dans les rues, le souffle glacé de la montagne, en écoutant les cloches des temples, les klaxons des voitures, les tintements des bicyclettes, imaginant le théâtre grouillant derrière les rideaux de la nuit; allongées sur la terrasse dans le châle de Coulino, ouvrant des yeux énormes, cherchant à deviner ce qui se passe en bas, on prend le pouls de cette ville nouvelle, on résiste à l'envie que l'on a d'y plonger, on préfère l'écouter, la respirer, la rêver, la plus belle la plus inquiétante, la plus légendaire, le décor le plus fou pour des dieux déguisés en hommes, de toute une mythologie vivante. Le taureau de Nandin doit crotter sur la place du marché, Krishna faire du marché noir, Jésus et Judas se balader dans les sentiers en robe blanche, le meilleur haschisch du monde pousser dans des pots, banal comme un géranium en France. Coulino, on en plantera un dans le jardin de notre maison, on le laissera grandir jusqu'au ciel et on grimpera dessus pour atteindre le sommet de L'Himalchuli et y planter un drapeau noir. Coulino ?
Les Himalayas, on les sent près, sans les voir. L'air de la nuit nous saoule de bouffées d'herbe humide. Les temples luisent sous la lune, recourbent les pointes dorées de leurs triples étages au milieu d'une mer de tuiles. De Katmandou, on ne distingue que le forme des toits qui lui donne déjà l'aspect d'une vraie cité asiatique, aussi différente des cités indiennes que des villes géantes d'Amérique. On respire l'haleine qui monte du fleuve proche, les parfums de santal brûlé dans les rues, le souffle glacé de la montagne, en écoutant les cloches des temples, les klaxons des voitures, les tintements des bicyclettes, imaginant le théâtre grouillant derrière les rideaux de la nuit; allongées sur la terrasse dans le châle de Coulino, ouvrant des yeux énormes, cherchant à deviner ce qui se passe en bas, on prend le pouls de cette ville nouvelle, on résiste à l'envie que l'on a d'y plonger, on préfère l'écouter, la respirer, la rêver, la plus belle la plus inquiétante, la plus légendaire, le décor le plus fou pour des dieux déguisés en hommes, de toute une mythologie vivante. Le taureau de Nandin doit crotter sur la place du marché, Krishna faire du marché noir, Jésus et Judas se balader dans les sentiers en robe blanche, le meilleur haschisch du monde pousser dans des pots, banal comme un géranium en France. Coulino, on en plantera un dans le jardin de notre maison, on le laissera grandir jusqu'au ciel et on grimpera dessus pour atteindre le sommet de L'Himalchuli et y planter un drapeau noir. Coulino ?
Géniale. Elle est géniale. Elle a disparu pour aller chercher à manger. Vendredi la renarde frisée reparaît avec deux plats en terre contenant de gigantesques yaourts couverts d'une crème verte épaisse et d'une montagne de sucre. La peau verte, on la pousse délicatement sur le bord, et on déguste le pur chef-d'oeuvre qui doit être un bouillon de culture pour amibes, mais on s'en fout, ah, mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Le plat lèché, Coulino m'offre un baiser bonne nuit à pleines lèvres, frotte son nez contre le mien à l'esquimaude, et on s'enroule dans la couverture qu'elle a montée de la chambre, dormir nous allons en plein dans la grande nuit maternelle. »
Extrait de L'Antivoyage, collection J'ai Lu, pp. 69-70

 Il faudrait ajouter : un mythe suisse, tant les valeurs qu’elle incarne (pureté, authenticité, amour de la nature) semblent être celles de ce pays.
Il faudrait ajouter : un mythe suisse, tant les valeurs qu’elle incarne (pureté, authenticité, amour de la nature) semblent être celles de ce pays.
 Miracle ! Grâce à Heidi, cet ange perdu parmi les hommes, Clara retrouvera l’usage de ses jambes et pourra marcher à nouveau !
Miracle ! Grâce à Heidi, cet ange perdu parmi les hommes, Clara retrouvera l’usage de ses jambes et pourra marcher à nouveau ! À la suite de Wissmer (photo de gauche), nous relisons Heidi d’un œil neuf, et souvent ironique (Heidi est une parfaite Putzfrau,
À la suite de Wissmer (photo de gauche), nous relisons Heidi d’un œil neuf, et souvent ironique (Heidi est une parfaite Putzfrau,
 D'autres lecteurs, moins raffinés peut-être, n'y comprenaient rien, perdaient leurs repères et étaient agacés. Le cadre, la temporalité, l'onomastique des romans sont volontairement brouillés. Le cycle a pour décor la ville de La Chaux-de-Fonds, ce qui n'est pas évident à saisir. Les noms, par exemple, mêlent patronymes anglais et français.
D'autres lecteurs, moins raffinés peut-être, n'y comprenaient rien, perdaient leurs repères et étaient agacés. Le cadre, la temporalité, l'onomastique des romans sont volontairement brouillés. Le cycle a pour décor la ville de La Chaux-de-Fonds, ce qui n'est pas évident à saisir. Les noms, par exemple, mêlent patronymes anglais et français.
 éguin
éguin
 Il a besoin des livres pour nourrir sa vie, et lui donner un sens. Chez lui, le verbe et la chair sont indissociables. Il faudrait ajouter le verbe aimer.
Il a besoin des livres pour nourrir sa vie, et lui donner un sens. Chez lui, le verbe et la chair sont indissociables. Il faudrait ajouter le verbe aimer. Son journal de bord, entre Amiel et Léautaud, rassemble ces éclats de lumière qui éclairent nos chemins de traverse. Ce sont les fragments d’une vie éparse — images fulgurantes, aphorismes, rêves, méditation sur la douleur, l’amitié ou le partage — qui trouvent leur unité dans l’écriture. Écrire, n’est-ce pas résister à ce qui nous divise ?
Son journal de bord, entre Amiel et Léautaud, rassemble ces éclats de lumière qui éclairent nos chemins de traverse. Ce sont les fragments d’une vie éparse — images fulgurantes, aphorismes, rêves, méditation sur la douleur, l’amitié ou le partage — qui trouvent leur unité dans l’écriture. Écrire, n’est-ce pas résister à ce qui nous divise ?
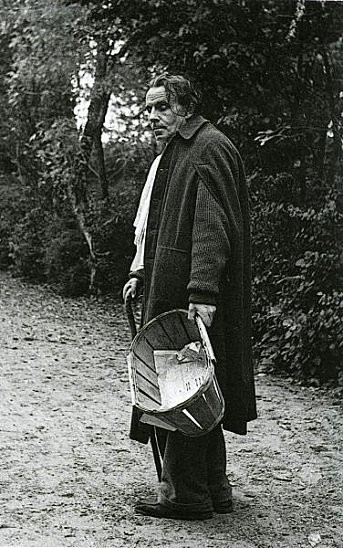
 Je n'avais jamais lu les pamphlets de Céline, cet auteur dont j'admire les romans. Il fallait s'y mettre un jour, pour compléter ma vision du problème Céline
Je n'avais jamais lu les pamphlets de Céline, cet auteur dont j'admire les romans. Il fallait s'y mettre un jour, pour compléter ma vision du problème Céline rônent le français « lycée » et blackboulent ses livres parce qu'ils ne veulent pas que son émotion atteigne les lecteurs aryens et leur fasse sentir quelque chose qui les réveillerait de leur esclavage. D'autres attaques visent les livres traduits, notamment de l'anglais, ceux de Faulkner, Dos Passos, Lawrence, Huxley, Shaw, livres, dit-il évidemment, de juifs ou d'enjuivés, célébrés, couronnés par des prix, achetés par les lecteurs. Ce qui fait que les siens ne se vendent pas.
rônent le français « lycée » et blackboulent ses livres parce qu'ils ne veulent pas que son émotion atteigne les lecteurs aryens et leur fasse sentir quelque chose qui les réveillerait de leur esclavage. D'autres attaques visent les livres traduits, notamment de l'anglais, ceux de Faulkner, Dos Passos, Lawrence, Huxley, Shaw, livres, dit-il évidemment, de juifs ou d'enjuivés, célébrés, couronnés par des prix, achetés par les lecteurs. Ce qui fait que les siens ne se vendent pas.