Lumières de l'invisible (Patrick Gilliéron Lopreno)
par Jean-Michel Olivier
 Depuis son invention en 1839 par Louis Daguerre (qui s'appuie, lui-même, sur les recherches de Nicéphore Niepce), la photographie n'a cessé de fasciner peintres et écrivains. Pour Honoré de Balzac, Théophile Gautier et Gérard de Nerval, elle avait des pouvoirs magiques. Pour d'autres, comme le roi de Naples, il fallait l'interdire, car elle était dangereuse, comme le mauvais œil…
Depuis son invention en 1839 par Louis Daguerre (qui s'appuie, lui-même, sur les recherches de Nicéphore Niepce), la photographie n'a cessé de fasciner peintres et écrivains. Pour Honoré de Balzac, Théophile Gautier et Gérard de Nerval, elle avait des pouvoirs magiques. Pour d'autres, comme le roi de Naples, il fallait l'interdire, car elle était dangereuse, comme le mauvais œil…
Cette nouvelle technique, comme on sait, a bouleversé l'histoire de la peinture, en libérant les peintres de l'obsession de reproduire, au détail près, la nature environnante. À quoi bon copier le réel quand on peut le faire à l'aide d'un simple appareil de photo ? La peinture, peu à peu, s'est plongée dans la couleur, puis déconstruite, pièce après pièce, dans l'abstraction, avec Kandinsky, Malevitch et Picasso. La photographie a également bouleversé la littérature : à partir de la moitié du XIXe siècle, les romanciers vont se documenter auprès des photographes, pour coller au plus près au réel (nous sommes toujours, par la grâce des prix littéraires, dans ce courant naturaliste ou réaliste de la littérature).
 Aujourd'hui, grâce aux écrans (TV, smartphones, ordinateurs), la photographie a triomphé partout et totalement : nous sommes submergés d'images, le plus souvent immatérielles, jusqu'à l'ivresse ou la nausée. Mais savons-nous encore regarder ? Et lire les images qui nous entourent, nous conditionnent, nous incitent à acheter certains produits (par la publicité) ou à voter pour certains partis (par la propagande politique) ? Cette profusion d'images ne constitue-t-elle pas un immense lavage de cerveau ?
Aujourd'hui, grâce aux écrans (TV, smartphones, ordinateurs), la photographie a triomphé partout et totalement : nous sommes submergés d'images, le plus souvent immatérielles, jusqu'à l'ivresse ou la nausée. Mais savons-nous encore regarder ? Et lire les images qui nous entourent, nous conditionnent, nous incitent à acheter certains produits (par la publicité) ou à voter pour certains partis (par la propagande politique) ? Cette profusion d'images ne constitue-t-elle pas un immense lavage de cerveau ?
 Heureusement, il y a encore des photographes qui nous prêtent leurs yeux pour voir le monde avec un regard neuf !
Heureusement, il y a encore des photographes qui nous prêtent leurs yeux pour voir le monde avec un regard neuf !
C'est l'expérience que l'on fait avec les belles photographies de Patrick Gilliéron Lopreno, reporter-photographe vivant à Genève, mais arpentant le monde avec son appareil en bandoulière, comme un chasseur de papillons avec son filet.
Ses images aux contours nets, aux atmosphères tantôt brumeuses, tantôt éclatantes de lumière, nous invitent à entrer dans une autre dimension du temps et de l'espace, où la méditation ouvre sur l'invisible. Lopreno aime photographier la nature  (les rivières, les champs de blé ou de coquelicots), souvent déserte, ou peuplée de quelques animaux : une sorte de paradis inviolé (qui correspond à l'image traditionnelle de la Suisse). Mais bientôt, des pylônes électriques envahissent les champs, ou les fumées d'une centrale nucléaire blanchissent le ciel. Les hommes, comme les animaux, paraissent incongrus, des ombres fuyantes, des êtres de passage. Le contraste est saisissant. Il dessine une fracture, une faille dans le réel que l'on n'avait pas remarquée au premier regard, mais qui n'a pas échappé à l'œil du photographe.
(les rivières, les champs de blé ou de coquelicots), souvent déserte, ou peuplée de quelques animaux : une sorte de paradis inviolé (qui correspond à l'image traditionnelle de la Suisse). Mais bientôt, des pylônes électriques envahissent les champs, ou les fumées d'une centrale nucléaire blanchissent le ciel. Les hommes, comme les animaux, paraissent incongrus, des ombres fuyantes, des êtres de passage. Le contraste est saisissant. Il dessine une fracture, une faille dans le réel que l'on n'avait pas remarquée au premier regard, mais qui n'a pas échappé à l'œil du photographe.
 Comme souvent, la photographie nous ouvre les yeux, quand le réel nous aveugle ou nous trompe. Il nous faut le regard du photographe pour aller sous l'écorce des choses, toucher l'os, la sève, le cœur vibrant de la nature. En faisant l'Éloge de l'invisible*, Patrick Gilliéron Lopreno explore cette faille dans les visages, les ciels, les paysages nus ou peuplés d'ombres fugaces, les vitraux d'une église, les fougères dans la cour d'un cloître.
Comme souvent, la photographie nous ouvre les yeux, quand le réel nous aveugle ou nous trompe. Il nous faut le regard du photographe pour aller sous l'écorce des choses, toucher l'os, la sève, le cœur vibrant de la nature. En faisant l'Éloge de l'invisible*, Patrick Gilliéron Lopreno explore cette faille dans les visages, les ciels, les paysages nus ou peuplés d'ombres fugaces, les vitraux d'une église, les fougères dans la cour d'un cloître.
Et de cette faille — qu'on appelle aussi mystère — jaillit à chaque fois la lumière.
* Patrick Gilliéron Lopreno, Éloge de l'invisible, Till Schaap Edition, 2018. Avec une préface très éclairante de Slobodan Despot.
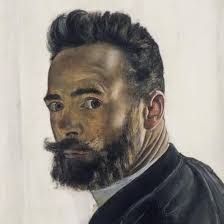









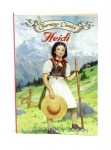
 Il faudrait ajouter : un mythe suisse, tant les valeurs qu’elle incarne (pureté, authenticité, amour de la nature) semblent être celles de ce pays.
Il faudrait ajouter : un mythe suisse, tant les valeurs qu’elle incarne (pureté, authenticité, amour de la nature) semblent être celles de ce pays.
 Miracle ! Grâce à Heidi, cet ange perdu parmi les hommes, Clara retrouvera l’usage de ses jambes et pourra marcher à nouveau !
Miracle ! Grâce à Heidi, cet ange perdu parmi les hommes, Clara retrouvera l’usage de ses jambes et pourra marcher à nouveau ! À la suite de Wissmer (photo de gauche), nous relisons Heidi d’un œil neuf, et souvent ironique (Heidi est une parfaite Putzfrau,
À la suite de Wissmer (photo de gauche), nous relisons Heidi d’un œil neuf, et souvent ironique (Heidi est une parfaite Putzfrau,

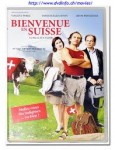 On l'attendait, avec un peu d'angoisse et beaucoup d'impatience, ce volume consacré à la Suisse dans la prestigieuse collection Découvertes-Gallimard. Et il est arrivé. Pas tout de suite, d'ailleurs, puisqu'il est seulement le 573e de la collection ! Il est signé François Walter, un professeur d'histoire moderne et contemporaine à l'Université de Genève depuis 1986.
On l'attendait, avec un peu d'angoisse et beaucoup d'impatience, ce volume consacré à la Suisse dans la prestigieuse collection Découvertes-Gallimard. Et il est arrivé. Pas tout de suite, d'ailleurs, puisqu'il est seulement le 573e de la collection ! Il est signé François Walter, un professeur d'histoire moderne et contemporaine à l'Université de Genève depuis 1986. Dont tout le monde vante l'inexprimable beauté. Signe, sans doute, d'une Nature encore intacte, proche de sa pureté originelle. Vantées par les premiers touristes anglais au XIXe siècle, ces « beautés naturelles » attireront, plus tard, le tourisme de masse vers les stations de sports d'hiver, transformant la Suisse en pays de cartes postales.
Dont tout le monde vante l'inexprimable beauté. Signe, sans doute, d'une Nature encore intacte, proche de sa pureté originelle. Vantées par les premiers touristes anglais au XIXe siècle, ces « beautés naturelles » attireront, plus tard, le tourisme de masse vers les stations de sports d'hiver, transformant la Suisse en pays de cartes postales. Tout n'est pas à jeter, sans doute, dans ce petit livre où l'on retrouve toutes les finesses, mais aussi toutes les naïvetés de la « nouvelle histoire suisse. » Un bémol, cependant : l'absence, quasi totale, mais effarante, de la culture (au sens large) qui s'est développée dans ce pays. Quelques noms d'écrivains, jetés ici ou là (Rousseau 1712-1778), à la sauvette, mais jamais développés, ni interrogés. Aucune mention de Georges Haldas, de Nicolas Bouvier, de Corinna Bille ! Idem pour Albert Cohen ou Denis de Rougemont, grand penseur de l'Europe. Les mêmes lacunes s'appliquent à la peinture, à la musique ou encore à l'architecture, complètement oubliées dans ce panorama de cartes postales. De telles lacunes étonnent, surtout chez un professeur d'Université.
Tout n'est pas à jeter, sans doute, dans ce petit livre où l'on retrouve toutes les finesses, mais aussi toutes les naïvetés de la « nouvelle histoire suisse. » Un bémol, cependant : l'absence, quasi totale, mais effarante, de la culture (au sens large) qui s'est développée dans ce pays. Quelques noms d'écrivains, jetés ici ou là (Rousseau 1712-1778), à la sauvette, mais jamais développés, ni interrogés. Aucune mention de Georges Haldas, de Nicolas Bouvier, de Corinna Bille ! Idem pour Albert Cohen ou Denis de Rougemont, grand penseur de l'Europe. Les mêmes lacunes s'appliquent à la peinture, à la musique ou encore à l'architecture, complètement oubliées dans ce panorama de cartes postales. De telles lacunes étonnent, surtout chez un professeur d'Université.
 Quelle place occupe un écrivain dans la société d’aujourd’hui ? Quel est son rôle, sa fonction, sa responsabilité sociale ? Est-il un médiateur ou un provocateur ? Est-il vraiment un créateur, vivant d’air et d’eau fraiche, au-dessus de toute contingence matérielle ?
Quelle place occupe un écrivain dans la société d’aujourd’hui ? Quel est son rôle, sa fonction, sa responsabilité sociale ? Est-il un médiateur ou un provocateur ? Est-il vraiment un créateur, vivant d’air et d’eau fraiche, au-dessus de toute contingence matérielle ? Dans Hobby,
Dans Hobby,