Par Pierre Béguin
 Un collègue rapportait récemment ces mots tenus par l'institutrice de sa fille: «Votre fille est intelligente... mais elle n'est pas vraiment dans le moule. Vous devriez avoir un entretien au SMP (Service Médico-Pédagogique)».
Un collègue rapportait récemment ces mots tenus par l'institutrice de sa fille: «Votre fille est intelligente... mais elle n'est pas vraiment dans le moule. Vous devriez avoir un entretien au SMP (Service Médico-Pédagogique)».
Si le suivi du SMP peut être bénéfique, l'expression «dans le moule», énoncée avec beaucoup de naïveté par une institutrice qui n'en a pas mesuré toute la portée, amène certains commentaires:
- Tout d'abord que cette brave institutrice, elle, est bien «dans le moule» de la FAPSE (Faculté de Psychologie et Sciences de l'Education). Et que, par conséquent, tous ceux - élèves compris - qui ne figurent pas dans ce moule doivent y être ramenés in petto. Il en va de leur propre rédemption et du salut de leur âme.
- Ensuite, et surtout, que les normes, à l'école comme ailleurs, se sont à ce point resserrées que tout ce qui dépasse du cadre est considéré comme suspect, voire déviant, et doit être immédiatement taillé, raboté, uniformisé, formaté pour revenir «dans le moule». Car l'uniformisation est le nouveau grand cheval de bataille du DIP. Et tous les braves petits soldats, dans les écoles ou aux étages de la Direction Générale, tirent à la même corde, soit qu'ils n'ont ni l'imagination ni l'intelligence de nuancer les ordres, soit qu'ils visent une promotion en prenant la pose du paillasson approbateur (j'ai des noms! j'ai des noms!) Avec la mondialisation, finis les chemins de traverse, l'heure est aux autoroutes de la pensée! A condition de s'arrêter aux péages...
La médicalisation, par exemple, participe allégrement de cette tendance. On en mesure les premiers effets dans les Conseils de groupe (ex Conseils de classe) au Collège. Il n'est pas rare que des élèves qui ne sont pas «dans le moule», au comportement un peu agité, se voient cataloguer d'hyperactifs. Le mot est à la mode, pourquoi s'en priver? Et puis ça vous donne des allures de spécialistes. Allez! Qui n'a pas ressenti parfois un déficit de concentration, de l'impulsivité, une tendance à s'agiter tous azimuts, une difficulté à prêter attention aux âneries des autres? Qui ne connaît pas un enfant turbulent et incapable de se concentrer en classe? Que celui-ci se lève et rende sa Danette! Nous sommes tous des malades qui nous ignorons. Un certain nombre d'entre nous peuvent donc légitimement souffrir d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH). Qu'à cela ne tienne! Il existe maintenant un stimulant de la famille des amphétamines, efficace à 100%, qui vous transforme d'un coup de baguette magique ces loups hurlants en moutons attentifs. Car l'hyperactivité figure en bonne place dans le DSM4*, avec son remède miracle: la Ritaline. Un comportement qui n'est pas «dans le moule»? Allez hop! Vite un coup de Ritaline! Ah, ça va mieux, ça va bien! Selon le New Scientist, 4 millions d'Américains, enfants (certains dès l'âge de 4 ans!) ou jeunes adultes pour la plupart, en consomment sur ordonnance. Le tsunami TDAH s'apprête à déferler sur nos terres.
Comme je m'inquiétais de cette médicalisation de l'école auprès d'un copain médecin, celui-ci me répondit en vantant les bienfaits de la Ritaline, précisant qu'il connaissait plusieurs cas où sa prescription avait résolu des problèmes de parcours scolaire délicat. Peut-être. Un peu comme la prise d'EPO facilite une victoire au Tour de France? Décidément, les médecins eux aussi sont «dans le moule». Bien sûr, le diagnostic doit être fait par plusieurs instances (éducateurs, enseignants, médecins), bien sûr il doit être confirmé par un examen neuropsychologique. Peut-on affirmer pour autant qu'il soit aussi infaillible que le système bancaire ou les centrales nucléaires? Et puis, que vaut un examen quand on est juge et parti? Et que peut le généraliste sous la pression de parents qui exigeraient à tout prix la réussite scolaire de leur enfant? D'autant plus que le concept d'hyperactivité a le grand mérite de dédouaner les principaux acteurs de l'éducation (parents, professeurs, politiciens) de leurs responsabilités dans les comportements antisociaux des enfants. Bref, quand la maladie arrange tout le monde, le médicament ne peut que s'imposer.
Le plus inquiétant, c'est que le DSM5, prévu pour fin 2011, va introduire la colère dans ses pathologies. D'accord, pas la colère fondée que vous ressentez face à l'inefficience des Transports Publics, surtout s'ils sont Genevois, ni celle légitime qui vous envahit lorsque vous réalisez, 4 ou 5 fois par jour, que décidément on vous prend pour un c... Non! Une colère pathologique, une vraie, avec ses symptômes dûment répertoriés... et médicalisés. Alors imaginez ce qu'il va bientôt advenir du pauvre élève en déficit d'attention, un peu agité, et qui aurait l'audace de se mettre en colère à la moindre contrariété! Dans le moule et vite, que ça le gratouille ou ça le chatouille! Et d'abord dans le moule pharmaceutique grâce à une médication adéquate! Aux quatre coins du monde, Ritaline, ritalinons, ritalinez, et les diplômes seront bien distribués! Et tant pis pour les conséquences! Car la Ritaline est un véritable psychotrope, et si la loi était la même pour tout le monde, appliquée aussi durement pour les groupes pharmaceutiques qu'elle l'est pour les cultivateurs de chanvre, notre ami Rappaz aurait de la compagnie dans sa cellule...
L'épisode du vaccin contre le virus H1N1 a souligné l'écart ténu entre prévention et «disease mongering» (le fait d'inventer une nouvelle maladie pour développer un nouveau marché et vendre des médicaments). La question peut légitimement se poser avec le TDAH et son pendant médicamenteux, la Ritaline. Dans tous les cas, c'est une nouvelle tyrannie qui montre bien que, derrière la volonté d'uniformiser, se cachent souvent des intentions perverses et des intérêts importants, entre autres, la médicalisation. Ça ne vous rappelle rien? C'était en 1924, sous la plume de Jules Romains:
«Vous me donnez un canton peuplé de quelques milliers d'individus neutres, indéterminés. Mon rôle, c'est de les déterminer, de les amener à l'existence médicale. Je les mets au lit, et je regarde ce qui va pouvoir en sortir: un tuberculeux, un névropathe, un artério-scléreux, ce qu'on voudra, mais quelqu'un, bon Dieu! quelqu'un! Rien ne m'agace comme cet être ni chair ni poisson que vous appelez un homme bien portant (...) Songez que, dans quelques instants, il va sonner dix heures, que pour tous mes malades, dix heures, c'est la deuxième prise de température rectale, et que, dans quelques instants, deux cent cinquante thermomètres vont pénétrer à la fois...»
Au médecin humaniste qui lui reproche de subordonner l'intérêt du malade à celui du praticien, Knock, qui avait déjà imaginé le «disease mongering», répond: «Vous oubliez qu'il y a un intérêt supérieur à ces deux-là, celui de la médecine». Nous pourrions rétorquer à Knock qu'il y a deux intérêts encore supérieurs à celui de la médecine: celui des grands groupes pharmaceutiques et celui de leurs actionnaires. Je crains que nous ne finissions tous «dans leur moule», si ce n'est déjà fait...
- DSM : Manuel diagnostique et statistique des troubles psychiatriques. Il permet une aide au diagnostic et une unification du langage spécialisé. Le DSM est à la psychiatrie ce que la Bible est au Christianisme.
 Que serait le cinéma sans la littérature ? Rien, sans doute. Puisque les plus grands cinéastes ont adapté, transformé, pillé les grandes œuvres littéraires. Parfois le résultat est pitoyable (Tous les soleils, roman de Philippe Claudel adapté et réalisé au cinéma par l'auteur) ; parfois, au contraire, remarquable, comme si le cinéma donnait un second souffle au livre qui l'a inspiré.
Que serait le cinéma sans la littérature ? Rien, sans doute. Puisque les plus grands cinéastes ont adapté, transformé, pillé les grandes œuvres littéraires. Parfois le résultat est pitoyable (Tous les soleils, roman de Philippe Claudel adapté et réalisé au cinéma par l'auteur) ; parfois, au contraire, remarquable, comme si le cinéma donnait un second souffle au livre qui l'a inspiré. Quant à Gérard Depardieu, qui a trouvé désormais sa carrure naturelle, qui est celle d'un colosse aux pieds d'argile, il est tout simplement prodigieux, léger (mais oui!), fragile, malicieux, candide. Depuis la mort de son fils Guillaume, le géant français enchaîne les films comme on se jette à l'eau, comme s'il jouait à chaque fois sa vie en revêtant la peau d'un autre. Il y a là un mystère (ou peut-être aucun mystère) dont seul le cinéma peut nous donner la clé…
Quant à Gérard Depardieu, qui a trouvé désormais sa carrure naturelle, qui est celle d'un colosse aux pieds d'argile, il est tout simplement prodigieux, léger (mais oui!), fragile, malicieux, candide. Depuis la mort de son fils Guillaume, le géant français enchaîne les films comme on se jette à l'eau, comme s'il jouait à chaque fois sa vie en revêtant la peau d'un autre. Il y a là un mystère (ou peut-être aucun mystère) dont seul le cinéma peut nous donner la clé… Nous sommes avec ma chérie dans le vallon de Valsorey au-dessus de Bourg-St-Pierre. Les marmottes sont de sortie, aux aguets : leurs petits courent dans tous les sens. En face, le tas de neige sous lequel il y aurait encore la cinquième victime de l’avalanche du 26 mars dernier. Tragédie de par ici. Nous pique-niquons, sous le regard de l’aigle qui patine dans le ciel tout là-haut.
Nous sommes avec ma chérie dans le vallon de Valsorey au-dessus de Bourg-St-Pierre. Les marmottes sont de sortie, aux aguets : leurs petits courent dans tous les sens. En face, le tas de neige sous lequel il y aurait encore la cinquième victime de l’avalanche du 26 mars dernier. Tragédie de par ici. Nous pique-niquons, sous le regard de l’aigle qui patine dans le ciel tout là-haut.

 Un collègue rapportait récemment ces mots tenus par l'institutrice de sa fille: «Votre fille est intelligente... mais elle n'est pas vraiment dans le moule. Vous devriez avoir un entretien au SMP (Service Médico-Pédagogique)».
Un collègue rapportait récemment ces mots tenus par l'institutrice de sa fille: «Votre fille est intelligente... mais elle n'est pas vraiment dans le moule. Vous devriez avoir un entretien au SMP (Service Médico-Pédagogique)». 842 pages de fables contemporaines et anciennes tissées dans une intrigue romanesque foisonnante. Pour le passé sont convoqués la mythologie indienne, la Vénus hindoue, le Kama-Soutra, mêlés à la tradition grecque, Orphée et Eurydice en tête. Pour le présent: la mythologie du rock.
842 pages de fables contemporaines et anciennes tissées dans une intrigue romanesque foisonnante. Pour le passé sont convoqués la mythologie indienne, la Vénus hindoue, le Kama-Soutra, mêlés à la tradition grecque, Orphée et Eurydice en tête. Pour le présent: la mythologie du rock.
 Je viens de recevoir, par la poste, le dernier livre de Jacques Chessex, L'Interrogatoire*. Avec, sur la page de garde, une dédicace écrite au Pentel noir, d'une graphie souple et belle. En amitié. Jacques C.
Je viens de recevoir, par la poste, le dernier livre de Jacques Chessex, L'Interrogatoire*. Avec, sur la page de garde, une dédicace écrite au Pentel noir, d'une graphie souple et belle. En amitié. Jacques C.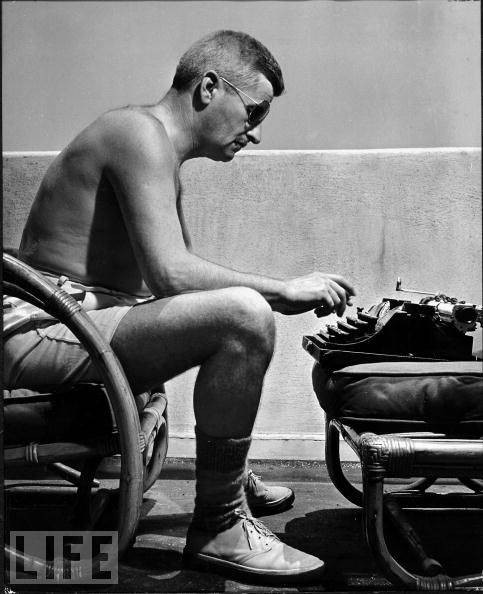

 Ce dictionnaire révèle beaucoup de choses sur son auteur d’abord. Est-il injuste comme on l’a reproché? Bien sûr que non. Ce mot n’a aucun sens ici. Un critique n’est jamais injuste: il exprime des goûts, qui n’ont rien à voir avec la vérité.
Ce dictionnaire révèle beaucoup de choses sur son auteur d’abord. Est-il injuste comme on l’a reproché? Bien sûr que non. Ce mot n’a aucun sens ici. Un critique n’est jamais injuste: il exprime des goûts, qui n’ont rien à voir avec la vérité. Retenez bien ce nom, aux allures de pseudonyme ethno : Douna Loup. Douna comme Douna, une petite ville du Burkina Faso. Et Loup comme le grand méchant loup, et comme le Théâtre du même nom. Car Douna Loup vit à Genève où elle est née en 1982, de parents marionnettistes. Si l'on en croit Culturactif, « elle passe son enfance et son adolescence dans la Drôme. À dix-huit ans, son Baccalauréat Littéraire en poche, elle part pour six mois à Madagascar en tant que bénévole dans un orphelinat. À son retour elle s'essaye à l'ethnologie, elle nettoie une banque suisse pendant trois mois, garde des enfants durant une année, écrit sa première nouvelle, puis devient mère, et étudie les plantes médicinales. Après avoir vendu des tisanes sur les marchés et obtenu un certificat en Ethno-médecine, elle se consacre pleinement à l'écriture et à ses deux filles. »
Retenez bien ce nom, aux allures de pseudonyme ethno : Douna Loup. Douna comme Douna, une petite ville du Burkina Faso. Et Loup comme le grand méchant loup, et comme le Théâtre du même nom. Car Douna Loup vit à Genève où elle est née en 1982, de parents marionnettistes. Si l'on en croit Culturactif, « elle passe son enfance et son adolescence dans la Drôme. À dix-huit ans, son Baccalauréat Littéraire en poche, elle part pour six mois à Madagascar en tant que bénévole dans un orphelinat. À son retour elle s'essaye à l'ethnologie, elle nettoie une banque suisse pendant trois mois, garde des enfants durant une année, écrit sa première nouvelle, puis devient mère, et étudie les plantes médicinales. Après avoir vendu des tisanes sur les marchés et obtenu un certificat en Ethno-médecine, elle se consacre pleinement à l'écriture et à ses deux filles. »