Par Pierre Béguin
Comment des artistes peuvent-ils s’épanouir tout en étant terrifiés à l’idée de s’exprimer librement, de prendre des risques créatifs à la marge du bon goût ou du blasphème, particulièrement en incluant la possibilité de se mettre dans la peau d’un autre, sans être accusés d’appropriation culturelle, sans faire entrer en éruption, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, des milliers d’âmes indignées, offensées, outragées?
Comment ces artistes peuvent-ils exister dans une culture de l’autocensure où l’on avance sur la pointe des pieds en essayant d’apaiser chaque individu, chaque groupe, chaque communauté, qui pourrait s’offenser d’une opinion contraire à la sienne, dans un contexte qui met de facto un terme à l’excellence créatrice en raison des peurs, des traumatismes, des anxiétés, de l’ignorance ou des délires de certains?
Comment créer – la création, comme le rire, trouve son essence dans la transgression – quand les réseaux sociaux peuvent déverser sur vous, jusqu’à vous réduire en charpies, la colère et le désespoir des exagérément sincères, des signaleurs de vertus, des tartufes, des traumatisés, des débiles, des dépourvus d’humour, des handicapés du second degré, des litéraux «qui prennent tout au premier degré», des victimes en tout genre, le plus souvent autoproclamées?
Tels furent les questions que je me suis posées en regardant cette farce navrante que fut l’Infrarouge de fin mars, ce grotesque tribunal de l’Inquisition qui clouait au pilori une comédienne pour un simple sketch mettant en scène une psy et une patiente «genre».
A vrai dire, j’ai ressenti, à l’écoute de cette émission, un profond malaise, tout aussi intense et sincère que celui ressenti par ceux qui faisaient le procès de notre comédienne. Et mon ressenti n’ayant, à priori, pas moins d’importance et de poids que n’importe quel autre (sauf que je ne vais pas en faire une norme absolue), j’en déduis donc que je suis parfaitement habilité à en exposer les composantes, sans me faire étriller par celles ou ceux dont le ressenti fut, en la circonstance, différent du mien. Je l’ai écrit et je le répète: en ce qui me concerne, chacun peut faire de son cul un tambour, tant qu’on me laisse faire du mien ce que bon me semble.
Pour moi donc, s’étalait dans ce débat – je devrais dire dans cette mise à mort publique – une image fort laide de l’état inquiétant de nos démocraties qui cèdent tout au communautarisme le plus fascisant, une représentation en microcosme de l’ordre cauchemardesque du nouveau monde, cette incapacité à accepter le moindre point de vue qui diffère de la doxa moralisatrice supérieure, celle qu’on appelle communément «le politiquement correct», et dont je ne dirai jamais assez qu’il est l’ennemi à abattre. Et chacun de s’enfermer dans sa propre bulle, personnelle ou communautariste, qui ne reflète que les valeurs auxquelles il s’identifie, pour divaguer à son aise dans sa propre petite utopie. Narcissisme délirant et pathologique!
Tout ce en quoi je peux me reconnaître, toutes les valeurs qui m’ont façonné – et qui, croyez-moi, n’ont pas fait de moi un monstre, loin de là – étaient soudainement évacuées du plateau. Il est peut-être bon de rappeler ce qui me semble encore des évidences: les sentiments ne sont pas des faits intangibles, les ressentis ne sont pas des vérités absolues, les opinions ne sont pas des crimes. Si l’on adhère à ces assertions, qui relèvent du simple bon sens et qui doivent être l’un des fondements de toute vie en société, alors cette émission n’aurait jamais dû avoir lieu. Et elle n’aurait jamais eu lieu en Suisse dix ans plus tôt.
Mais elle a eu lieu, et c’est bien là le problème. Les assertions énoncées ci-dessus ne sont donc plus considérées comme des postulats fiables. Le ressenti personnel devient une valeur absolue au nom de laquelle je peux lancer dans la gueule noire des réseaux sociaux toutes les fatwas que mon indignation justifie, sans avoir le moindre compte à rendre à personne d’autres que mon propre narcissisme, ou que celui de ma communauté. Et cela, indépendamment de tout bon sens, de toute justice! Rappelons tout de même qu’en la circonstance, l’atroce, l’ignoble, l’incommensurable outrage ressenti n’avait pour objet qu’un simple sketch!
Au fond, cette émission n’est qu’une variante d’une plus vaste épidémie de dramaturgie alarmiste et catastrophiste que les médias encouragent pour des raisons qu’il n’est nul besoin d’expliquer, un déchaînement instinctif, hyper émotif, devenu hélas endémique dans le monde de la culture.
Mais les guerriers de la justice (et davantage encore les guerrières) donnent l’impression de ne chercher qu’à être offensés, le plus souvent par rien du tout, et de ne se présenter qu’en victimes geignardes, plaintives et récriminantes. Parce que l’outrage attire l’attention, l’outrage obtient des clics, des «likes», l’outrage fait entendre votre pauvre voix par dessus le vacarme assourdissant des voix braillant les unes par-dessus les autres dans cet enfer d’anonymat que sont devenus les réseaux sociaux. Je suis une victime, je souffre, aimez-moi! Et chacun de s’imaginer qu’il a quelque chose de très important à dire, un sentiment, un ressenti, déjà exprimé des milliards de fois, et qu’il faut épicer à tout prix parce que, justement, il a déjà été exprimé des milliards de fois.
Prêcher, condamner, ostraciser, tout en créant son propre drame, en se racontant sa propre histoire tragique pour se sentir exister plus intensément en s’extirpant de la masse des anonymes. Comment celles ou ceux qui se prétendent des progressistes sont-ils devenus de tels dragons de vertus, de telles matrones de la société, horrifiés chaque fois que quelqu’un émet une opinion ou un jugement qui n’est pas l’image en miroir du leur? Le ton moralisateur, pour ne pas dire de censeur, adopté par ces guerriers de la justice sociale, relayés par une gauche complètement détraquée, sans plus aucun repère autre que sociétal, est le plus souvent hors de proportion avec l’objet de leur indignation, générant, entre autres scories, un langage policier autoritaire bannissant toute une série de mots qu’on eût pu croire inoffensifs, créant une novlangue insidieuse et imposant une grammaire inclusive qui relève, selon l’expression de Rabelais, du «baragouin» le plus grotesque.
Cette épidémie de la victimisation de soi – qui vous pousse à vous identifier essentiellement à un traumatisme passé que vous avez laissé vous définir – est en réalité une maladie. Quelque chose qu’il faut soigner, qu’il faut résoudre, dépasser, pour participer pleinement à la société en tant qu’adulte accompli et autonome, qu'elles que soient ses opinions et ses orientations. Sans quoi on finit par emmerder ses amis, ses voisins, et tous ces inconnus «privilégiés» qui ne se pensent pas en victimes expiatoires ou revanchardes.
Mais ce délire victimaire a du bon, n’est-ce pas? Il incite les gens à croire que la vie devrait être une douce utopie, conçue et construite en fonction de leurs fragiles et exigeantes sensibilités, il les encourage à rester éternellement des enfants évoluant dans un conte de fées saturé de bonnes intentions. Qu’il est difficile, qu’il est douloureux, qu’il est exigeant de dépasser certains traumatismes pour devenir enfin adulte, pour affronter un monde souvent hostile aux rêves et aux idéaux de l’enfance, pour se construire en se confrontant à des idées et des comportements différents, pour se sortir enfin du narcissisme de l’adolescence!
Ce délire victimaire me semble l’apanage de personnes qui, tout en revendiquant l’égalité, la maturité et l’autonomie, ont décidé de ne jamais grandir. Dommage que la nouvelle vague féministe, entre autres vagues à la mode, en ait fait son étendard! Le féminisme mérite mieux.
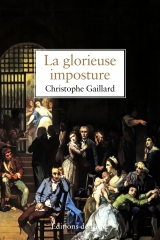 Toute révolution est-elle condamnée à finir dans le sang et les larmes ? Et pourquoi tant de haine, de massacres, de terreur ? Ces questions sont au cœur du roman de Christophe Gaillard, La Glorieuse imposture*, sans conteste l'un des livres les plus forts et les plus aboutis de ce début d'année.
Toute révolution est-elle condamnée à finir dans le sang et les larmes ? Et pourquoi tant de haine, de massacres, de terreur ? Ces questions sont au cœur du roman de Christophe Gaillard, La Glorieuse imposture*, sans conteste l'un des livres les plus forts et les plus aboutis de ce début d'année.  Nous sommes à Saint-Lazare, une ancienne léproserie devenue une prison où s'entassent les suspects de tous bords (artistes, écrivains, aristocrates, religieuses, etc.). Dans cette petite société des bannis (promis à une mort certaine), il y a un poète, André Chénier, dont certains vers ont déplu aux jacobins au pouvoir. Gaillard retrace avec talent les derniers jours du poète qui attend la charrette funeste et croise, dans sa prison, les peintres Suvée et Hubert Robert (qui peignit la cour de la prison sous la terreur, cf. illustration), le poète Roucher, la mère abbesse de Montmartre et la belle Aimée de Coigny. Il y croisera également d'autres personnages dont le divin marquis de Sade, qui échappera par miracle à la guillotine.
Nous sommes à Saint-Lazare, une ancienne léproserie devenue une prison où s'entassent les suspects de tous bords (artistes, écrivains, aristocrates, religieuses, etc.). Dans cette petite société des bannis (promis à une mort certaine), il y a un poète, André Chénier, dont certains vers ont déplu aux jacobins au pouvoir. Gaillard retrace avec talent les derniers jours du poète qui attend la charrette funeste et croise, dans sa prison, les peintres Suvée et Hubert Robert (qui peignit la cour de la prison sous la terreur, cf. illustration), le poète Roucher, la mère abbesse de Montmartre et la belle Aimée de Coigny. Il y croisera également d'autres personnages dont le divin marquis de Sade, qui échappera par miracle à la guillotine.  C'est l'occasion, pour Gaillard, de fantastiques portraits, vivants et colorés, de ces figures marquantes de la Révolution. Sa verve se déploie pour évoquer Marat et Charlotte Corday, Olympe de Gouges ou Robespierre (image), Danton ou le peintre collabo David (il dénonça son collègue Hubert Robert).
C'est l'occasion, pour Gaillard, de fantastiques portraits, vivants et colorés, de ces figures marquantes de la Révolution. Sa verve se déploie pour évoquer Marat et Charlotte Corday, Olympe de Gouges ou Robespierre (image), Danton ou le peintre collabo David (il dénonça son collègue Hubert Robert).











