Refroidissement climatique
Par Pierre Béguin
Le Journal des Goncourt est un de mes livres de chevet. Depuis 30 ans, il se passe rarement une semaine sans que je n'en lise au moins une dizaine de pages (et comme il y en a plus de 3000!)...
En date du 11 juin 1872 (il y a donc 150 ans presque mois pour mois), je trouve cette phrase dont le contexte est l'un de ces fameux dîners de Magny (dans la salle en-dessous, Victor Hugo donne aussi un dîner pour la 100e représentation de Ruy Blas) où Edmond de Goncourt (son frère Jules est mort exactement deux ans plus tôt) énumère les sujets de discussions à la mode qui émaillent le dîner. Et parmi ces thèmes d'actualité, celui-ci: " On parle du refroidissement du globe dans quelques dizaines de millions d'années".
Quelques dizaines de millions d’années! Quelle belle époque que celle où la propagande n’instrumentalisait pas encore (ou si peu) les peurs primaires des populations! Mais nous nous concentrerons dans ce billet sur l’autre point soulevé dans la phrase de Goncourt: en 1872, la doxa était donc au refroidissement climatique.
En réalité, entre 1872 et 2022, les scientifiques – ou ceux qui se nomment maintenant des climatologues – ont annoncé au moins aussi souvent un réchauffement (essentiellement dans la première moitié du XXe siècle) qu’un refroidissement (essentiellement dans la seconde moitié du XXe siècle). Et le plus surprenant, c’est que, dans les deux cas, il suffit d’inverser «réchauffement» et «refroidissement» pour obtenir les mêmes discours, tenus parfois par les mêmes personnes, soutenus par les mêmes arguments qui semblent simplement retournés comme un gant.
Petit survol historique:
Le 24 juin 1974, le magazine Time annonçait un nouvel âge glaciaire. Newsweek lui emboîtait le pas le 28 avril 1975, suivi de National Geographici en 1976. Le 3 avril 2006, le Time remettait çaii. En 1977, le fameux climatologue Stephen Schneider, le même qui brandira plus tard le spectre d’un réchauffement climatique catastrophique, cosignait un livre alertant sur un nouvel âge glaciaireiii. Peu avant, dans un ouvrage de Lowell Ponteiv de 1975, il déclarait: «Le refroidissement planétaire place l’humanité devant le plus important défi social, politique et d’adaptation que nous ayons eu à relever depuis 110'000 ans (sic!). L’enjeu des décisions que nous prenons à son sujet est d’une importance capitale: notre survie, celle de nos enfants, celle de notre espèce. (cité in: Plimer, 2009, Heaven and Earth: Global Warming, the Missing Science, Taylor Trade Publishing.).
Plus largement, voici un florilège de ce qu’on pouvait lire dans les années 1970:
- «Le refroidissement continuel et rapide de la terre depuis la seconde guerre mondiale est en rapport avec l’augmentation de la pollution de l’air associée à l’industrialisation, à la mécanisation, à l’urbanisation et à l’explosion de la population»v.
- «Le refroidissement actuel a déjà tué des centaines de milliers de personnes. S’il continue, et si personne ne prend des mesures énergiques, il provoquera une famine mondiale, un chaos généralisé et même une nouvelle guerre mondiale. Tout cela pourrait survenir avant l’an 2000»vi.
- «Si la tendance actuelle se poursuit, le monde sera confronté en 1990 à un refroidissement moyen des températures d’environ 4 degrés, et même de 11 degrés d’ici l’an 2000… C’est environ le double de ce qui serait nécessaire pour nous plonger dans un nouvel âge glaciaire»vii.
- «Nos calculs suggèrent un refroidissement global jusqu’à 3,5 degrés. Une telle baisse de la température moyenne terrestre, si elle se poursuivait sur quelques années, suffirait à déclencher un nouvel âge glaciaire»viii.
- «Le climat présente actuellement des symptômes alarmants. Il y a tout lieu de craindre que la Terre subira un refroidissement dramatique de ses températures au cours des cent prochaines années»ix.
De fait, avant l’entrée en scène du GIEC, la menace était surtout celle du refroidissement. Pour les références ci-dessous, je me réfère au livre de Jean-Claude Pont Le vrai, le faux et l’incertain dans les thèses du réchauffement climatique, Impressum, 2017. Par exemple, à la page 25: «Dans le livre de Le Roy Ladurie, on lit ceci: de 1951 à 1970, période de rafraîchissement; "on peut l’exemplifier par le grand hiver de février 1956 tuant les oliviers et laissant derrière lui une traînée de 8000 morts supplémentaires", ou par "le très grand hiver de 1962-1963, (…) avec 30000 morts additionnels"; "l’hiver du siècle, 1962-1963".
Rappelons tout de même que cette période très froide, et cette peur d’un refroidissement climatique aux conséquences catastrophiques, survient dans les trente glorieuses, en pleine montée du C02, accusé pourtant d’être le grand Satan du réchauffement. Eh oui! Il y a 50 ans à peine, la conviction refroidiste était partagée par la majorité des météorologues. La page 64 du journal Newsweek du 28 avril 1975 en représente un exemple édifiant. En voici un morceau de choix traduit par Jean-Claude Pont, et qui figure à la page 27 du livre cité plus haut:
«Il y a des signes continus de ce que le système du climat a commencé à changer dramatiquement et que ces changements pourraient présager un déclin drastique dans la production de la nourriture, avec de sérieuses implications politiques pour chaque nation de la terre. La chute de la production de la nourriture pourrait commencer rapidement, peut-être déjà dans dix ans. Les preuves (évidences) à l’appui de ces prédictions ont maintenant commencé de s’accumuler si massivement que les météorologues peinent à se tenir au courant (…)
Les météorologues ne sont pas d’accord sur la cause et l’étendue de la tendance au refroidissement [je souligne] mais ils sont presque unanimes sur le fait que cette tendance réduira la productivité pour le reste du siècle. Si la profondeur du changement climatique est au niveau de certaines craintes pessimistes, les famines qui en résulteront pourraient être catastrophiques. La National Academy of Sciences prévient qu’un changement climatique majeur [sous-entendu, un refroidissement, donc] contraindrait à des ajustements économiques et sociaux sur une large échelle du monde (…)
Une étude complétée l’année dernière par le Dr Murray Mitchell de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) révèle une baisse d’un demi-degré en moyenne, pour la température de l’hémisphère nord entre 1945 et 1968 (…)
Les climatologues sont pessimistes sur le fait que les leaders politiques entreprennent quelque action positive que ce soit pour compenser le changement climatique, ou au moins pour en atténuer les effets (...)»
Au fond, les climatologues et leur pseudo savoir ne diffèrent guère de ces montagnards valaisans de Fiesch et Fierschertal qui, tous les 31 juillet depuis trois siècles, ont pour coutume de se rendre en procession vers une chapelle de la forêt d’Ernerwald pour implorer Dieu de les protéger des menaces que le glacier d’Aletsch, le plus grand de l’arc alpin, fait peser sur eux. Jusqu’en 2012, ils ont prié le Seigneur d’intercéder contre le refroidissement climatique et l’avancée du glacier. Depuis dix ans, leur prière a changé de sens: Dieu est désormais appelé à l’aide pour contrer le réchauffement climatique et la fonte du glacier qui s’ensuit.
Refroidissement, réchauffement, même religion, mêmes superstitions, mêmes prédictions démenties par le temps, et pourtant sans cesse renouvelées. J’avance cette hypothèse: le dénominateur commun pourrait bien se situer dans la crainte - justifiée celle-ci – d’une surpopulation galopante. Quand nous aurons réellement intégré cette donnée – au lieu de la refouler dans la Bien-pensance – nous cesserons d’incarner nos peurs dans les variations climatiques et la montée du C02. Ce qui ne semble pas pour aujourd’hui, ni même pour demain.
Pour preuve: des astronomes russes de l’Institut de physique solaire et terrestre d’Irkoutsk ont déduit récemment, à partir d’une analyse des cycles des taches solaires pour la période 1881-2000, que le minimum du cycle séculaire de l’activité solaire tombera dans le prochain cycle en 2021 – 2026. Bref, pour la faire courte, que la terre va être confrontée à une lente diminution des températures qui conduira à un gel profond vers 2050 ou 2060, et qui durera une cinquantaine d’années, selon la théorie de la périodicité d’évolution des températures de soixante ans mise au jour par N. Scafetta, et appuyée par d’autres théories dont je vous passe les détails mais qui vont toutes dans le même sens.
Que celles et ceux qui me lisent et qui habitent dans le Haut-Valais préviennent les paysans montagnards de Fieschertal d’inverser à nouveau leurs prières au 31 juillet: le glacier d’Aletsch pourrait bientôt reprendre du volume.
Et ce n’est pas forcément une bonne nouvelle: les périodes de refroidissement ont toujours été les plus meurtrières, au contraire des périodes de réchauffement – et même d’augmentation du C02 – favorables à la production céréalières et propices au développement du commerce et du bien-être. Que je sache, il y a moins d’habitants en Sibérie ou au Pôle Nord que dans des régions plus clémentes, voire très chaudes. Quant à mes connaissances labellisées réchauffistes, je ne les vois pas passer leurs vacances à Mourmansk ou à Vladivostok, mais s’en aller allègrement suer sur une plage du sud à 40 degrés à l’ombre, tout en s’alarmant d’une augmentation d’un seul degré répertoriée entre 1872 et 2022.
Il y a des gens bien singuliers...
P.S. Quelqu'un pourrait-il me donner des nouvelles de Greta? Je commence sérieusement à m'inquiéter.
i Matthews S.W. 1976: What’s happening to our climate? National Geographic 150: 5 576-615
ii Voir les listes de publications in: http://www.populartechnology.net/2013//02/the-1970s-global-cooling-alarmist.html
iii Schneider S. and Mesirow L.E. 1977: The genesis strategy Climate and global survival, First Delta
iv Ponte L. 1975: The cooling. Has the next ice age already begun? Can we survive it? Prentice Hall
v Ehrlich P.R. et Holdren J.P. Global Ecology: Reading Towards a Rational Strategy for Man, Paperback 1971
vi Lowell Ponte, The Cooling, 1975
vii Kenneth E.F. Watt on Air Pollution and Global Cooling Change, Earth day, 1970
viii S. Schneider, fondateur du journal Climate Change et auteur principal du GIEC 2001, in Science, 1971
ix L’Académie des Sciences américaines, 1975



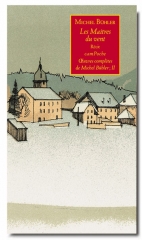 L’éditeur Bernard Campiche, dorénavant installé à Sainte-Croix, a commencé en fin d’année dernière à publier les œuvres complètes, en version poche (camPoche), de Michel Bühler, le plus connu des habitants de Sainte-Croix. Le second volume, paru en décembre 2021, est un inédit, intitulé Les Maîtres du vent, qui prend justement pour cadre cette commune du canton de Vaud, située dans le district du Jura-Nord vaudois entre Yverdon-les-Bains, Fleurier et Pontarlier. Un titre dont on perçoit dès les premières pages la portée ironique: ces Maîtres du vent ne dominent leur élément que du haut de leur prétention, de leurs mensonges et de leur cupidité.
L’éditeur Bernard Campiche, dorénavant installé à Sainte-Croix, a commencé en fin d’année dernière à publier les œuvres complètes, en version poche (camPoche), de Michel Bühler, le plus connu des habitants de Sainte-Croix. Le second volume, paru en décembre 2021, est un inédit, intitulé Les Maîtres du vent, qui prend justement pour cadre cette commune du canton de Vaud, située dans le district du Jura-Nord vaudois entre Yverdon-les-Bains, Fleurier et Pontarlier. Un titre dont on perçoit dès les premières pages la portée ironique: ces Maîtres du vent ne dominent leur élément que du haut de leur prétention, de leurs mensonges et de leur cupidité.