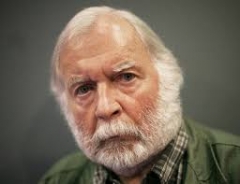Rhinocérite
Par Pierre Béguin
«Rien n’est aussi dangereux que la certitude d’avoir raison»
(François Jacob, médecin et biologiste français)
Le bon sens commun et la raison subissent depuis quelques années une période d’hystéries galopantes qui, à l’image de l’inquisition, multiplie les chasses aux sorcières, les anathèmes, les bûchers, allant, par exemple, jusqu’à remettre au goût du jour les indulgences en incitant le citoyen qui veut se donner bonne conscience à payer volontairement une taxe CO2 pour acheter sa rédemption en termes de bilan soi-disant écologiquement neutre.
Comment des dizaines de millions de personnes prétendument saines d’esprit peuvent-elles alimenter de tels délires?
 Cette question lancinante me renvoie sans cesse à cette pièce d’Eugène Ionesco, Rhinocéros (1960), qui décrit la transformation inéluctable de toute une société composée d’individus libres en une masse grégaire, instinctive et brutale, passant de la diversité humaine à l’uniformité animale.
Cette question lancinante me renvoie sans cesse à cette pièce d’Eugène Ionesco, Rhinocéros (1960), qui décrit la transformation inéluctable de toute une société composée d’individus libres en une masse grégaire, instinctive et brutale, passant de la diversité humaine à l’uniformité animale.
Ainsi le premier acte montre-t-il des personnages occupés à parler et à échanger des signes innombrables. La parole humaine domine alors sous toutes ses formes: conversations amicales, disputes, démonstrations logiques, débats contradictoires, cris, langage affectif…
L’apparition des rhinocéros entraîne la disparition progressive de cette diversité au profit d’une pauvreté langagière réduite, à la fin de la pièce, au monologue de Bérenger – l’unique résistant ayant gardé forme humaine – et aux barrissements hégémoniques des monstres, dans ce qui n’est même plus un dialogue de sourds.
Parmi tous les symptômes de rhinocérite qui annoncent la transformation d’un personnage en pachyderme bicornu, s’il est d’Afrique – la pièce identifie cette gigantesque métamorphose à une forme d’épidémie (La Peste de Camus fut publiée 13 ans plus tôt) – figure en première ligne les attaques personnelles: le discours totalitaire n’argumente pas, il dévalue l’autre dans sa personne pour mieux déprécier ses arguments, n’en ayant en réalité aucun de fiable à lui opposer. Ainsi l’unique résistant Bérenger, le dérangé, se voit-il systématiquement renvoyé à sa tendance marquée à l’alcoolisme chaque fois qu’il essaye d’argumenter.
Visionnaire Ionesco! Près de soixante ans plus tard, son allégorie s’incarne dans des rôles bien déterminés. Aujourd’hui, il ne fait pas bon être un mâle blanc, hétéro, de surcroît climato-sceptique. Si encore on pouvait faire admettre l’idée qu’on peut être très préoccupé d’environnement tout en doutant du bien-fondé des théories réchauffistes, cela sans se voir traité de sale négationniste à la solde d’Exxon Mobile… Mais quand une vague idéologique est parvenue à faire croire, sous couvert de science, que le passage dans l’atmosphère de 3 à 4 particules de CO2 sur 10’000* depuis le début de l’ère industriel était de nature à modifier radicalement le climat, toute nuance relève d’une mission impossible – Il est vrai que cette «idéologie» permet, de manière très pragmatique, de lever des taxes CO2 visant à compenser les cadeaux fiscaux accordés aux entreprises, ceci expliquant cela. De même, peut-on encore souligner les visées hégémoniques de certains dogmes qui nient radicalement les réalités les plus élémentaires sans se voir taxer de facto de vieux macho réactionnaire aigri à haut potentiel de prédation…
Restent-ils dans cette effervescence de croyances délirantes des penseurs, des scientifiques, des politiciens, des journalistes, des professeurs prêts à élever les digues de la raison et du bon sens contre ce raz-de-marée idéologique? Ou n’existe-t-il plus que des hordes de rhinocéros illustrant à la perfection, et sans même en avoir conscience, la loi de Brandolini*?
Certes, à l’image de n’importe quelle mode, ces délires vont rapidement s’étioler, et celles et ceux qui les auront activement alimentés ne se souviendront même plus d’y avoir adhéré. A l’image de l’hystérie «Balance ton porc» qui s’est essoufflée depuis que ses têtes (non) pensantes ont été prises en flagrant délit de tartuferie. Il n’empêche, tout cyclone laisse sur son passage des stigmates, pour certains indélébiles. En attendant le prochain cyclone…
Bérenger, mon ami, mon frère! Moi qui, pourtant, ne bois pratiquement pas une goutte d’alcool, je te comprends si bien…
La pire des bêtises est toujours celle des moutons… ou des rhinocéros.
* «Le CO2 est un gaz présent dans l’atmosphère à l’état de traces, en quantité minuscule. Durant les 150 dernières années, sa concentration est passée de 3 molécules pour dix-mille molécules d’air à 4 molécules pour dix-mille molécules d’air, soit une molécule de CO2 de plus pour 10’000 molécules d’air, une sur dix-mille.» (François Gervais, professeur émérite de physique et de science des matériaux à l'Université de Tours, médaillé du CNRS en thermodynamique)
* Du programmeur italien Alberto Brandolini, la loi de Brandolini est un aphorisme soutenant l’idée de l’asymétrie du bullshit: «la quantité d’énergie nécessaire pour réfuter du bullshit est un degré de magnitude plus grande que celle nécessaire pour le produire».
Autrement dit, affirmez n’importe quoi sur les réseaux sociaux et sa répétition se métamorphosera en vérité difficile à contester, à plus forte raison si les médias et les politiques s’en font l’écho... et si des adolescents la répercutent en hurlant qu’on leur a volé leur jeunesse.
De la rhinocérite, je vous dis!