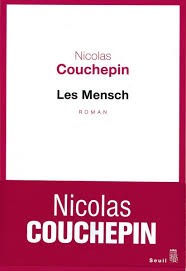par antonin moeri
Pour écrire «Même les chiens», Jon McGregor avait un modèle: «Tandis que j’agonise», ce roman où Faulkner raconte l’épopée d’une famille de paysans pauvres accompagnant la dépouille de leur mère. Une quinzaine de narrateurs y sont convoqués alors que, chez McGregor, il y en a peut-être la moitié (Danny, Ben, Laura, Steve, Mike, Ant etc., des jeunes gens à la dérive qui trouvent un réconfort dans l’héroïne). Chez Faulkner, ils prennent la parole à tour de rôle. Chez McGregor, ils prennent la parole en choeur. C’est un «nous» qui les désigne. Des narrateurs qui pourraient être des fantômes ou des chiens, certaines scènes étant vues à travers les yeux des clébards partageant la vie des junkies.
Le premier chapitre est une scène d’exposition parfaitement maîtrisée. Alors qu’un cordon de sécurité vient d’être déroulé autour de l’entrée de l’immeuble où le corps de Robert Radcliffe a été découvert, que les officiers de la police judiciaire effectuent toutes les constatations utiles sur le corps du défunt et que le photographe dispose ses lampes pour prendre toutes les photos nécessaires, le «nous» désignant les narrateurs voit Robert refaire l’appartement où il va vivre avec Yvonne, il les entend faire l’amour. Dans un va-et-vient entre le présent de narration et des séquences du passé, on apprend que Robert et Yvonne ont eu une fille, Laura et que, au bout d’un certain temps, Robert a perdu son boulot, et qu’Yvonne a quitté le domicile avec sa fille, laissant le gros alcoolique à sa solitude et à son désespoir.
Les effets de réel ont une telle efficace qu’on pourrait se croire dans un livre de l’anthropologue-romancier Oscar Lewis qui, dans les années soixante, a suivi dans leur émigration une famille de paysans et poursuivi l’étude en milieu urbain. Or tout, jusqu’au plus petit détail, est imaginé chez McGregor. L’incertitude des points de vue narratifs donne encore plus de force à son roman, certes influencé par le cinéma mais qui n’a strictement rien du scénario prêt à être tourné. Un type amaigri qui rentre en haletant dans une pharmacie pour prendre la dose de méthadone à laquelle il a droit, un autre qui se roule une clope avec les mégots qu’il a trouvés par terre sont des spectacles courants dans une ville du XXI e siècle, mais que faire avec ça, dès qu’on prend la peine de s’arrêter et d’enregistrer ces éclats de réalité?
Nulle trace de misérabilisme ici, le lecteur n’est pas sommé de se dire beurk quelle horreur cette saleté! Comme dans Dodeskaden de Kurosawa, où des draps colorés sont tendus pour remplacer le ciel, chaque détail a une fonction précise. Non pas celle de célébrer la misère ou d’en faire le chiffre d’une réalité magnifiée par l’amour. McGregor ne bande pas pour le crime comme Genet avec son lyrisme des catacombes. Si l’auteur évoque la bouche gercée et couverte de croûtes de Laura allongée sur un lit, à côté de son copain, dans sa chambre au foyer, c’est pour ramener le lecteur emporté par la vision de Danny s’imaginant dans un appart plus classe, c’est pour ramener ce lecteur d’un coup de cravache au réel de cette gamine qui se disloque dans les paradis artificiels. Pour se glisser dans la peau des junkies et rendre leur présence vraisemblable, McGregor se pose la question de leur langage. Même les comparaisons sont celles que pourrait faire un héroïnomane: «les autres se sont volatilisés comme un, merde, comme une bouffée de quoi, comme un chèque d’allocs». Il mime le langage des toxicomanes, dans lequel les métaphores et les métonymies ne fonctionnent plus, un langage basique qui colle à l’os, renvoyant directement à ce manque qui les taraude, «ce manque planqué derrière vous toute la journée, pendant que vous fauchez, achetez, faites chauffer, injectez».
Certains personnages du roman vivent dans une telle déréliction que les petits moments de réconfort, ils ne les oublient pas, comme chez la pédicure quand elle vous masse les pieds et coupe les ongles des orteils, comme chez le coiffeur quand il vous passe les doigts dans les cheveux ou à l’hôpital quand l’infirmière change les pansements, prend la tension, écoute craquer les poumons et qu’elle vous touche de ses mains propres et douces, ou dans la rue quand un pote vous frotte la peau, introduit l’aiguille et injecte lentement la came. Ces marginaux ont alors le sentiment de jouer dans un film de guerre «quand un personnage porte à boire aux lèvres d’un soldat blessé à l’article de la mort (...) Toute la journée à attendre ça». Ils ont vraiment besoin de quelque chose pour tenir jusqu’à la prochaine crise de manque.
Les lieux qu’apprécient ces gueux, ballottés qu’ils sont d’un passage souterrain l’autre par leurs pulsions tyranniques, ce sont ces endroits secs et chauds que représentent une salle d’attente, un bureau des allocs, un office du logement, un cabinet de médecin ou de psy, une salle de tribunal ou un poste de police, ces endroits qui ne sont pas plus mal que d’autres pour s’asseoir quand on a le temps, comme ont le temps ceux qui racontent, tout le temps du monde, et qu’on n’a pas grand-chose de mieux à faire, ces endroits chauds et secs où sont alignées de dures chaises métalliques et où les pendules font tic-tac.
Un de ces endroits pourrait être le couloir d’une morgue ou d’un institut médico-légal: «Robert glacé sur son lit d’acier derrière cette porte». Le corps du vieil alcoolique est lavé, minutieusement inspecté, systématiquement exploré. Des cheveux, des sourcils sont délicatement arrachés par la racine. On effectue des prélèvements dans sa bouche, son nez, ses oreilles, son anus. Le corps de ce clodo est choyé comme jamais il ne l’a été de sa vie. «Et s’ils nous accordaient autant d’attention, à nous tous» commentent les exclus. Quel angle ou quel point de vue adopter pour dire le monde en ce début de XXI e siècle.
Pour raconter la première guerre, le colonialisme en Afrique, l’Amérique de l’entre-deux guerres, Céline créa un personnage «qui se meut avec son barda», un zonard sans importance sociale, un moins que rien dont l’atout principal est une gouaille faubourienne signalant une énergie vitale peu commune. Ceux qui racontent, dans «Même les chiens», en sont totalement dépourvus, de cette énergie vitale. Ce ne sont pas des dépressifs ou des mélancoliques, ils n’ont même pas la force de se révolter, ils sont traqués comme des bêtes à bout de souffle. Le langage qui leur est prêté ne peut avoir la richesse, la drôlerie du pseudo-langage parlé inventé par Céline.
Une scène emblématique du roman: Heather, la grosse toxico avachie, dents pourries, oeil tatoué au milieu du front, quinca qui ne contrôle plus ses sphincters, qui pue l’alcool et la sueur, attire sur un lit le petit Ben pété, récemment sorti de prison. Elle lui déboutonne son pantalon, lui serre les couilles, «lui passe ses doigts calleux dans la raie du cul». Elle s’acharne à le sucer, lui promet plus de crack s’il accepte de la baiser. Elle l’introduit en elle en poussant des gémissements d’accro au crack. Tiens-moi les poignets, qu’elle lui dit. Elle a des croûtes et des bleus sur les cuisses, des brûlures de cigarette sur le ventre. Tire-moi les cheveux salaud! Il lui répond, Espèce de grosse salope, merde, salope malade! Cette satisfaction d’une envie qui advient dans un climat de chantage et d’avidité excluant toute forme de désir n’est pas sans rappeler le soulagement qu’on connaît en satisfaisant un besoin dit naturel.
Il fallait, pour raconter ça, une écriture sèche, totalement dégraissée et anti-métaphorique, rythmée, sophistiquée, très travaillée, hoquetante, essoufflée qui mime la langue des suicidés. C’est le pari fait par McGregor, et qu’il gagne de manière magistrale. Mimer cette langue est le moyen, pour lui, d’en créer une qui soit une langue dans la langue, seule à même de raconter ce que peut éprouver ou vivre un être en état de manque, c’est-à-dire un homme écrivant «Même les chiens».
Jon McGregor: Même les chiens, Bourgois, 2012
 Toutes ces qualités, on les retrouve, brillantes comme un diamant, chez Mousse Boulanger. Faut-il encore présenter cette femme au destin extraordinaire, née à Boncourt en 1926, dans une famille nombreuse, et qui fut, tour à tour, journaliste, productrice à la radio, comédienne, écrivaine et poète ?
Toutes ces qualités, on les retrouve, brillantes comme un diamant, chez Mousse Boulanger. Faut-il encore présenter cette femme au destin extraordinaire, née à Boncourt en 1926, dans une famille nombreuse, et qui fut, tour à tour, journaliste, productrice à la radio, comédienne, écrivaine et poète ? Ce mois-ci, Mousse Boulanger publie Les Frontalières*, un livre magnifique qui est à la lisière du récit et du poème. La lisière, les limites, la frontière : c’est la vie de la narratrice, petite fille toujours en vadrouille, qui passe gaillardement de Suisse en France, et vice versa, dans les années qui précèdent la Seconde guerre mondiale. L’herbe est toujours plus verte, bien sûr, de l’autre côté. Elle franchit la frontière à bicyclette, sans se préoccuper des gros nuages noirs qui envahissent le ciel. À travers ses souvenirs d’enfance, Mousse Boulanger ravive la mémoire d’une époque, d’un village, d’une famille. Elle brosse le portrait émouvant d’une mère éprise de liberté qui ne comprend pas toujours ses enfants.
Ce mois-ci, Mousse Boulanger publie Les Frontalières*, un livre magnifique qui est à la lisière du récit et du poème. La lisière, les limites, la frontière : c’est la vie de la narratrice, petite fille toujours en vadrouille, qui passe gaillardement de Suisse en France, et vice versa, dans les années qui précèdent la Seconde guerre mondiale. L’herbe est toujours plus verte, bien sûr, de l’autre côté. Elle franchit la frontière à bicyclette, sans se préoccuper des gros nuages noirs qui envahissent le ciel. À travers ses souvenirs d’enfance, Mousse Boulanger ravive la mémoire d’une époque, d’un village, d’une famille. Elle brosse le portrait émouvant d’une mère éprise de liberté qui ne comprend pas toujours ses enfants.