L'insoutenable liberté du rire
Par Pierre Béguin
La blague de Galtier sur le char à voile, accompagnée du rire de M’Bappé, a choqué tout ce que la France compte comme Torquemada, Tartufe et autre Trissotin. Peu importe que la blague soit bonne ou mauvaise: si on interdisait toutes le formes d’humour que les gens n’accréditent pas, il ne resterait au rire plus un seul millimètre pour s’exprimer. Non! Le véritable enjeu consiste à questionner la réaction démesurée prise par une simple blague dans le débat public et la sphère politique. Tout se passe comme si on avait heurté un interdit, un tabou absolu, intransgressible - à la manière, pour qui vous savez, des caricatures de qui vous savez. Et le plus étonnant, c’est que ceux qui s’indignent qu’on ait pu rire d’un précepte de la religion climatique sont les mêmes qui hurlaient à la liberté d’expression après l’effroyable tuerie de Charlie Hebdo...
Cet épisode nous renvoie à un passage de Le Nom de la Rose, où Guillaume de Baskerville (un frère franciscain chargé d’enquêter sur les crimes commis au sein d’une abbaye bénédictine située entre la Provence et la Ligurie) et un vénérable moine, Jorge de Burgos (en référence à Jorge Luis Borges et à sa fameuse «Bibliothèque de Babel» qui a inspiré celle de l’abbaye, au centre de tous les crimes) ont cet échange édifiant:
G.B. : - Le rire est le propre de l’homme.
J.d.B. : - Comme le péché! Le Christ n’a jamais ri!
De fait, Jorge de Burgos est une incarnation de la bibliothèque et se révèle le véritable maître de l’abbaye. Il développe un argumentaire sur le danger démoniaque que représente le rire pour les humains. Pour cette raison, il veut garder secret l’unique manuscrit d’Aristote sur la comédie (aujourd’hui perdu), second tome de sa Poétique, afin que l’humanité ne puisse y accéder. Car le rire exorcise la peur. Or, pour lui, on ne peut vénérer Dieu que si on le craint…
Tout est là! On ne peut vénérer - donc se soumettre à - une entité, une idéologie, une religion (même si cela revient à confondre superstition et foi) que si on la craint. Une blague, une seule, et le Roi est nu, ridicule. Au fond, seul Bouddha se permet de sourire. Même le Roi, au Moyen Âge du moins, avait son fou. Aujourd’hui, on ne rit plus. Toute dictature commence par supprimer l’humour, la dérision, le second degré, le droit de se moquer, de caricaturer. Si nous ne sommes plus libres de rire, nous ne le sommes plus de penser par nous-mêmes. Monsieur Galtier, vous avez commis une blague douteuse! Monsieur M’Bappé, vous avez osé rire! Il faut vous repentir, faire amende honorable et publique (pour M’Bappé, c’est fait, il a marqué deux buts hier soir, mais pour Galtier, c’est loin d’être dans la poche).
Je me demande qui aurait encore la mauvaise foi de nier cette évidence: notre époque, qui entend tout imposer par la peur et la culpabilité, a poussé cette stratégie à l’extrême. Et force est de constater que ça marche: le refus du rire, et de tout ce qui serait susceptible de mettre la peur à distance, vise à tétaniser les peuples jusqu’à ce que tout le monde soit d’accord sur les préceptes qu’on veut nous imposer. Et la religion climatique n’est pas seule en cause! Demandez à Claude Inga Barbey ce que peut coûter, même en Suisse, une blague sur les trans. Ou à J.K. Rowling une simple question de bon sens sur la théorie genre. En Irlande, on vient d'envoyer en prison un enseignant qui refusait de s'adresser à un élève genré par le pronom "iel" (son équivalent anglais, donc).
Non! On ne rit plus! La planète brûle. Une rééducation complète de notre perception frivole s’impose d’urgence. Acceptons d’être reprogrammés aux normes du totalitarisme vert (et par la même occasion du wokisme) sous peine de rester des êtres sauvages et dangereux. Des menus dans les cafétérias, en passant par le BBQ (cette monstruosité mâle cisgenre) et par l’avion (autre immonde symbole phallique) jusque dans notre intimité la plus secrète. Car le propre des idéologues, des fanatiques, de tous ces gens éclairés par une révélation et qui veulent nous y convertir en urgence, c’est de ne pas supporter qu’on ne fasse pas les mêmes prières qu’eux. Tout réfractaire doit donc subir le sort réservé aux hérétiques!
Alors que le rire, lui, est avant tout libérateur, donc dangereux pour toute forme de pouvoir, à plus forte raison s’il se veut absolu. Je pense à la fable du roi Ophioch, narrée à l’intérieur d’un récit de E.T.A. Hoffmann, La Princesse Brambilla. Selon cette fable, la réflexion sépare les hommes de la nature maternelle et les voue à la tristesse de l’exil. Mais pour le roi Ophioch et la reine Liris, captifs d’un long sommeil, la délivrance viendra par un redoublement de la réflexion, c’est-à-dire par l’humour et l’ironie: en se penchant sur les eaux du lac magique d’Urdar, ils découvrent leur image inversée, ils se regardent l’un l’autre, et ils éclatent de rire. L’exil a pris fin. Car si l’intelligence peut devenir une boussole qui indique le sud, le rire, lui, à sa manière, indique toujours le nord. Il est en cela bien plus fiable que la pensée. Puisse notre époque s’inspirer de cette fable!
Oui! Le rire – on ne le répétera jamais assez – sert à placer une distance entre soi et l’absolu. Il est essentiel, vital, pour remettre les choses, et surtout les êtres, à leur vraie place, en leur rappelant qu’ils sont avant tout grotesques dans leur vanité et leur prétention au savoir, et finalement que poussière éphémère sur une terre qui s’est longtemps passée d’eux et qui s’en passera définitivement le moment venu. Le rire, c’est une arme redoutable braquée comme une punition envers celles et ceux qui se laissent aller à la raideur et oublient la souplesse exigée par la vie, à l’image de toutes ces religions sans dieu qui empestent nos existences depuis plus d’une décennie.
Il faut en rire, il faut se moquer, il faut tourner ce délire en dérision. Que celles et ceux qui possèdent ce talent extraordinaire en usent et en abusent! Le jour où le rire fera plus de bruit que les délires totalitaires qu’il doit combattre sera un grand jour libérateur.
Dans le contexte que l’on subit, davantage que le char à voile de Galtier, c’est le rire qui peut sauver la planète en mettant à nu ces rois d’opérette, ces Torquemada, ces Tartufe, ces Trissotin, tous ces chantres de l’inquisition qui, aujourd’hui, exigent à grand renforts d’indignation le châtiment public et exemplaire de toute dissidence.
 Jean-Jacques Busino aime le café, très noir et bien serré. Depuis Un café, une cigarette* (1993), son premier livre, on ne compte plus les personnages qui se rencontrent autour d'un petit noir. Après 11 ans d'absence, Busino nous revient avec un grand roman choral, Le Ciel se couvre**, plus proche de Cancer du Capricorne (2011) que de ses premiers polars.
Jean-Jacques Busino aime le café, très noir et bien serré. Depuis Un café, une cigarette* (1993), son premier livre, on ne compte plus les personnages qui se rencontrent autour d'un petit noir. Après 11 ans d'absence, Busino nous revient avec un grand roman choral, Le Ciel se couvre**, plus proche de Cancer du Capricorne (2011) que de ses premiers polars.  Désormais investi du rôle de nouveau patriarche, son fils Jésus va tenter de faire toute la lumière sur cette disparition étrange. Et son enquête, bien sûr, révélera des scandales et des secrets qui vont ébranler l'équilibre fragile de cette communauté villageoise.
Désormais investi du rôle de nouveau patriarche, son fils Jésus va tenter de faire toute la lumière sur cette disparition étrange. Et son enquête, bien sûr, révélera des scandales et des secrets qui vont ébranler l'équilibre fragile de cette communauté villageoise. 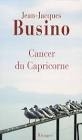 Tous ceux (comme moi) qui avaient aimé le terrible et beau Cancer du Capricorne (2011) aimeront ce livre intense et passionné où la musique (Neil Young, Robert Fripp et King Crimson, les Pink Floyd) a toujours le dernier mot.
Tous ceux (comme moi) qui avaient aimé le terrible et beau Cancer du Capricorne (2011) aimeront ce livre intense et passionné où la musique (Neil Young, Robert Fripp et King Crimson, les Pink Floyd) a toujours le dernier mot. Dans les livres de Metin Arditi, le père brille souvent par son absence. Une absence centrale, fondatrice, essentielle. Et tout s'organise, dirait-on, autour de cette figure absente, quelquefois idéalisée ou fantasmée. On se rappelle le beau Loin des bras (2009) (qui initiait le thème de l'enfant mis en pension, loin des siens), Le Turquetto (2011) et, plus récemment, Mon père sur mes épaules (2017).
Dans les livres de Metin Arditi, le père brille souvent par son absence. Une absence centrale, fondatrice, essentielle. Et tout s'organise, dirait-on, autour de cette figure absente, quelquefois idéalisée ou fantasmée. On se rappelle le beau Loin des bras (2009) (qui initiait le thème de l'enfant mis en pension, loin des siens), Le Turquetto (2011) et, plus récemment, Mon père sur mes épaules (2017).  Le roman commence à Vérone en juillet 1978. Renato, le personnage principal, a sept ans. C'est l'image même de l'innocence et de la beauté. Il est le fils d'un homme qui a fait fortune dans le commerce des glaces (i gelati), Francesco Barro, et se trouve, pour cette raison (absurde) en tête de liste des cibles privilégiées des Brigadistes. Il sera enlevé, puis relâché contre rançon, mais tellement affecté par son enlèvement qu'il finira par se jeter du haut d'un pont sur l'Adige…
Le roman commence à Vérone en juillet 1978. Renato, le personnage principal, a sept ans. C'est l'image même de l'innocence et de la beauté. Il est le fils d'un homme qui a fait fortune dans le commerce des glaces (i gelati), Francesco Barro, et se trouve, pour cette raison (absurde) en tête de liste des cibles privilégiées des Brigadistes. Il sera enlevé, puis relâché contre rançon, mais tellement affecté par son enlèvement qu'il finira par se jeter du haut d'un pont sur l'Adige… C'est l'amorce de ce roman vif et brillant qui, bien vite, retournera en Suisse, puisque Renato sera mis en pension dans un internat sur la côte vaudoise, près de Lutry. C'est là que Renato va faire la connaissance de Paolo Mantegazza, son professeur de théâtre, avec qui il va se lier et qui deviendra, à sa manière, un second père — un père de substitution.
C'est l'amorce de ce roman vif et brillant qui, bien vite, retournera en Suisse, puisque Renato sera mis en pension dans un internat sur la côte vaudoise, près de Lutry. C'est là que Renato va faire la connaissance de Paolo Mantegazza, son professeur de théâtre, avec qui il va se lier et qui deviendra, à sa manière, un second père — un père de substitution.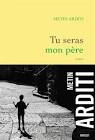 Ce pourrait être l'arrêt de mort du livre et sa conclusion : la mise au point d'une vengeance implacable de la part de Renato, floué et malheureux. Mais le roman se poursuit. La pièce de théâtre que préparent les pensionnaires — À chacun sa vérité, écrite en 1917 par Luigi Pirandello, et montée à Genève par Claude Stratz à la Comédie — est jouée, comme si de rien n'était. Et remporte un triomphe.
Ce pourrait être l'arrêt de mort du livre et sa conclusion : la mise au point d'une vengeance implacable de la part de Renato, floué et malheureux. Mais le roman se poursuit. La pièce de théâtre que préparent les pensionnaires — À chacun sa vérité, écrite en 1917 par Luigi Pirandello, et montée à Genève par Claude Stratz à la Comédie — est jouée, comme si de rien n'était. Et remporte un triomphe.