Dans l'attente d'un autre ciel
Par Pierre Béguin
Le 9 novembre dernier, Damien Murith, pour Dans l’attente d’un autre ciel, recevait le Prix de la ville de Carouge Yvette Z’Graggen, donné en association avec la ville de Carouge, La Maison Rousseau et de la littérature, et la Compagnie des Mots. En tant que Président du jury, il me revenait la plaisante tâche de faire la «Laudatio» du livre récompensé. La voici ci-dessous dans son intégralité:
«Quand on a enseigné, comme moi, la littérature pendant plus de trente ans, qu’on a semé dans des énoncés de semestrielles ou d’examens de maturité des centaines et des centaines de citations d’auteurs, on ne peut plus lire un texte sans que la mémoire nous régurgite quelques unes de ces citations que la lecture a réveillées.
Lorsque j’ai lu Dans l’attente d’un autre ciel, trois citations, au gré des pages, se sont imposées à mon esprit, et pas des moindres.
- La première, presque immédiatement, de Paul Valéry: «La poésie est l’ambition d’un discours qui soit chargé de plus de sens et mêlé de plus de musique que le langage ordinaire n’en porte et ne peut en porter». Pour l’anecdote, cette citation – j’ai vérifié – figure dans un examen de maturité de 1996. Et pourtant, cette lecture l’a fait ressurgir dès les premières pages. Il faut dire que toute personne ayant lu Dans l’attente d’un autre ciel tisse immédiatement un lien avec cette définition que donne Valéry de la poésie.
- La seconde, rendue aussi évidente pour moi par le fait qu’elle émane d’un de mes trois poètes de prédilection, Pierre Reverdy: «Rien ne vaut d’être dit en poésie que l’indicible; c’est pourquoi l’on compte beaucoup sur ce qui se passe entre les lignes». L’indicible. Entre les lignes, et également entre les séquences, les paragraphes, les parties. Là encore, chacun d’entre vous aura compris en quoi cette définition de Reverdy illustre le texte de notre lauréat.
- Enfin, mais tout le monde connaît cette fameuse phrase de Paul Eluard: «Les poèmes ont toujours de grandes marges blanches. Leur principale qualité est non pas d’évoquer, mais d’inspirer».
J’imagine que Damien Murith, s’il avait pu être présent parmi nous, n’aurait pas été fâché d’apprendre que son texte convoque spontanément à sa lecture des poètes comme Valéry, Reverdy et Eluard. Et ces références sont parfaitement fondées et méritées.
D’abord, il s’agit de citations qui, toutes trois, définissent la poésie, et non le roman. Si Dans l’attente d’un autre ciel emprunte aux codes du roman, s’il oscille entre poésie et texte narratif, il penche à mon sens plus souvent du côté de la poésie. Par cette écriture «taillée au couteau» (pour reprendre l’expression d’Annie Ernaux), par ce style décapé, jusqu’à la substantifique moelle, capable d’extraire l’essence des choses. Nous sommes dans l’ellipse. Il n’y a pas un mot de trop, pas une lettre de trop, et c’est exactement ça l’ambition du discours poétique tel que le définit Valéry. Et puis, il y a l’indicible dont parle Reverdy, cette part d’indicible où se cristallise, dans le texte de Damien Murith, un mélange d’ennui, de froid, de peur, d’abandon, de solitude, de souffrance, celle de Léo, l’enfant qui doit grandir et devenir un homme en dépit de tout, de l’abandon du père, des démissions de la mère, de ce «lieu clos et froid où épuisé plus rien ne fait signe». Et c’est bien dans les marges, dans les espaces blancs séparant cette suite d’instantanés, qui composent le tissus textuel, que se déploie le narratif, un narratif pour ainsi dire donné comme une somme de négatifs, que la capacité du lecteur à se représenter le non dit, le suggéré, devra développer, comme on développe une photo. Car ce lecteur est appelé, comme dans toute expérience poétique, à faire sa part de travail pour que surgisse le sens. Et alors seulement se produit ce qu’on peut appeler le miracle littéraire: la rencontre avec l’autre. L’expérience intime, transcendée par l’excellence formelle, devient un lieu d’ouverture à l’universel, et Leo, l’enfant abandonné, un peu de nous-mêmes.
Comme l’a très bien exprimé un membre de notre jury: «Dans l’attente d’un autre ciel se lit comme un vitrail. Chaque pièce est une prose poétique. Le lecteur reconstruit une narration à première vue éclatée, se surprend à jouir de sa propre émotion, éveillées par taches successives. La lecture devient la clé d’une mosaïque surprenante et implacable».
Dans sa structure, ce vitrail, cette mosaïque, se compose de 5 parties, elles-mêmes composées d’un nombre inégal de ce que je nommerais des séquences, des sortes d’instantanés, eux-mêmes de longueur inégale, allant d’une phrase, d’un paragraphe, d’une page.
La première partie, de loin la plus longue – elle se compose de 45 séquences –, pose le décor lugubre, l’atmosphère anxiogène, étouffante, poisseuse, les tours grises de béton, l’appartement insalubre qui pue l’urine de chat, le terrain de basket-ball, unique échappatoire; et les personnages, la mère qui attend à la folie l’impossible retour du père, les voisins qui se plaignent, toutes ces relations qui ne se nouent jamais, et finissent par creuser ce vide qui est à la fois celui du lieu et de la désertion de tout ce qui permet à l’humain de se former et d’exister.
La seconde partie, plus courte – 9 séquences – est une sorte de respiration – de quart-temps pour filer la métaphore du basket-ball –, qui voit l’arrivée de juillet, du soleil, du bleu... et son cortège d’illusions, l’illusion d’une brève rencontre avec la mère, le temps des vacances d’été.
La troisième partie, c’est justement les 18 séquences qui racontent le voyage avec la mère. Le narrateur change, c’est le surgissement du «tu» comme si la mère, cette fois, s’adressait à Léo, à son fils enfin aimé. Un moment de suspension où s’infiltrent les cruelles illusions, l’illusion de l’amour retrouvé, de l’échange, de la tendresse maternelle, l’illusion d’un nouveau départ.
Des illusions fracassées par le retour à l’appartement. C’est la quatrième partie, c’est l’automne, c’est la grisaille, c’est la lourdeur, et c’est l’amertume.
Et enfin la cinquième partie, l’épilogue en trois brèves séquences, Léo devenu adulte et revenant sur les lieux de son enfance, de ses souffrances, de son complexe d’abandon. Avec le retour du «tu» narratif, mais cette fois inversé, Léo s’adressant à sa mère, à l’absente, dorénavant. Écoutons-le: «J’ai levé les yeux vers les fenêtres du 13e étage, et j’ai revécu tes silences, j’ai ressenti tes absences, le souffle glacé de tes violences. Alitée dans le passé, m’entendais-tu supplier des maintenant de jasmin, de chocolat, de notes de musique?» En dépit de tout ce qui pouvait entraver, chez l’enfant, la naissance de l’adulte, la transformation s’est effectuée, le miracle de la chrysalide semble avoir opéré, et avec lui l’espoir d’un autre ciel. Et c’est bien sur ces mots sublimes que se conclue cet itinéraire d’un enfant livré à lui-même: «Je veux imaginer possible la traversée de tous les déserts, et comme le mauve de l’aube, croire à la beauté d’un autre ciel».
Car il ne faut pas oublier l’espoir, dans cette prose poétique qu’est le récit de Damien Murith. En dépit de tout, l’espoir s’entête, il s’obstine, il résiste tout au long de cet itinéraire douloureux. Il y a bien quelques traits lumineux dans la grisaille, l’école, le chat complice, mais c’est surtout le basket-ball qui fait office de rédemption.
Les dix séquences qui renvoient au basket-ball sont disséminées dans les 4 premières parties – comme les quart-temps d’une partie de basket-ball – et se distinguent par l’emploi de l’italique, et une voix qu’on peut identifier à celle d’un entraîneur distillant ses conseils à un jeune joueur. Des conseils qui sont autant de leçons de vie, et qui finissent par former un cadre susceptible de remplacer celui, défaillant, de la famille, et permettre à Léo de s’appuyer sur une base solide pour grandir.
Voyons, pour terminer, quels enseignements, transposables à sa future vie d’adulte, le basket-ball apprend à Léo:
- Toujours garder confiance: le panier est juste assez grand pour laisser passer le ballon. Et pourtant, le ballon va passer, des dizaines de fois.
- Ne jamais perdre de vue son objectif: ce ballon, qu’on ne doit pas quitter des yeux.
- Développer l’instinct de lutte, de résistance: contrer l’adversaire, l’empêcher de marquer un panier, tout aussi important que d’en marquer un.
- Développer le sens du rythme: perdre le rythme, c’est perdre le ballon, et perdre le ballon, c’est perdre l’objectif.
- Toujours se référer à des exemples de réussite: les stars qui ont marqué l’histoire du basket-ball.
- Développer le sens de l’improvisation: faire le bon choix, en une fraction de seconde, presque instinctivement.
- Développer son mental: contrairement aux muscles, la tête ne se repose jamais, même durant les pauses.
- Développer le sens de la ruse, indispensable en politique: faire semblant de partir à gauche, et dribbler à droite. Entre le mensonge et la vérité, il n’y a parfois qu’un ballon de basket-ball.
- Apprendre à faire abstraction de son handicap, à miser aussi sur ses points faibles: le basket, ce n’est pas que pour les grands: Muggsy Bogues, le plus petit joueur de l’histoire de la NBA, mesurait 1,59 et il sautait si haut qu’il parvenait à contrer des géants de 2 mètre 14.
- Apprendre à dominer sa peur: celle du public, de l’adversaire, de mal jouer, de perdre.
Outre la beauté formelle, dont nous avons déjà largement parlé, c’est de cela, de tous ces apprentissages dispensés par le sport, par le basket-ball en l’occurrence, que se nourrit l’attente d’un autre ciel."
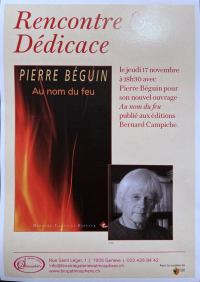
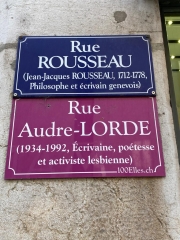

 Nous avions dit, ici, tout le bien que nous pensions de Roches tendres, de Julien Burri, paru aux éditions d'autre part. Le Jury du Prix Edouard-Rod vient de lui décerner son Prix pour l'année 2022. Bravo à lui et aux jurés pour ce choix judicieux !
Nous avions dit, ici, tout le bien que nous pensions de Roches tendres, de Julien Burri, paru aux éditions d'autre part. Le Jury du Prix Edouard-Rod vient de lui décerner son Prix pour l'année 2022. Bravo à lui et aux jurés pour ce choix judicieux !  « Molasse des mots dans la bouche, les mots tombent en sable avant d'être prononcés. La roche dit la débâcle discrète et le glissement des heures, elle dit l'érosion silencieuse, le roulement des glaciers, le ruissellement des orages, les grains dérobés aux pierriers. »
« Molasse des mots dans la bouche, les mots tombent en sable avant d'être prononcés. La roche dit la débâcle discrète et le glissement des heures, elle dit l'érosion silencieuse, le roulement des glaciers, le ruissellement des orages, les grains dérobés aux pierriers. »