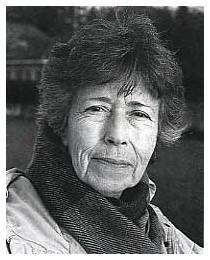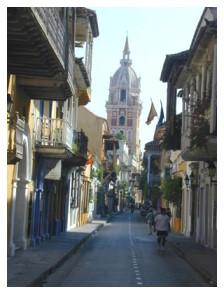Réverbération, de Jean-Marc Lovay
Par Alain Bagnoud
 Comment lire Jean-Marc Lovay ? De diverses méthodes que j’ai éprouvées, il ressort que ce qui fonctionne le mieux, c’est de se laisser porter. Comme si on descendait un fleuve à son rythme à lui.
Comment lire Jean-Marc Lovay ? De diverses méthodes que j’ai éprouvées, il ressort que ce qui fonctionne le mieux, c’est de se laisser porter. Comme si on descendait un fleuve à son rythme à lui.
On suit le mouvement des phrases. On évite d’accrocher, surtout. C’est difficile.
On ne saisit pas tout, on ne saisit même pas grand chose. Des fragments de phrase ou de texte, mais pas toujours le sens de leur juxtaposition. La raison alors nous taraude. Elle veut nous persuader de revenir à une proposition, à une expression, à une image, afin de la déchiffrer, de la clarifier. On peut le faire, c’est en vain.
Vous ne comprenez jamais, parce qu’il ne s’agit pas ici de comprendre. Il s’agit d’éprouver un langage, dans sa plasticité, dans l’organisation des éléments qui le constituent, dans le jeu des sonorités.
Lovay dans sa démarche s’apparente plus aux artistes contemporains qui mettent en valeur les éléments du tableau, qui font sentir la matérialité de la peinture, du support, les rapports de couleur, les équilibres, les nuances, les contrastes, qu’à ceux qui veulent représenter quelque chose. Qui veulent mettre devant nos yeux un paysage, une scène ou un portrait.
Qu’est-ce qu’on trouve dans Réverbération ? Un trajet, un voyage. Un flot d’images fortes. Une avancée du texte avec des éléments qui le structurent et évoluent (le personnage de Krapotze, ancien meilleur apprenti pleureur final, qui se présente au poste de Grand Suicideur et n’est pas élu, les animaux, un parapluie, etc.). De l’humour. Une phrase complexe, organisée, étendue, riche, articulée. Et dans ce déploiement classique, la rugosité d’un accent, la matérialité rauque d’un rythme.
S’il s’agit de marche, on n’est pas dans la plaine, mais en montagne, avec les différents rythmes un peu essoufflés par des variations de pente et les accidents du terrain. Marche évidemment, parce que Réverbération s’apparente à ces monologues ouverts qui passent dans les têtes, fatigue, exaltation et endorphines aidant, lors des trajets vers les sommets.
Avec quelque chose aussi d’une prise d’acide et d’un rêve. Les objets qui se transforment, qui évoquent, qui deviennent autre chose tout en restant eux-mêmes.
C’est une écriture, en fait, directement issue des années soixante. Une époque où Lovay s’est formé. Une époque où on n’avait pas peur de l’illisibilité. Une époque où on cultivait le délire. Où on pratiquait l’ivresse de la langue.
Mais cette écriture n’est pas datée pour autant. Elle ne s’est pas figée en une croûte épaisse comme par exemple celle du Nouveau Roman. Lovay l’a approfondie, travaillée, creusée selon son génie propre, dans une pratique et un forage personnel qui forcent le respect.
Jean-Marc Lovay, Réverbération, Editions Zoé
(Publié aussi dans Le blog d’Alain Bagnoud)