Restauration de C...
Par Pierre Béguin
![calvin1[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/02/01/3636670149.jpg) Peu à peu, délicatement, elle enlève le haut et se dévoile aux passants de la rue Théodore-de-Bèze qui peuvent déjà admirer sa nouvelle toiture. Demain le bas! L’aile nord du Collège Calvin apparaîtra enfin dans son entière nudité. Et l’on pourra se rincer l’œil devant sa façade restaurée et les mansardes admirablement travaillées par des spécialistes. Et ce n’est pas fini. Car la restauration de façade prévue par nos autorités pour le plaisir de l’électeur, après maints palabres, se poursuivra finalement sur deux ans par une restauration qui englobera tout l’intérieur du bâtiment. Certes, ce ne fut pas facile pour transformer la restauration de cons initialement programmée en une restauration de fond depuis longtemps souhaitée. Question de lettre, même si l’esprit a fini par triompher. Il a donc fallu du temps, de la persévérance, de l’entêtement pour faire admettre à nos politiciens que le Collège Calvin n’est pas seulement un monument ou un site photographié par quelques touristes, mais avant tout un lieu où travaille quotidiennement presqu’un millier de personnes. Mais bon, c’est admis! Le canal auditif s’est débouché, les neurones se sont réveillés, les bourses se sont déliées. Et les salles de cours, couloirs, (trop rares) toilettes, bureaux, d’une incroyable – pour ne pas dire insalubre – vétusté, vont enfin retrouver la décence qui leur était due. Même la cour, dont la réfection, à la suite d’un concours, était programmée pour la fin… des années 1980, n’échappera pas à une nouvelle surface, semble-t-il en terre du Salève, par ailleurs peu adaptée aux contraintes d’une cour de Collège.
Peu à peu, délicatement, elle enlève le haut et se dévoile aux passants de la rue Théodore-de-Bèze qui peuvent déjà admirer sa nouvelle toiture. Demain le bas! L’aile nord du Collège Calvin apparaîtra enfin dans son entière nudité. Et l’on pourra se rincer l’œil devant sa façade restaurée et les mansardes admirablement travaillées par des spécialistes. Et ce n’est pas fini. Car la restauration de façade prévue par nos autorités pour le plaisir de l’électeur, après maints palabres, se poursuivra finalement sur deux ans par une restauration qui englobera tout l’intérieur du bâtiment. Certes, ce ne fut pas facile pour transformer la restauration de cons initialement programmée en une restauration de fond depuis longtemps souhaitée. Question de lettre, même si l’esprit a fini par triompher. Il a donc fallu du temps, de la persévérance, de l’entêtement pour faire admettre à nos politiciens que le Collège Calvin n’est pas seulement un monument ou un site photographié par quelques touristes, mais avant tout un lieu où travaille quotidiennement presqu’un millier de personnes. Mais bon, c’est admis! Le canal auditif s’est débouché, les neurones se sont réveillés, les bourses se sont déliées. Et les salles de cours, couloirs, (trop rares) toilettes, bureaux, d’une incroyable – pour ne pas dire insalubre – vétusté, vont enfin retrouver la décence qui leur était due. Même la cour, dont la réfection, à la suite d’un concours, était programmée pour la fin… des années 1980, n’échappera pas à une nouvelle surface, semble-t-il en terre du Salève, par ailleurs peu adaptée aux contraintes d’une cour de Collège.
Mais bon, tout va être restauré. Tout? Non, car un irréductible vestige du milieu du siècle dernier résiste encore et toujours au restaurateur: le vitrage. Jalousement protégé par la Commission des monuments et des sites. Alors que l’Etat édicte règlements sur règlements pour transformer ses bâtiments en des forteresses écologiques minergisées de fond en comble, le Collège Calvin, refait à neuf à coup de millions, échappe à toutes les velléités d’isolation pour conserver ses vieilles vitres trouées labellisées années 40 et garanties pure bise. Au point que, au plus fort de la froidure, la température de certaines salles de cours trop exposées aux frimas ne dépasse guère les 16 degrés, ce qui ne facilite pas la mission déjà périlleuse du professeur de réveiller les énergies post acnéiques. Sans compter que la chaudière, en pleine activité hivernale, décide régulièrement de se faire la malle pour quelques jours de vacances pas du tout méritées. A croire qu’elle est, elle aussi, protégée par la Commission des monuments et des sites. Le Collège serait-il pourvu de quelques fenêtres à double vitrage qu’on ordonnerait illico presto leur remplacement par un vitrage unique de 3 millimètres d’épaisseur, totalement inefficace. Point barre. On ne plaisante pas avec les ayatollahs du patrimoine genevois. Estimons-nous heureux qu’ils ne nous imposent pas le papier huilé qui faisait office de vitrage au temps de notre vénéré Jean Calvin et le retour au poêle en guise de chauffage. Encore que le papier huilé et le poêle, outre qu’ils entreraient au moins dans une logique de sauvegarde du patrimoine, seraient probablement plus efficaces pour isoler et chauffer le bâtiment que l’état actuel qu’il faut, on ne sait pourquoi, absolument préserver. Alors? Voici venu le temps du mastic! Le vieux mastic sec et fendu qui tenait tant bien que mal certaines vitres trouées a, lui, été remplacé par un tout nouveau mastic beige et mou du plus mauvais effet. Un crime de lèse patrimoine que la Commission des monuments et des sites a dû entériner au motif que l’ancien mastic contenait de l’amiante. Conclusion: seule l’amiante est capable d’ébranler les convictions des gardiens du temple. Qu’on se le dise!
Ce que nos politiciens ont fini par entendre, nos barbus devraient bien finir eux aussi par le comprendre: le Collège Calvin n’est pas seulement un site exceptionnel de l’Histoire genevoise qu’il faut absolument préserver, c’est aussi un établissement scolaire occupé par près d’un milliers d’étudiant(e)s, de professeur(e)s et de personnels technique et administratif qu’il ne faudrait tout de même pas oublier. C’est le Passé certes, mais c’est aussi le Présent, voire le Futur. Restaurer le Collège Calvin, ce n’est pas seulement faire renaître son passé, c’est aussi le faire entrer dans l’avenir. C'est-à-dire le rendre compatible aux normes actuelles d’isolation sur les grandes lignes desquelles (et c’est plutôt rare) tous les partis politiques s’entendent.
A moins qu’on ait décidé sans nous en avertir de faire du Collège un Musée Calvin… ouvert seulement en été.
 La première lecture de La Piqueuse d'ourites
La première lecture de La Piqueuse d'ourites  Une seule exception: la femme pour qui a été écrit le Cantique des cantiques. Noire et belle. Noire pourtant belle. Les traductions s'affrontent et Antenen les confronte. Celle d'André Chouraki (1989): Moi noire, harmonieuse, fille de Ieroushalaim. Celle du protestant Louis Segond en 1910: Je suis noire, mais je suis belle. Celle de la catholique Bible de Jérusalem (1973): Je suis noire et pourtant belle.
Une seule exception: la femme pour qui a été écrit le Cantique des cantiques. Noire et belle. Noire pourtant belle. Les traductions s'affrontent et Antenen les confronte. Celle d'André Chouraki (1989): Moi noire, harmonieuse, fille de Ieroushalaim. Celle du protestant Louis Segond en 1910: Je suis noire, mais je suis belle. Celle de la catholique Bible de Jérusalem (1973): Je suis noire et pourtant belle.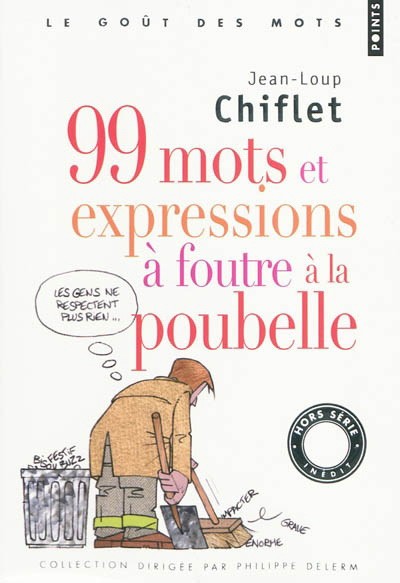
![butor[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/01/02/3096650766.jpg) Je ne devais guère avoir plus de 20 ans quand j’ai lu L’Emploi du temps de Michel Butor. Un passage a marqué ma relation avec l’écriture. On se souvient que le roman met en scène un personnage – Jacques Revel – fraîchement arrivé dans une ville imaginaire (Bleston) où il est chargé de la correspondance avec la France aux établissements Matthews & Sons. Envahi d’un insidieux malaise, et pour lever la gêne qui l’absorbe, il se met à retracer son parcours en consignant tous les événements vécus. Mais rédiger dans leurs détails ces différents épisodes, et surtout ceux qui lui ont paru sur le moment insignifiants mais dont il soupçonne par là-même l’importance a posteriori, lui prend du temps. Beaucoup de temps. Si bien que, pendant qu’il court vainement après le passé, le présent lui échappe. La vie se poursuit sans lui, hors de son espace temps rédactionnel. Ainsi, sa voisine, dont il est amoureux, s’en va avec un type qui, lui, ne passe pas son temps à consigner son emploi du temps.
Je ne devais guère avoir plus de 20 ans quand j’ai lu L’Emploi du temps de Michel Butor. Un passage a marqué ma relation avec l’écriture. On se souvient que le roman met en scène un personnage – Jacques Revel – fraîchement arrivé dans une ville imaginaire (Bleston) où il est chargé de la correspondance avec la France aux établissements Matthews & Sons. Envahi d’un insidieux malaise, et pour lever la gêne qui l’absorbe, il se met à retracer son parcours en consignant tous les événements vécus. Mais rédiger dans leurs détails ces différents épisodes, et surtout ceux qui lui ont paru sur le moment insignifiants mais dont il soupçonne par là-même l’importance a posteriori, lui prend du temps. Beaucoup de temps. Si bien que, pendant qu’il court vainement après le passé, le présent lui échappe. La vie se poursuit sans lui, hors de son espace temps rédactionnel. Ainsi, sa voisine, dont il est amoureux, s’en va avec un type qui, lui, ne passe pas son temps à consigner son emploi du temps. Fantômes est un très beau livre, beau en entier, forme et fond. L'objet est plastiquement réussi, soigné jusque dans ses détails, le papier, la couverture, l'esthétique. Et le contenu est magnifique.
Fantômes est un très beau livre, beau en entier, forme et fond. L'objet est plastiquement réussi, soigné jusque dans ses détails, le papier, la couverture, l'esthétique. Et le contenu est magnifique.
![cassandre[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/00/01/1080325521.jpg) «Il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre, Horatio, que n’en peut expliquer notre philosophie»
«Il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre, Horatio, que n’en peut expliquer notre philosophie» Votre serviteur a donc participé à un débat, hier, au salon du live de Genève, organisé par l'Association genevoise des écrivains. Le thème était vaste. Ecrire à Genève au XXIème siècle. Avec ça, évidemment, on était un peu dans le général.
Votre serviteur a donc participé à un débat, hier, au salon du live de Genève, organisé par l'Association genevoise des écrivains. Le thème était vaste. Ecrire à Genève au XXIème siècle. Avec ça, évidemment, on était un peu dans le général. les écoles. Je résume. On montre un peu les positions. Celle de Luc Weibel était la plus érudite et la plus au-dessus du panier: un passage dans Amiel, par exemple, pour illustrer le paradoxe d'une Genève censée froide qui défend finalement avec ténacité l'œuvre de son concitoyen et la fait passer à la postérité...
les écoles. Je résume. On montre un peu les positions. Celle de Luc Weibel était la plus érudite et la plus au-dessus du panier: un passage dans Amiel, par exemple, pour illustrer le paradoxe d'une Genève censée froide qui défend finalement avec ténacité l'œuvre de son concitoyen et la fait passer à la postérité...