Roberto Bolaño, 2666
Par Alain Bagnoud

2666 est-il terminé ? Impossible de le dire. 1300 pages en folio, un texte aux ambitions globalisantes, une leçon romanesque et cette question : que serait devenu le livre si Bolaño avait vécu un peu plus?
Roberto Bolaño, né en 1953 au Chili, est mort en 2003 en Espagne après une vie de voyages, ou d'errance, c'est selon. En beatnik asumé, il a exercé des quantités de petits travaux (gardien de camping, plongeur, etc.), a considéré la poésie comme un exercice frénétique, a créé son propre mythe, qu'il a notamment mis en scène dans Les Détectives sauvages, où il se portraiture sous le nom de Belano.
C'est à 38 ans qu'il a décidé d'écrire des romans. Pour des questions financières. La poésie paie beaucoup moins et Bolaño avait désormais un enfant à charge. Ont suivi plusieurs livres. (Amuleto, Étoile distante, Nocturne du Chili, La Littérature nazie en Amérique Des putains meurtrières, Anvers, Appels téléphoniques, Le Gaucho insupportable, Monsieur Pain, etc.) Enfin, 2666.
Le roman parle de violence et de mal. Son centre géographique se trouve dans la ville de Santa Teresa, calquée sur Ciudad Juarez, où des centaines d'assassinats de femmes sont commis depuis des années, impunément. Le texte se compose de cinq parties.
Quatre universitaires férus d'Archimboldi, un grand romancier allemand qui s'est fait invisible, se retrouvent au gré de colloques, se lient, s'aiment, forment un ménage à trois, se séparent, et plusieurs d'entre eux se retrouvent à Santa Teresa où Archimboldi a été signalé.
Un autre universitaire basé, lui, à Santa Teresa, occupe la deuxième partie du livre. Il se souvient de sa femme folle, observe sa fille ravissante et sa vie qui s'effiloche.
On s'attache ensuite à un journaliste noir qui vient commenter un match de boxe dans la ville. Il rencontre la fille de l'universitaire et la tire des mains des narcos.
La quatrième partie parle des crimes. Bolano y décrit les cadavres de femmes retrouvés, meurtres pour la plupart non élucidés, et évoque des enquêtes dont la plupart n'ont pas abouti.
La cinquième, enfin, décrit la vie d'Archimboldi. L'écrivain allemand, qui a été pris dans la deuxième guerre mondiale, a disparu ensuite, un peu à la manière d'un Thomas Pynchon. Finalement, on apprend qu'il est effectivement parti pour Santa Teresa, afin d'assister son neveu accusé d'être le tueur en série responsable des crimes.
 En rédigeant le livre, Bolaño craignait que sa mort ne soit proche. Son foie était défaillant. Il était en attente de greffe. Son souhait était que les cinq parties de 2666 soient publiées séparément, l'une après l'autre, chaque année. Pour des motifs pécuniaires.
En rédigeant le livre, Bolaño craignait que sa mort ne soit proche. Son foie était défaillant. Il était en attente de greffe. Son souhait était que les cinq parties de 2666 soient publiées séparément, l'une après l'autre, chaque année. Pour des motifs pécuniaires.
Il pensait ainsi assurer mieux l'avenir de ses enfants. On lui a désobéi. On a bien fait sans doute. Si les histoires peuvent se lire séparément, l'ensemble fait résonner des thèmes, produit du sens.
Roberto Bolaño disait qu'il y avait un centre caché dans son livre. Ce n'est peut-être pas une histoire mais un sentiment, un mélange de sentiments, une appréhension de l'univers : terreur, crainte, vitalité, gaspillage, beauté, cruauté, puissance anarchique et profuse de la vie, croissance et absurdité, présence continuelle de la mort et du mal, nécessité du changement.
Tout ceci est peut-être suggéré par le titre, étrange, mystérieux.
Dans les Détectives sauvages, Bolaño parle d'une révolution qui aura lieu dans les années 2600. Quant à 666, c'est un chiffre connu des lecteur de l'Apocalypse de Saint Jean. Le nombre de la Bête.
Roberto Bolaño, 2666, Folio




 Larsen
Larsen Après lecture malheureusement tardive, mais attentive de votre billet «Le vrai Prométhée...», paru dans Le Matin dimanche du 3 février 2013, nous nous devons, en tant que professeurs au Collège Calvin, de réagir pour vous exprimer notre étonnement et notre agacement.
Après lecture malheureusement tardive, mais attentive de votre billet «Le vrai Prométhée...», paru dans Le Matin dimanche du 3 février 2013, nous nous devons, en tant que professeurs au Collège Calvin, de réagir pour vous exprimer notre étonnement et notre agacement.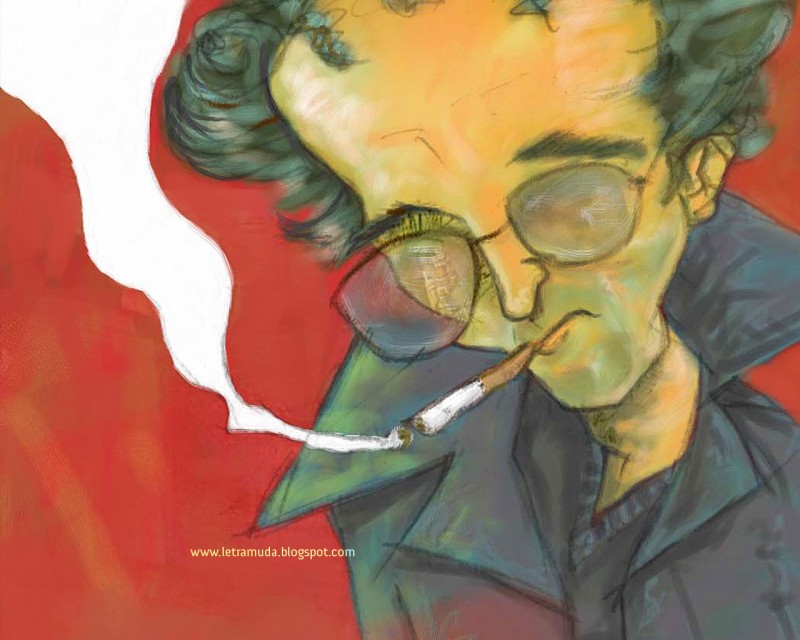

 Jean-Louis Kuffer, critique, écrivain, ancien journaliste de 24Heures, dont le blog (
Jean-Louis Kuffer, critique, écrivain, ancien journaliste de 24Heures, dont le blog ( Venons-en, maintenant, au troisième cas exemplaire. Un lecteur prodigieux (par son érudition), agaçant (par ses partis-pris), à la fois empathique et critique : Charles Dantzig (né à Tarbes, en 1961). Il n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'on lui doit, déjà, un formidable Dictionnaire égoïste de la littérature française (Le Livre de Poche), ainsi que divers opuscules tels que Pourquoi lire ? (Le Livre de Poche) et Encyclopédie capricieuse du tout et du rien (Le LIvre de Poche). Cette année, il publie À propos des chefs-d'œuvre*, une réflexion à la fois personnelle et universelle sur ce qui fait la paricularité des grandes œuvres d'art (Dantzig élargit sa réflexion à la peinture, à la danse, à la musique).
Venons-en, maintenant, au troisième cas exemplaire. Un lecteur prodigieux (par son érudition), agaçant (par ses partis-pris), à la fois empathique et critique : Charles Dantzig (né à Tarbes, en 1961). Il n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'on lui doit, déjà, un formidable Dictionnaire égoïste de la littérature française (Le Livre de Poche), ainsi que divers opuscules tels que Pourquoi lire ? (Le Livre de Poche) et Encyclopédie capricieuse du tout et du rien (Le LIvre de Poche). Cette année, il publie À propos des chefs-d'œuvre*, une réflexion à la fois personnelle et universelle sur ce qui fait la paricularité des grandes œuvres d'art (Dantzig élargit sa réflexion à la peinture, à la danse, à la musique). Il n'aime pas Céline, ironise sur la grandiloquence du style de Marguerite Duras, sur l'ennui des films de Benoît Jacquot, tandis qu'il célèbre Proust ou Genet, Valéry et Cocteau, et certains livres du regretté Hervé Guibert. Dans son panthéon figurent quelques curiosités, tels Sur le retour de Rutilius Namatianus (texte latin datant de 420), La brise au clair de lune, de Ming Jiao Zhong Ren (Chine, fin du XIVe siècle), ou encore les œuvres posthumes de Desportes (1611). Mais aussi Mario Paz, Henri Heine, Gore Vidal, Jules Laforgue.
Il n'aime pas Céline, ironise sur la grandiloquence du style de Marguerite Duras, sur l'ennui des films de Benoît Jacquot, tandis qu'il célèbre Proust ou Genet, Valéry et Cocteau, et certains livres du regretté Hervé Guibert. Dans son panthéon figurent quelques curiosités, tels Sur le retour de Rutilius Namatianus (texte latin datant de 420), La brise au clair de lune, de Ming Jiao Zhong Ren (Chine, fin du XIVe siècle), ou encore les œuvres posthumes de Desportes (1611). Mais aussi Mario Paz, Henri Heine, Gore Vidal, Jules Laforgue. Mes années d’Université se sont déroulées sous l’influence (je devrais dire sous le joug, la tyrannie) des deux Jacques: Derrida et Lacan, élevés au rang de gourous par toute une caste d’étudiants. C’est donc à un détour nostalgique par mon passé que m’a convié la lecture du livre d’Elisabeth Roudinesco, Lacan, envers et contre tout (Seuil, 2011).
Mes années d’Université se sont déroulées sous l’influence (je devrais dire sous le joug, la tyrannie) des deux Jacques: Derrida et Lacan, élevés au rang de gourous par toute une caste d’étudiants. C’est donc à un détour nostalgique par mon passé que m’a convié la lecture du livre d’Elisabeth Roudinesco, Lacan, envers et contre tout (Seuil, 2011).