L'année Rousseau
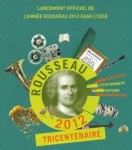 Né à Genève, il y a 300 cents ans, et mort en France, à Ermenonville, en 1778 (avec un passeport prussien !), Jean-Jacques Rousseau aura mené la vie d’un vagabond, tantôt adulé par les grands de ce monde et tantôt pourchassé pour ses idées progressistes. On se souvient que sa bonne ville natale, à l’exemple de Paris, a brûlé deux de ses livres, L’Émile et Le Contrat social, sur la place publique, en 1762. Il a refusé les honneurs et les compromissions. Il s’est battu, sa vie durant, pour son indépendance irréductible. Il a aimé des marquises et des comtesses, mais a passé trente ans avec Thérèse Levasseur, une blanchisseuse qui ne savait ni lire, ni écrire, selon la légende, et qu’il a épousée, lui, l’adversaire farouche des conventions.
Né à Genève, il y a 300 cents ans, et mort en France, à Ermenonville, en 1778 (avec un passeport prussien !), Jean-Jacques Rousseau aura mené la vie d’un vagabond, tantôt adulé par les grands de ce monde et tantôt pourchassé pour ses idées progressistes. On se souvient que sa bonne ville natale, à l’exemple de Paris, a brûlé deux de ses livres, L’Émile et Le Contrat social, sur la place publique, en 1762. Il a refusé les honneurs et les compromissions. Il s’est battu, sa vie durant, pour son indépendance irréductible. Il a aimé des marquises et des comtesses, mais a passé trente ans avec Thérèse Levasseur, une blanchisseuse qui ne savait ni lire, ni écrire, selon la légende, et qu’il a épousée, lui, l’adversaire farouche des conventions.
L’année qui se termine aura été l’année Rousseau. Publications et republications (dont l’œuvre complète en version numérique chez Slatkine). Colloques. Pièces de théâtre. Opéras. Films et téléfilms. N’en jetez plus, la cour est pleine ! Il y aura eu à boire et à manger dans cette frénésie commémorative.  Du bon, et même du très bon, comme le livre de Guillaume Chevevière, Rousseau, une histoire genevoise (Labor et Fides), et la pièce de Dominique Ziegler, Le trip Rousseau.
Du bon, et même du très bon, comme le livre de Guillaume Chevevière, Rousseau, une histoire genevoise (Labor et Fides), et la pièce de Dominique Ziegler, Le trip Rousseau.  Un opéra plutôt moyen : JJR (Citoyen de Genève). Une série de courts métrages : La faute à Rousseau, où le meilleur côtoyait très souvent le pire. Mais Rousseau n’était-il pas l’adversaire acharné du spectacle ?
Un opéra plutôt moyen : JJR (Citoyen de Genève). Une série de courts métrages : La faute à Rousseau, où le meilleur côtoyait très souvent le pire. Mais Rousseau n’était-il pas l’adversaire acharné du spectacle ?
Moi qui ai eu la chance de parler de Rousseau à New York, à Paris et en Californie, j’ai pu me rendre compte de l’extraordinaire actualité de sa pensée, qu’elle soit politique (elle a influencé le mouvement Occupy Wall Street et celui des Indignés), pédagogique (on lit encore L’Émile dans tous les instituts de formation des maîtres), musicale ou botanique (on considère Jean-Jacques comme le précurseur de l’écologie). Sans parler, bien sûr, de son influence littéraire. Son roman épistolaire, La Nouvelle Héloïse, a fait pleurer des générations de lectrices. Et les Confessions, chef-d’œuvre d’introspection rusée, a montré la voie à ce qu’on appelle aujourd’hui l’autofiction, représentée par Annie Ernaux, Delphine de Vigan ou Christine Angot.
 Cette année aura été également celle de Jean Starobinski, écrivain et critique genevois qui vient de fêter ses 92 ans et de publier, coup sur coup, trois livres extraordinaires. L’un sur Rousseau*, le deuxième sur Diderot** et le dernier sur l’histoire de la mélancolie***. Que serait Jean-Jacques sans Staro, comme l’appelaient ses étudiants ? Le professeur genevois a contribué, comme nul autre, à faire (mieux) connaître, la pensée de Rousseau : l’importance du regard dans son œuvre, son désir constant de transparence, ses ruses pour séduire ses contemporains tout en les accusant, son tempérament mélancolique.
Cette année aura été également celle de Jean Starobinski, écrivain et critique genevois qui vient de fêter ses 92 ans et de publier, coup sur coup, trois livres extraordinaires. L’un sur Rousseau*, le deuxième sur Diderot** et le dernier sur l’histoire de la mélancolie***. Que serait Jean-Jacques sans Staro, comme l’appelaient ses étudiants ? Le professeur genevois a contribué, comme nul autre, à faire (mieux) connaître, la pensée de Rousseau : l’importance du regard dans son œuvre, son désir constant de transparence, ses ruses pour séduire ses contemporains tout en les accusant, son tempérament mélancolique.
Oui, il faut relire Rousseau, tous les jours, comme Starobinski nous le conseille : c’est une mine, un trésor d’humanité, de liberté et de poésie.
* Jean Starobinski, Accuser et séduire, Gallimard, 2012.
** Jean Starobinski, Diderot, un diable de ramage, Gallimard, 2012.
*** Jean Starobinski, L’Encre de la mélancolie, Le Seuil, 2012.


 Les peuples heureux n'ont pas d'histoire, dit-on. C'est le cas de la Suisse, dont l'histoire est secrète, pour ne pas faire trop d'envieux. C'est le cas, également, de la Belgique, petit pays de 9 millions d'habitants, coincé entre la France, l'Allemagne et les Pays-Bas, dont on sait peu de choses, finalement. Grâce à Patrick Roegiers — écrivain, journaliste, spécialiste de photographie — cela risque bien de changer…
Les peuples heureux n'ont pas d'histoire, dit-on. C'est le cas de la Suisse, dont l'histoire est secrète, pour ne pas faire trop d'envieux. C'est le cas, également, de la Belgique, petit pays de 9 millions d'habitants, coincé entre la France, l'Allemagne et les Pays-Bas, dont on sait peu de choses, finalement. Grâce à Patrick Roegiers — écrivain, journaliste, spécialiste de photographie — cela risque bien de changer… Ainsi a-t-il pour guide Victor Hugo qui l'accompagne sur la morne plaine de Waterloo et refait, pour lui, la sanglante bataille. Quelle faconde ! Puis il rencontre le grand Jacques Brel, qui a donné ses lettres de noblesse au « plat pays », comme la Malibran lui a donné naissance.
Ainsi a-t-il pour guide Victor Hugo qui l'accompagne sur la morne plaine de Waterloo et refait, pour lui, la sanglante bataille. Quelle faconde ! Puis il rencontre le grand Jacques Brel, qui a donné ses lettres de noblesse au « plat pays », comme la Malibran lui a donné naissance.  Quelle puissance !
Quelle puissance !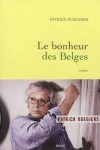 Rien à dire : la Belgique est un grand pays. Elle a donné des myriades d'artistes et de sportifs, des chanteurs, des peintres, des architectes, des écrivains. Roegiers les fait revivre dans une langue éblouissante, jouant sur tous les styles et les registres (théâtre, poème, récit épique). Plus qu'un éloge de la Belgique, son roman est une ode à la langue — à toutes les langues, puisqu'ici le français se mélange souvent au flamand, à l'anglais, à l'allemand.
Rien à dire : la Belgique est un grand pays. Elle a donné des myriades d'artistes et de sportifs, des chanteurs, des peintres, des architectes, des écrivains. Roegiers les fait revivre dans une langue éblouissante, jouant sur tous les styles et les registres (théâtre, poème, récit épique). Plus qu'un éloge de la Belgique, son roman est une ode à la langue — à toutes les langues, puisqu'ici le français se mélange souvent au flamand, à l'anglais, à l'allemand.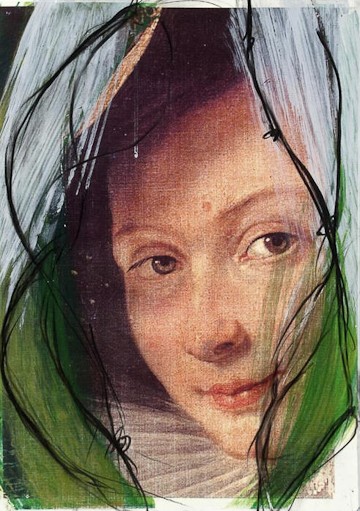
 4 4 3 3. C'est le titre énigmatique de ce recueil publié au
4 4 3 3. C'est le titre énigmatique de ce recueil publié au  Il y a les avant-gardistes facétieux, comme Ramiro Chiriotti, dans un poème librement inspiré de Barbara, de Jacques Prévert, et qu'on peut chercher à décrypter (« 25/8 ' 25/9 32/4 2/ 2/8, / 31/1 31/2, 31/1 33/3, 1/3 » etc.)
Il y a les avant-gardistes facétieux, comme Ramiro Chiriotti, dans un poème librement inspiré de Barbara, de Jacques Prévert, et qu'on peut chercher à décrypter (« 25/8 ' 25/9 32/4 2/ 2/8, / 31/1 31/2, 31/1 33/3, 1/3 » etc.) Il y a longtemps, dans l’autre siècle, mais c’était hier, je musardais dans une librairie de Genève. J’étais jeune étudiant. J’avais des maîtres prestigieux : Jean Starobinski, Michel Butor, Georges Steiner. À l’Université, il n’y avait de bonne littérature que française. Ramuz mis à part, l’on ne connaissait pas un seul nom d’écrivain romand. « La honte ! » dirait ma fille.
Il y a longtemps, dans l’autre siècle, mais c’était hier, je musardais dans une librairie de Genève. J’étais jeune étudiant. J’avais des maîtres prestigieux : Jean Starobinski, Michel Butor, Georges Steiner. À l’Université, il n’y avait de bonne littérature que française. Ramuz mis à part, l’on ne connaissait pas un seul nom d’écrivain romand. « La honte ! » dirait ma fille. Il est allé chercher dans les rayons un roman d’Étienne Barillier, un autre de Gaston Cherpillod et de Nicolas Bouvier et, finalement, un livre intitulé Un Hiver en Arvèche*
Il est allé chercher dans les rayons un roman d’Étienne Barillier, un autre de Gaston Cherpillod et de Nicolas Bouvier et, finalement, un livre intitulé Un Hiver en Arvèche*

 Son Conseiller d'état à lui a plusieurs casseroles. Une comptabilité douteuse. Un achat de terrain contestable. Une sexualité débordante. Marié avec deux filles, il entretient des relations avec Sonia, maîtresse régulière. On le voit régulièrement au cabaret. Il assiste à des spectacles ou passe des moments en privé avec les hôtesses. Enfin, il fréquente le discret établissement de Madame F. qui lui organise des séances sado-masochistes.
Son Conseiller d'état à lui a plusieurs casseroles. Une comptabilité douteuse. Un achat de terrain contestable. Une sexualité débordante. Marié avec deux filles, il entretient des relations avec Sonia, maîtresse régulière. On le voit régulièrement au cabaret. Il assiste à des spectacles ou passe des moments en privé avec les hôtesses. Enfin, il fréquente le discret établissement de Madame F. qui lui organise des séances sado-masochistes.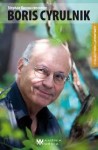 La vie de Boris Cyrulnik est un roman, tragique et édifiant. Longtemps, ce roman est resté prisonnier d'une crypte, enfermé dans les oubliettes de sa mémoire. Il en savait des bribes. Il essayait de mettre bout à bout les images de ce film demeuré trop longtemps muet. Car pour attester un souvenir, surtout lointain et flou, il faut la présence d'un témoin. Sinon, la folie guette à chaque instant…
La vie de Boris Cyrulnik est un roman, tragique et édifiant. Longtemps, ce roman est resté prisonnier d'une crypte, enfermé dans les oubliettes de sa mémoire. Il en savait des bribes. Il essayait de mettre bout à bout les images de ce film demeuré trop longtemps muet. Car pour attester un souvenir, surtout lointain et flou, il faut la présence d'un témoin. Sinon, la folie guette à chaque instant… Sa mère (à droite, avec Boris âgé d'un an) suivra hélas le même chemin sans retour. Il s'en faut de très peu pour que le petit Boris, parqué avec d'autres Juifs dans une synagogue, parte à son tour pour les camps de la mort. Mais il parvient à s'échapper. Une infirmière le cache sous un matelas, sur lequel agonise une jeune femme qu'on transporte à l'hôpital. C'est sa chance. À partir de ce moment-là, la vie de Boris Cyrulnik est une suite de miracles. Ou, si l'on veut, de circonstances heureuses et cependant tragiques. « Mon existence a été charpentée par la guerre. Ai-je vraiment mérité la mort ? Qui suis-je pour avoir pu survivre ? Ai-je trahi pour avoir le droit de vivre ? »
Sa mère (à droite, avec Boris âgé d'un an) suivra hélas le même chemin sans retour. Il s'en faut de très peu pour que le petit Boris, parqué avec d'autres Juifs dans une synagogue, parte à son tour pour les camps de la mort. Mais il parvient à s'échapper. Une infirmière le cache sous un matelas, sur lequel agonise une jeune femme qu'on transporte à l'hôpital. C'est sa chance. À partir de ce moment-là, la vie de Boris Cyrulnik est une suite de miracles. Ou, si l'on veut, de circonstances heureuses et cependant tragiques. « Mon existence a été charpentée par la guerre. Ai-je vraiment mérité la mort ? Qui suis-je pour avoir pu survivre ? Ai-je trahi pour avoir le droit de vivre ? » Rousseau ne fait pas autre chose dans ses Confessions. Il cherche moins à se faire pardonner des fautes vénielles qu'à réenchanter son passé, afin de chercher à comprendre qui il est à présent. « Le mot « représentation » est vraiment celui qui convient. Les souvenirs ne font pas revenir le réel, ils agencent des morceaux de vérité pour en faire une représentation dans notre théâtre intime. Quand nous sommes heureux, nous allons chercher dans notre mémoire quelques fragments de vérité que nous assemblons pour donner cohérence au bien-être que nous ressentons. En cas de malheur, nous irons chercher d'autres mocreaux de vérité qui donneront, eux aussi, une autre cohérence à notre souffrance. »
Rousseau ne fait pas autre chose dans ses Confessions. Il cherche moins à se faire pardonner des fautes vénielles qu'à réenchanter son passé, afin de chercher à comprendre qui il est à présent. « Le mot « représentation » est vraiment celui qui convient. Les souvenirs ne font pas revenir le réel, ils agencent des morceaux de vérité pour en faire une représentation dans notre théâtre intime. Quand nous sommes heureux, nous allons chercher dans notre mémoire quelques fragments de vérité que nous assemblons pour donner cohérence au bien-être que nous ressentons. En cas de malheur, nous irons chercher d'autres mocreaux de vérité qui donneront, eux aussi, une autre cohérence à notre souffrance. » On comprend mieux, en lisant l'autobiographie de Boris Cyrulnik, comment et pourquoi il en est venu à forger le concept essentiel de résilience. Sa vie est l'exemple et la preuve de cette capacité extraordinaire de résistance au malheur. Et cette résistance passe par la parole qui nous aide à représenter le malheur, pour mieux le tenir à distance et le neutraliser. Voilà pourquoi, même dans les circonstances les plus tragiques, la vie appelle toujours à se sauver.
On comprend mieux, en lisant l'autobiographie de Boris Cyrulnik, comment et pourquoi il en est venu à forger le concept essentiel de résilience. Sa vie est l'exemple et la preuve de cette capacité extraordinaire de résistance au malheur. Et cette résistance passe par la parole qui nous aide à représenter le malheur, pour mieux le tenir à distance et le neutraliser. Voilà pourquoi, même dans les circonstances les plus tragiques, la vie appelle toujours à se sauver.