Par Pierre Béguin
Dans son Voyage au Congo, André Gide condamne violemment le colonialisme. Dans le même temps, il exerce, en Algérie surtout, un colonialisme intime qui n’a rien à envier en laideur à celui qu’il condamne à raison. Le plus surprenant, c’est qu’à aucun moment il ne semble prendre conscience de cette contradiction: «Pour le bien de l’humanité, j’ai fait mon œuvre, j’ai vécu» dit-il, par la bouche de Thésée, lorsque la mort approche, justifiant ainsi ses actes par leurs effets fécondateurs sur son œuvre, et son œuvre par son apport à l’humanité. Le tour est joué: un écrivain, un artiste, pour autant qu’il accède au statut de génie, est un cas à part qui bénéficie d’une rédemption de ses actes, même les plus vils, parce que son génie, dût-il se nourrir de chair d’enfant, apporte davantage à l’humanité que ses actes les plus atroces pourraient soustraire aux principes de justice et d’égalité. Simple question de contrepoids, de balance. Au fond, Victor Hugo ne dit pas autre chose, même s’il se limite au pur constat. Relisons la fin de Le Poète (in Les Contemplations) portrait du génie et rêverie sur la création artistique et littéraire: «Sinistre, ayant aux mains des lambeaux d’âme humaine,/ De la chair d’Othello, des restes de Mac Beth,/ Dans son œuvre, du drame effrayant alphabet, / Il se repose; ainsi le noir lion des jongles/ S’endort dans l’antre immense avec du sang aux ongles.» La création, lorsqu’elle est le fait du génie, est une lutte titanesque, un combat sanglant aux conséquences parfois monstrueuses. Et le génie, comme le Shakespeare emblématique de Victor Hugo, a parfois, dans la main même qui guide sa plume, du sang aux ongles, rançon nécessaire de son statut. Il faut bien nourrir l’œuvre! Certes, de préférence, comme Prométhée, avec son propre foie et non avec la chair des petites filles, mais…
Ces considérations pourraient-elles expliquer (et non justifier) le concert d’opinions parfois ahurissantes qui ont accompagné l’arrestation par la police suisse du cinéaste Roman Polanski? Si, en l’occurrence, les trompettes de la renommée furent particulièrement mal embouchées, on peut s’étonner de ceux qui crient au scandale contre une action visant à montrer que «le crime pédérastique, aujourd’hui ne paie plus». Ainsi d’Ursula Meier: «Pourquoi un artiste?» Oui, tiens, c’est vrai au fond, pourquoi un artiste même s’il a sodomisé une mineure de 13 ans? Ou de Lionel Baier, cinéaste, qui semble répondre à Ursula: «Ce qu’il y a derrière, c’est une méconnaissance, voire un mépris des milieux culturels de ce pays. Roman Polanski laisse une trace réelle dans l’histoire de ce siècle… » Sous-entendu, une trace qui mérite bien la primauté de son œuvre sur ses actes les plus odieux. Mais la palme revient à Jacques Chessex: «Nous avons trahi Roman Polanski, nous qui sommes une terre d’asile» Je ne sais par pour vous, mais moi, sans tomber dans une morale d’épicier, je reste stupéfait d’apprendre qu’une terre d’asile s’ouvre aussi aux responsables d’actes pédophiles. Et notre auteur de poursuivre: «Je ne dis pas que le génie justifie tout, mais un personnage de qualité universelle et la dignité esthétique de son œuvre sont un contrepoids à une affaire minime.» (sic!) Dans la même logique que Gide et Hugo, nos artistes et écrivains romands (et je ne parle pas des Ministres français) affirment au fond, avec assurance et sans vergogne, l’immunité du génie, la primauté de son œuvre sur ses actes, sa rédemption finale et l’assurance de la grâce divine. Tous ou presque lui délivrent spontanément un brevet d’innocence ou, du moins, des circonstances si atténuantes qu’elles le placent de facto au-dessus de la justice des hommes. Imaginons une seconde ce qu’aurait été la réaction de ces mêmes milieux artistiques si, à la place du célèbre metteur en scène, ce fut un financier venu chercher à la Paradeplatz le prix du plus gros bonus (bon, d’accord, je provoque un peu). Se seraient-ils scandalisés du traquenard tendu? Se seraient-ils indignés de l’incarcération d’une personnalité venue en Suisse pour y être honorée? Auraient-ils été consternés par l’image désastreuse que cette arrestation aurait donnée de leur pays? Auraient-ils déclaré l’exception financière? Ou auraient-ils agité les grands principes républicains d’égalité devant la justice? Selon que vous serez génie ou financier… Bon, disons que Dieu reconnaîtra les siens… pour autant qu’Il s’y retrouve dans certains paradoxes. Comme celui de notre inénarrable Oskar Freysinger qui, à la surprise de tous sauf à celle de sa modeste personne, s’est joint au concert des créatifs bien-pensants en oubliant allègrement que son parti a milité pour l’imprescriptibilité des actes pédophiles. Le monde artistique et politique comme il va…
Quant aux circonstances ignobles de l’arrestation et l’odieuse domesticité des autorités suisses qui se muent en paillasson de la politique financière américaine pour préserver quelques œuvres prédatrices de nos banques et leur sacro-saint secret, pourtant inéluctablement condamné, là je rejoins entièrement certains écrivains, et notamment Jacques Chessex. Mais c’est une autre histoire. Comme celle de l’enfance de Polanski, celle de son juge au comportement pathologique ou celle de sa victime qui a pardonné. Dans l’indignation et la stupeur, ne confondons pas tout! Et surtout, évitons de nous asservir à Saint Polanski comme le fait Berne à un aigle américain qui, lui, confortablement installé dans l’axe du bien, se nourrit abondamment du foie des autres…
 Dimanche 18 octobre, 17 h Jean-Christophe Aeschlimann présentera Ce présent qui revient, (récits, L’Aire, 2007) à La Compagnie des mots, arcade « Au bonheur des mots », 33, rue Vautier, 1227 Carouge. Une bonne occasion de rencontrer cet écrivain, qui est également rédacteur en chef de la revue Coopération.
Dimanche 18 octobre, 17 h Jean-Christophe Aeschlimann présentera Ce présent qui revient, (récits, L’Aire, 2007) à La Compagnie des mots, arcade « Au bonheur des mots », 33, rue Vautier, 1227 Carouge. Une bonne occasion de rencontrer cet écrivain, qui est également rédacteur en chef de la revue Coopération.
![barbey3[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/01/01/216680835.jpg)
 « Plus je connais les hommes, plus j'aime les bêtes. » Gilbert Pingeon pourrait retourner le dicton: « plus j'aime les bêtes, et plus je connais les hommes. »
« Plus je connais les hommes, plus j'aime les bêtes. » Gilbert Pingeon pourrait retourner le dicton: « plus j'aime les bêtes, et plus je connais les hommes. »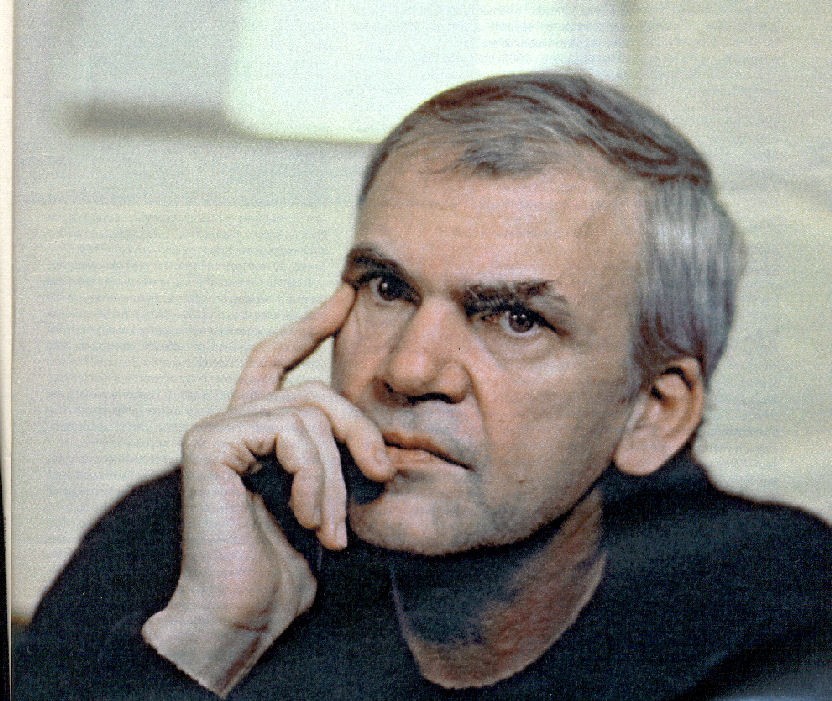
 Tard pour Bar. Programme culturel de la TSR. 24 septembre (voir
Tard pour Bar. Programme culturel de la TSR. 24 septembre (voir  Patricia Mollet-Mercier (photo), en allumeuse nymphomane, qui font parler la poudre et s’excitent l’un l’autre tout en retenant en otage ni plus ni moins que le Président du pays, interprété par Pietro Musillo. Si quelques passages du texte renvoient à certains stéréotypes sur la vanité du pouvoir, il n’empêche que la bande de spectateurs adolescents présents hier soir n’en a pas perdu une miette ; ils étaient bouche bée, tant le jeu du chat et de la souris mis en scène par Jef Saintmartin est vif, inventif et percutant.
Patricia Mollet-Mercier (photo), en allumeuse nymphomane, qui font parler la poudre et s’excitent l’un l’autre tout en retenant en otage ni plus ni moins que le Président du pays, interprété par Pietro Musillo. Si quelques passages du texte renvoient à certains stéréotypes sur la vanité du pouvoir, il n’empêche que la bande de spectateurs adolescents présents hier soir n’en a pas perdu une miette ; ils étaient bouche bée, tant le jeu du chat et de la souris mis en scène par Jef Saintmartin est vif, inventif et percutant.