Par Pierre Béguin
Si la démocratie suisse est l’une des plus anciennes et des plus représentatives au monde, elle repose tout de même sur cet étonnant paradoxe: elle est sûrement la seule démocratie dirigée, à ses différents étages, par des politiciens qui n’ont pas été élus par le peuple. Au niveau fédéral, le peuple n’élit pas les Conseillers fédéraux, c’est constitutionnel. Au niveau cantonal, le peuple n’a pas le choix de ne pas élire les Conseillers d’Etat, c’est implicite et finalement assez vicieux, ledit peuple, sous le couvert d’un acte électoral citoyen, ne faisant en réalité qu’entériner le choix des partis.
Mon bulletin de vote est là, sous mes yeux. Désolé, mais quel liberté me laisse-t-on à part le bouffon de la République dont on comprend l’aigreur mais pas le sens d’un engagement en fin de compte ni comique ni parodique, ou le prophète dont on ne comprend rien? Seul David Hiler s’impose vraiment (et j’ai peur qu’à force d’être plébiscité de partout il n’attrape la grosse tête et n’évolue plus qu’entre mépris et condescendance – c’est un mal qui peut contaminer nos Conseillers dès leur deuxième mandat). Si je n’en vois qu’un qui s’impose, j’en vois surtout beaucoup qui ne s’imposent pas mais que les partis, et leurs petites magouilles pré électorales, vont nous imposer de toute façon. En fait – je vous en fais le pari – ces arrangements – le choix limité des candidats sur les listes de partis – sont tels que si le sadique de Romont lui-même figurait sur la liste de l’entente, il aurait toutes les chances d’être élu. Donc les partis choisissent les candidats, les font élire et réélire, et si ces mêmes partis n’avaient pas fixé une limite à leurs mandats, il est également à parier que tous mourraient grabataires en face des canons ou au café Papon. Ainsi, Laurent Moutinot, dont tout le monde s’accorde à dire qu’il n’a strictement rien fait, a pu passer 12 ans tranquille dans la vieille ville avant que son parti ne l’envoie ailleurs jouir de sa confortable retraite. Comme le chantait Renaud: «‒Maman quand j’serai grand / J’voudrais pas être étudiant / ‒Alors tu s’ras politicien / ‒Ah oui ça j’veux bien!» Il est vrai que les partis peuvent aussi décider de mettre fin prématurément au mandat de leurs représentants si ces derniers échouent à imposer les objectifs qui leur ont été fixés. Un exemple? Philippe Joye. Rapidement placé sur la rampe médiatique, traînant des casseroles telles qu’il reste pieds et poings liés à l’objectif unique pour lequel l’entente l’a fait élire, il a pour mission, en pleine crise qui rend exsangues des entreprises genevoises, d’ouvrir les vannes immobilières que Grobet s’entêtait jusque là à contrôler, plus particulièrmeent de faire passer la traversée de la Rade en votation. Problème: le peuple refuse la traversée. De rage, il est liquidé par ses propres troupes: quelques mois avant les élections – ô coïncidence! – une desdites casseroles sort dans les journaux. Et son parti, et l’entente d’entente, la bouche en cœur, de jouer aux vierges effarouchées trompées «à l’insu de leur plein gré»: «On ne savait pas! On nous aurait menti?» Messieurs, un peu de sérieux! Moi, simple citoyen à l’écart de l’arène politique, je le savais dès le début (les avocats, ça parle!); alors vous qui l’avez choisi!
On me rétorquera que les choix du peuple ne sont pas forcément meilleurs que ceux des partis. C’est exact. Si éliminer par les urnes un candidat proposé par les partis traditionnels constitue déjà en soi un exploit, les Genevois ont fait mieux dans l’histoire des votations cantonales: ils ont réussi à évincer un des meilleurs candidats de ces dernières décennies – Bernard Ziegler – pour le remplacer par un des pires – Gérard Ramseyer – avec des conséquences si désastreuses sur le Département de Justice et Police que le canton en paie encore le prix actuellement. Chapeau bas! Il fallait le faire. Mais la démocratie est ainsi faite que seul le peuple a le droit légitime de se tromper. Et, en l’occurrence, il fut bien aidé par l’entente qui avait sottement décidé de briguer le monopole de l’exécutif… Une magouille historique de connerie!
Il reviendrait donc à la presse de faire contrepoids au pouvoir des partis. Mais quand on croise le soir, au resto, un journaliste – parfois une jeune journaliste toute émoustillée – dînant en tête à tête avec un Conseiller d’Etat comme un couple d’amoureux, on se dit que, pour la distance critique, il faudra attendre. En fait, à Genève, la presse c’est La Tribune. Et notre Julie reste indéfectiblement fidèle à son rôle de paillasson approbateur de la politique genevoise. Voyez les pages Portrait Election par lesquelles le quotidien nous présente les candidats. J’ai sous les yeux celle du 29 octobre avec Charles Beer. Déjà la photo prête à rire. Pose hugolienne, regard tonique vaguement hollywoodien, à la fois conquérant et rassurant, genre père de la patrie, avec, en arrière-fond, le Cycle de Cayla fraîchement rénové. Ne lui manque plus que la truelle, à notre candidat. Et puis le titre! Charles Beer consulte jusqu’à plus soif (ça sent le recyclé après le départ de Cramer). Mais le clou, c’est le texte! On nous dit par exemple que Charles Beer écoute beaucoup… mais on ne nous dit pas qu’il entend peu. Et que nous apprend au fond ce portrait? Que notre chef du DIP affirme avoir obtenu la paix scolaire. Preuve qu’il entend peu. Pour le reste, qu’il aime la brasserie La Chênoise et le Mamco, et qu’il possède «des origines allemandes, des ancêtres artistes, d’autres industriels» en plus «d’un arrière grand-père arménien – figure de l’indépendance – et un grand-père hongrois, juif et laïque». Y a pas à dire, avec un tel pedigree, il ratisse large, notre candidat. Espérons qu’il ne s’aliène pas les votes des Genevois d’origine turc ou de confession musulmane. Surtout, avec des questions pareilles, le candidat a le beau rôle. Franchement Monsieur le journaliste – à moins qu’on ne vous récompense par un poste de secrétaire de département, comme cela s’est vu par le passé (j’ai les noms! j’ai les noms!) – ne pensez-vous pas qu’il y aurait d’autres questions plus pointues à poser sur le bilan de Charles Beer à la tête du DIP? Qu’est-ce qu’on en a à f… d’apprendre qu’un candidat a pour aïeul le vieil homme du Toggenburg ou un guerrier massaï! En quoi cela nous aide-t-il à voter? Pour la promotion des futurs élus, les partis s’en chargent par des tout ménages; inutile de les dupliquer dans la presse! La manipulation médiatique s’accompagne aussi d’une grossière partialité. Je ne souhaite pas – mais alors pas du tout – l’élection d’Eric Stauffer, ce genre de personnage étant d’ailleurs aussi dangereux au pouvoir qu’il peut être utile dans l’opposition. Mais, sincèrement, consacrer presque 4 pages pleines, comme ce fut le cas dans La Tribune du 5 novembre, à fustiger les mensonges du candidat MCG, n’est-ce pas exagéré? S’il fallait consacrer 4 pages à chaque mensonge de politiciens, dont la plupart mente autant qu’Eric Stauffer, nous aurions déboisé l’Amazonie depuis belle lurette. Et si La Tribune devait maintenir le même équilibre pour les mensonges de tous les candidats à l’exécutif, elle atteindrait l’épaisseur d’un annuaire téléphonique.
Que sont nos démocraties devenues? En Suisse, les forces vives qui devraient l’alimenter en ont confisqué l’esprit pour le détourner dans le sens unique de leurs intérêts: le peuple n’élit pas vraiment ses dirigeants, la presse quotidienne ne joue pas son rôle, les lobbies phagocytent le Parlement pour faire passer des lois uniquement favorables au milieu économique, les banques, les assurances ou autres multinationales pharmaceutiques dirigent le pays en sous main, et j’en passe. Ah si pourtant! Je peux m’exprimer librement, écrire ces mots sans risque. Et, pour avoir vécu quelque temps en Colombie où l’acte de parole est loin d’être anodin, je dois admettre que c’est déjà énorme. N’empêche, on pourrait faire mieux à bon compte. Il suffirait, par exemple, que le parti socialiste me donne le choix entre Manuel Tornare et Charles Beer au lieu de faire lui-même ce tri. J’aurais ainsi l’impression d’une certaine liberté de vote, pour relative qu’elle soit. Car il ne fait aucun doute que Charles Beer sera réélu, comme tous ses compères qui rempilent à l’exécutif, même si – et je suis bien placé pour le savoir – rarement un chef du DIP n’aura autant fait l’unanimité contre lui, dans le secondaire du moins (à part peut-être Martine, mais elle, elle était spécialement élue par ceux qui n’enseignaient pas pour emm... ceux qui enseignaient; et il faut bien admettre que ce fut une exceptionnelle réussite).
Evidemment, le risque de cette magouille pré électorale, c’est que le peuple se rebiffe dans les urnes comme il l’a fait pour les législatives. Et opte donc, pour exprimer sa liberté de choix, pour des candidats ne figurant pas sur les listes des partis traditionnels. Qui, eux, n’ont toujours pas compris que, s’ils donnaient vraiment le choix au peuple, ce dernier serait beaucoup plus discipliné au jour J des votations. Pour tout vous dire, moi, au fond, je me demande parfois si je ne souhaiterais pas une surprise le 15 novembre, même si je redoute qu’elle soit mauvaise. Souhait déçu d’avance: le peuple est moins téméraire pour l’exécutif qu’il ne l’est pour le législatif…
Allez! Pour relativiser mes propos et parce qu’on se trouve sur un blog censé parler avant tout littérature, je laisse le mot de la fin, que je m’adresse en priorité, à La Rochefoucault: «Il est plus facile de paraître digne des emplois qu’on n’a pas que de ceux que l’on exerce».

 Le 29 novembre, donc, on votera en Suisse. Je rappelle que des représentants de l'extrême-droite, l'UDC et l'Union démocratique fédérale (UDF), ont lancé une initiative, qui a abouti, pour introduire dans la Constitution une interdiction de construire des minarets.
Le 29 novembre, donc, on votera en Suisse. Je rappelle que des représentants de l'extrême-droite, l'UDC et l'Union démocratique fédérale (UDF), ont lancé une initiative, qui a abouti, pour introduire dans la Constitution une interdiction de construire des minarets.
![loup2[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/02/02/1213377321.jpg) Une anecdote représentative des dérives «pédagogistes» actuelles – disons plutôt de l’opportunisme politique, exacerbé en ces temps d’élections, conjugué à la peur aussi pathologique que pathétique du DIP devant les exigences des parents – commençait à circuler dans les salles des maîtres des collèges. Une anecdote qui versait dans la caricature et dans le comique, au-delà de ce qu’elle désignait d’une manière de délabrement que subit peu à peu l’Institution. Au point que je m’en emparai aussitôt pour en faire un billet à publier dans «blogres». Il aurait dû être celui du 18 octobre. Il aurait dû… Car, par prudence et respect pour la «source» de cette anecdote, je lui ai soumis le texte au préalable, un texte d’où noms, références et détails avaient été évidemment caviardés, et qui ne comportait au fond rien de bien méchant (il a été publié dans ce même blog des billets bien plus pointus et polémiques sur le sujet). A ma grande surprise, l’enseignant refusa net, terrorisé par les possibles mesures de rétorsions qu’on pourrait lui faire subir.
Une anecdote représentative des dérives «pédagogistes» actuelles – disons plutôt de l’opportunisme politique, exacerbé en ces temps d’élections, conjugué à la peur aussi pathologique que pathétique du DIP devant les exigences des parents – commençait à circuler dans les salles des maîtres des collèges. Une anecdote qui versait dans la caricature et dans le comique, au-delà de ce qu’elle désignait d’une manière de délabrement que subit peu à peu l’Institution. Au point que je m’en emparai aussitôt pour en faire un billet à publier dans «blogres». Il aurait dû être celui du 18 octobre. Il aurait dû… Car, par prudence et respect pour la «source» de cette anecdote, je lui ai soumis le texte au préalable, un texte d’où noms, références et détails avaient été évidemment caviardés, et qui ne comportait au fond rien de bien méchant (il a été publié dans ce même blog des billets bien plus pointus et polémiques sur le sujet). A ma grande surprise, l’enseignant refusa net, terrorisé par les possibles mesures de rétorsions qu’on pourrait lui faire subir.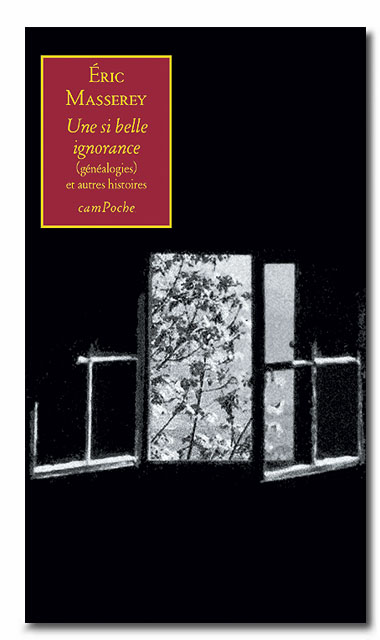 Les rentrées littéraires ont ceci de plaisant qu'elles nous offrent toutes sortes de productions d'amis dont il est agréable de parler. Vous vous en êtes aperçu, d'ailleurs, si vous lisez régulièrement ce blog.
Les rentrées littéraires ont ceci de plaisant qu'elles nous offrent toutes sortes de productions d'amis dont il est agréable de parler. Vous vous en êtes aperçu, d'ailleurs, si vous lisez régulièrement ce blog.

 rt dans le débat dont je parlais ci-dessus.
rt dans le débat dont je parlais ci-dessus. liés aux événements de la vie publique, Delaloye y trouve un terreau pour l'historien qu'il est. Il nous parle de ses auteurs fondamentaux, Ernest Jünger, Günter Grass, André Malraux, Robert Walser surtout, avec un goût et une saveur qui nous donnent précisément envie de nous ruer sur leurs œuvres. Tout ceci servi par une grande culture historique et littéraire, des mises en relation avec les époques... Palpitant, on vous dit.
liés aux événements de la vie publique, Delaloye y trouve un terreau pour l'historien qu'il est. Il nous parle de ses auteurs fondamentaux, Ernest Jünger, Günter Grass, André Malraux, Robert Walser surtout, avec un goût et une saveur qui nous donnent précisément envie de nous ruer sur leurs œuvres. Tout ceci servi par une grande culture historique et littéraire, des mises en relation avec les époques... Palpitant, on vous dit.