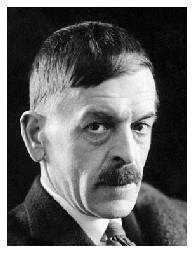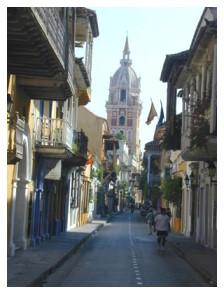Par Pierre Béguin Il n’a pas même 5 ans. Il joue dans notre jardin avec nos filles et deux autres enfants. Hier soir, il a dit adieu à son père.
Maintenant, courant et riant, il pousse le garçon sur un tricycle. Ils font le tour de la terrasse avant d’inverser les rôles et de recommencer.
Sait-il pourquoi il se trouve chez nous? Pourquoi ses parents ne l’ont pas accompagné?
Maintenant, ils sont tous les cinq sous la pergola en train d’entasser des coquilles d’escargots qui ont mal résisté à l’hiver. Lui vérifie avec une tige si l’escargot est toujours à l’intérieur.
Se rend-il compte qu’il vit un moment déterminant de son existence?
Maintenant, ils sont assis à leur petite table en train de manger des pâtes. «On mange parce que sinon on va pas grandir» s’écrie-t-il d’une voix enjouée quand on lui demande si ça va.
Réalise-t-il que son père va mourir tout à l’heure, à l’hôpital, d’une maladie incurable?
Plus tard, nous irons au carrousel. Au lancer de balles, il gagnera une baleine bleue en peluche dont il ne voudra plus se séparer. C’est à peine si l’on distinguera un voile de tristesse dans son regard.
A cet instant, son père sera mort…
Moi, la gorge nouée, les yeux mouillés, je le regarde s’amuser. Et je pense à mes parents, à mes amis qui ne sont plus, à «Tous ceux enfin dont la vie, / Un jour ou l’autre ravie, / Emporte une part de nous» (Lamartine, Pensées des morts). Je pense surtout à notre fils disparu prématurément. 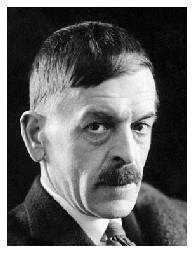 Et aussi à ces mots de Ramuz à sa fille qui m’avaient accompagné dans l’épreuve: «Et quand, parmi tout cela, bien avant tout cela peut-être, la conscience de cette autre mort, celle d’après, interviendra, ce sera le grand vertige devant ce sort, qui est le nôtre, d’avoir à peine commencé qu’on sait déjà qu’on doit finir. Mais moi, te prenant alors sur mes genoux, je te raconterai cette autre mort d’avant et tu seras consolée. Je te dirai: «C’est à cause que tout doit finir que tout est si beau. C’est à cause que tout doit avoir une fin que tout commence. C’est à cause que tout commence que tu as connu le grand émerveillement. Tâche seulement d’être toujours émerveillée. Découvre toujours quelque chose comme en ces premiers jours où tu découvrais tout. Garde ces poings fermés dans l’effort joyeux et dans le courage et le sourire qu’il faut aussi dans le courage. Il y aura toujours les belles fleurs des rideaux et toujours les belles fenêtres. Fais qu’elles s’ouvrent seulement plus nombreuses et que la lumière dedans aille seulement croissant en clarté. Et puis, un jour, l’amour viendra, ce nouvel amour, et tous les amours. Et ainsi tu iras distinguant mieux, sans cesse, sans cesse plus de choses. C’est ainsi que peu à peu la fatigue se fera sentir; tu quitteras le sommet de la courbe, on te remettra au berceau. Mais que ce soit dans la douceur des grandes choses consenties et dans le respect de la symétrie, quand les lointains s’éloigneront, au lieu qu’ils s’avançaient alors, et la lumière s’assombrira: naissance de nouveau, naissance en sens contraire, cercle qu’on referme, retour, mais avec ce même beau calme devant ce qui décroît, s’étant accru par une loi semblable: ainsi on voit sur l’horizon la plus haute de ces montagnes naître insensiblement de la plaine et y redescendre insensiblement.» (C.F. Ramuz, Symétrie, in Adieu à beaucoup de personnages)
Et aussi à ces mots de Ramuz à sa fille qui m’avaient accompagné dans l’épreuve: «Et quand, parmi tout cela, bien avant tout cela peut-être, la conscience de cette autre mort, celle d’après, interviendra, ce sera le grand vertige devant ce sort, qui est le nôtre, d’avoir à peine commencé qu’on sait déjà qu’on doit finir. Mais moi, te prenant alors sur mes genoux, je te raconterai cette autre mort d’avant et tu seras consolée. Je te dirai: «C’est à cause que tout doit finir que tout est si beau. C’est à cause que tout doit avoir une fin que tout commence. C’est à cause que tout commence que tu as connu le grand émerveillement. Tâche seulement d’être toujours émerveillée. Découvre toujours quelque chose comme en ces premiers jours où tu découvrais tout. Garde ces poings fermés dans l’effort joyeux et dans le courage et le sourire qu’il faut aussi dans le courage. Il y aura toujours les belles fleurs des rideaux et toujours les belles fenêtres. Fais qu’elles s’ouvrent seulement plus nombreuses et que la lumière dedans aille seulement croissant en clarté. Et puis, un jour, l’amour viendra, ce nouvel amour, et tous les amours. Et ainsi tu iras distinguant mieux, sans cesse, sans cesse plus de choses. C’est ainsi que peu à peu la fatigue se fera sentir; tu quitteras le sommet de la courbe, on te remettra au berceau. Mais que ce soit dans la douceur des grandes choses consenties et dans le respect de la symétrie, quand les lointains s’éloigneront, au lieu qu’ils s’avançaient alors, et la lumière s’assombrira: naissance de nouveau, naissance en sens contraire, cercle qu’on referme, retour, mais avec ce même beau calme devant ce qui décroît, s’étant accru par une loi semblable: ainsi on voit sur l’horizon la plus haute de ces montagnes naître insensiblement de la plaine et y redescendre insensiblement.» (C.F. Ramuz, Symétrie, in Adieu à beaucoup de personnages)