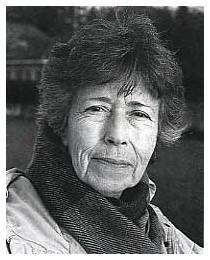La baise et les impôts
par Pascal Rebetez
Lundi dernier, en première page de la Tribune, l’œil égrillard du lecteur matinal a pu apprécier, avec quelques longueurs d’avance sur sa déclaration fiscale pisseuse et ses croissants baveux, l’énormité provocatrice et la vanité sexuelle de François Longchamp, notre chef du Département de la solidarité et de l'emploi, qui se déclare, je cite le malheureux secrétaire de rédaction de la Julie : « pour les baises d’impôts ». C’est ce qu’on appelle en langage d’imprimerie, une coquille. Il faut donc comprendre qu’en baisant les impôts à tout bout de Longchamp, on ne risque pas grand chose, à condition de se protéger avec d’encore plus lumineuses et sexuellement non transmissibles coquilles.
C’est curieux, ce « baiser », geste d’amour à l’origine, signe de déférence et de tendresse qui est devenu transitivement l’équivalent de niquer, porter atteinte, tromper, piéger, vaincre, voler et même violer. Il en est de l’évolution du lexique comme celle des contributions publiques : à force de tendre sa sébile à tout va, l’Etat tourne autour du pot et ne récolte tout au plus que des fifrelins et autres boutons de culotte. Il rompt alors le pacte de la donation volontaire pour imposer le don : l’impôt, c’est ce qui est imposé. D’aucuns, les plus malins de la tablée sont les spécialistes du baiser de Judas : ils vont poser ailleurs leur authentique tendresse et leur jolie fortune. Les autres, les moyens, les distraits, les salariés paient. Ils paient pour voir baisser mais n’en jouissent que fort peu. La coquille alors est vide et les omelettes sans œufs. Est-ce la foule qui fait le bœuf ou le bœuf qui fait la poule ? etc.

 Gilda, l’héroïne du livre, s’est fait quitter par
Gilda, l’héroïne du livre, s’est fait quitter par Comment lire Jean-Marc Lovay ? De diverses méthodes que j’ai éprouvées, il ressort que ce qui fonctionne le mieux, c’est de se laisser porter. Comme si on descendait un fleuve à son rythme à lui.
Comment lire Jean-Marc Lovay ? De diverses méthodes que j’ai éprouvées, il ressort que ce qui fonctionne le mieux, c’est de se laisser porter. Comme si on descendait un fleuve à son rythme à lui.