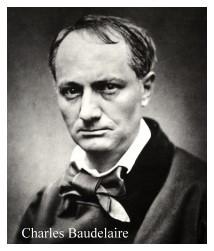Par Alain Bagnoud
 Le Petit Ouvrage Inachevé est un texte court, vif et polisson, dans lequel Léautaud voulait tout dire sur l’amour.
Le Petit Ouvrage Inachevé est un texte court, vif et polisson, dans lequel Léautaud voulait tout dire sur l’amour.
Et sur ses maîtresses. Les « elle », les Mme C…, les Mme X…, qui donnent des identités mystérieuses à toute une galerie de femmes.
En fait, sous les initiales et les évocations plurielles, il y a deux dames.
Anne Cayssac, d’abord. Femme mariée avec qui Léautaud entra en contact à cause de leur amour commun des animaux, et qui s’est montrée une maîtresse lubrique et variée, de leurs séances de six à sept dans le bureau de Léautaud au Mercure de France, elle à genoux avec son chapeau sur la tête, jusqu’à la maison de vacances où ils faisaient toutes les polissonneries du monde alors que le mari dormait juste à côté.
Anne Cayssac, les lecteurs de Léautaud la connaissent par d’autres textes. Elle est aussi le « Poison » du Journal. Une emmerdeuse, inconséquente, experte en scènes, en reproches, en récriminations perpétuelles, grincheuse, âcre, pénible, et qui ne se calmait que quand son amant ouvrait sa braguette et sortait ses affaires sur lesquelles elle se jetait.
L’autre femme est Marie Dormoy. Bourgeoise, littéraire, rousse, blanche, sensuelle, dont l’ambition était de dactylographier le Journal de l’écrivain, texte déjà célèbre à l’époque à cause des extraits qui en avaient paru. Marie Dormoy qui le déprend d’Anne Cayssac, le rend à 61 ans (elle en a 45) amoureux, fou de jalousie, avant que cette passion ne s’use.
Ça va vite, dans Le Petit Ouvrage Inachevé. Ça court. Petites scènes enlevées, ellipses, notes rapides, vacheries en passant, réflexions lucides, raccourcis, liens entre les anecdotes, association d’idées... Tout l’art de Léautaud est dans la vivacité.
Emporté par son sujet, il se jette sur le papier, il écrit tellement vite, « d’un trait, sans y revenir que pour des ajoutés » que dans le texte final, publié, on ne compte plus les mots laissés en blanc parce qu’illisibles sur le manuscrit et les phrases inachevées, bancales, que l’auteur n’a pas relues, préférant se laisser emporter par le fil de sa plume.
Le Petit Ouvrage Inachevé a les qualités et les défauts de cette manière de procéder. Les côtés brouillons et mal composés, pas composés du tout en fait, d’un ouvrage fait pendant vingt ans, par à-coups, repris et laissé à de nombreuses reprises. Mais aussi l’éclat, l’abondance de vie, la rapidité, la nervosité, la saveur de certaines formules sous la dent, qui craquent comme les pépites de vrai caramel dans la glace au caramel de Movenpick.
Paul Léautaud, Le Petit Ouvrage Inachevé, Arléa
(Publié aussi dans Le blog d’Alain Bagnoud)

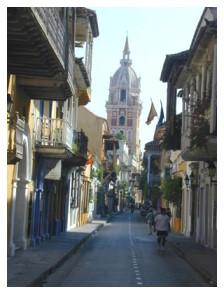
 Le Petit Ouvrage Inachevé est un texte court, vif et polisson, dans lequel Léautaud voulait tout dire sur l’amour.
Le Petit Ouvrage Inachevé est un texte court, vif et polisson, dans lequel Léautaud voulait tout dire sur l’amour.