Par Pierre Béguin
 Dans son fameux roman 1984, Georges Orwell pose ce principe que tout régime totalitaire doit canaliser la colère du peuple en la détournant sur un ennemi désigné. Il imagine alors le rituel des «Deux minutes de la haine». Il s’agit du moment de la journée pendant lequel le visage de l’«ennemi» de l’Ingsoc, un certain Emmanuel Goldstein, est diffusé sur des écrans. Le peuple est alors invité à laisser exploser sa rage contre cet ennemi bien entendu imaginaire, sorte d’épouvantail menaçant créé de toute pièce, un leurre qui, en détournant l’attention, permet à la menace réelle de s’imposer en douceur.
Dans son fameux roman 1984, Georges Orwell pose ce principe que tout régime totalitaire doit canaliser la colère du peuple en la détournant sur un ennemi désigné. Il imagine alors le rituel des «Deux minutes de la haine». Il s’agit du moment de la journée pendant lequel le visage de l’«ennemi» de l’Ingsoc, un certain Emmanuel Goldstein, est diffusé sur des écrans. Le peuple est alors invité à laisser exploser sa rage contre cet ennemi bien entendu imaginaire, sorte d’épouvantail menaçant créé de toute pièce, un leurre qui, en détournant l’attention, permet à la menace réelle de s’imposer en douceur.
Osons cette hypothèse: et si des personnes comme Marine le Pen (ou un Eric Zemmour) en France et Christoph Blocher (ou un Oskar Freysinger) en Suisse – il y en a dans chaque pays – étaient devenues, au même titre que la Russie, les Emmanuel Goldstein des régimes occidentaux? Des régimes où la démocratie – qui peut encore nier cette évidence? – se voit petit à petit vidée de toute sa substance par le totalitarisme financier, certes plus soft pour la majorité d’entre nous (pour combien de temps encore?) mais diablement plus efficace. Peut-être suis-je naïf, mais je peine à voir dans ces figures diabolisées la menace extrémiste qu’il faut juguler en priorité. Et je reste sans voix lorsque des personnes semble-t-il intelligentes, à l’énoncé d’un argument de bon sens ou d’une vérité incontournable, se dressent sur leurs ergots au motif que cet argument, ou cette vérité, fait le jeu de l’UDC (ou du FN). Comme l’écrivait déjà Georges Orwell: «L’argument selon lequel il ne faudrait pas dire certaines vérités car cela ”ferait le jeu de” telle ou telle force sinistre est malhonnête en ce sens que les gens n’y ont recours que lorsque cela leur convient personnellement. Sous-jacent à cet argument, se retrouve habituellement le désir de faire de la propagande pour quelques intérêts partisans et de museler les critiques en les accusant d’être objectivement réactionnaires». Au fond, Elisabeth Badinter ne dit pas autre chose: «On ferme le bec de toute discussion sur l’Islam avec la condamnation absolue que personne ne supporte: ”Vous êtes raciste ou vous êtes islamophobe, taisez-vous!”» Sauf qu’elle aurait pu ajouter que l’Islam n’est pas seul en cause: pour le meilleur ou pour le pire, le sionisme, le féminisme (aïe! je sens que ça va être ma fête), le panlibéralisme, et bien d’autres «ismes» se développent sur les mêmes ressorts. Au pays de Voltaire, il est impossible d’émettre la moindre critique sur certains «ismes» sans être accusé d’amalgamer, de stigmatiser, d’essentialiser des populations, ou sans être taxé de «iste» (machiste, raciste, fasciste, etc.) ou de «phobe» (homophobe, islamophobe, etc.) en tout genre. Au bout du compte, l’accusé, qui ne s’y reconnaît pas, préfère aller cultiver son jardin. Une démission en forme de pain bénit pour certains contempteurs. En réalité, sous couvert de respect des libertés et des droits, d’humanisme, de tolérance, de politiquement correct, c’est une vision antagoniste qui étend sa domination et fait son lit dans nos propres valeurs. La novlangue et sa chasse aux sorcières lexicales, en proscrivant, détournant, rebaptisant bon nombre de mots, participe activement de cette subversion. Dans 1984, c’est précisément ce que dit Syme à Winston: «Ne voyez-vous pas que le véritable but du novlangue est de restreindre les limites de la pensée? A la fin nous rendrons littéralement impossible le crime par la pensée car il n’y aura plus de mots pour l’exprimer». Le raffinement de l’efficacité totalitaire ne consiste pas à interdire quelque chose mais à organiser les conditions pour que cette chose n’existe pas…
Si le fascisme est un régime fondé sur la dictature d’un parti unique, l’exaltation nationaliste et le corporatisme, il est indéniable que les thèses des partis dits d’extrême droite s’en font l’écho. Mais dans le monde actuel, plus sophistiqué, acquis à la globalisation, soumis au totalitarisme de la finance, à la gouvernance supranationale d’une élite intellectuelle, de multinationales et de banquiers mondiaux, ces thèses, pour une majorité de citoyens qui y souscrivent, constituent aussi un retour à l’autodétermination des peuples pratiquée dans les siècles passés, une sorte d’aspiration à remettre quelques règles (fussent des frontières) dans cette course effrénée à la déréglementation et au libre échangisme qui paupérisent toujours plus des pans entiers de la société. Une manière aussi de s’opposer à ces mots terribles de David Rockfeller écrits dans Newsweek en 1999, des mots qui sonnent comme un manifeste du néolibéralisme et une véritable définition du fascisme moderne incarné par la finance et les multinationales: «Quelque chose doit remplacer les gouvernements, et le pouvoir privé me semble l’identité adéquate pour le faire». Alors oui, je l’avoue, à côté du pouvoir Goldman Sachs, des multinationales, des David Rockfeller et de l’ubérisation du globe qui dresse sans règle tout le monde contre tout le monde, Christoph Blocher et Marine le Pen me semblent bien inoffensifs, et leur insistance à rétablir des frontières, à revenir au pouvoir national, en ferait presque des Guillaume Tell en lutte contre la domination Habsbourg, ou des Vercingetorix contre l’Empire romain. Pour le moins des Emmanuel Goldstein que la gouvernance mondiale désignerait à la vindicte populaire comme la menace ultime. Populisme contre ploutocratie. Régionalisme contre globalisation. Le combat séculaire! Et tant pis pour les dinosaures qui croient encore au clivage gauche-droite!
Sauf que la «populace» a plus de bon sens que ne le pensent les David Rockfeller. Le Brexit et l’échec d’Hillary Clinton en sont deux preuves récentes. Les collusions entre les clintoniens et Wall Street pour favoriser le secteur financier – avec les ravages que l’on sait sur la classe moyenne – furent telles qu’une partie de la presse, même sous la tutelle financière, a dénoncé ce «gouvernement Goldman Sachs». Tout, même un Trump qui promet le retour aux frontières et aux règles de la Nation, oui, tout mais pas ça! Qu’un milliardaire excentrique, qu’une Marine le Pen – dans son programme du moins plus Gaulliste que n’importe quel Républicain –, qu’un Christoph Blocher puissent s’incarner en défenseurs des droits démocratiques ne soulignent pas uniquement le degré de détestation du corps électoral pour une classe politique dominante qui ne cesse de le trahir, mais nous donnent aussi une idée du système dans lequel trente-cinq ans de néolibéralisme globalisé nous ont fait entrer. Et ce n’est qu’un début: la pente est maintenant si forte qu’elle imprime, je le crains, un mouvement irréversible. Personnellement, je serais surpris que le Donald finisse son mandat: le pouvoir de ceux qu’il a battus – et qu’il n’aurait pas dû battre – est bien plus étendu que les milliards (et les scandales) qui ont fait sa renommée. La chasse au canard a d’ailleurs déjà commencé…
Mon premier billet de l’année 2016 dans Blogres s’intitulait «Bienvenue dans le futur». Il y était question de la légalisation du Bail-in et il se concluait par ces lignes: «Les financiers préparent la suppression des billets et de la monnaie pour rendre l’argent purement virtuel. Adieu coffre, cachette, bas de laine et fric au noir! Et le E banking, à quoi croyez-vous que ça sert si ce n’est à nous rendre dépendant des banques? La révolution FINTECH (contraction de finance et technologie) n’a pas fini de surprendre… en mal. En résumé, nous serons complètement sous le joug d’établissements bancaires qui se sont déjà légalement approprié notre argent bientôt géré par des robots. Alors nos «sequins», aussi planqués soient-ils, n’auront pas plus de valeur qu’un rouge liard, si ce n’est en tant qu’objet de collection. 2016, sans tambours ni trompettes, dans l’indifférence la plus complète, marque l’avènement d’une ère nouvelle: dorénavant, plus personne n’est propriétaire de son épargne et des économies légitimement mises de côté après une vie de labeur. Finie l’indépendance, la liberté qu’octroie l’épargne à son détenteur! Avec la bénédiction de l’Etat, sous couvert de légalité, la dictature financière avance ses derniers pions. Elle sera bientôt totale... Avec tous les moyens de surveillance dont le citoyen est déjà l’objet à son insu, le tableau est complet. Orwell, à côté, c’est de la roupie de sansonnet».
Pour 2017, je monte d’un cran: «Bienvenue dans le pire des mondes!», un titre que j’emprunte au dernier livre de Natacha Polony dont je ne saurais trop vous recommander la lecture. Si je ne vous ai pas convaincu, ce livre le fera. A moins que vous n’ayez peur de vous faire peur…
Georges Orwell, 1984, Folio, 1972 (1e publication: 1949)
Natacha Polony, Bienvenue dans le pire des mondes, éd. Plon, 2016









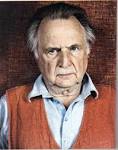






 Dans L’immortalité, Milan Kundera met en scène une rencontre entre Goethe et Hemingway, dialoguant sur les chemins de l’au-delà. Rien, mais absolument rien de commun entre Goethe et Hemingway, me direz-vous! Il faut croire que, dans l’au-delà, Goethe (comme chacun d’entre nous, je suppose) préfère deviser avec d’autres voix que celles – Herder, Höderlin, Bettina – qu’il a entendues sa longue vie durant. Quoi qu’il en soit, comme Hemingway se plaint des innombrables biographies plus ou moins fantasques qu’on lui consacre, Goethe lui répond: «C’est l’immortalité, que voulez-vous. L’immortalité est un éternel procès». Et Hemingway de renchérir: «L’homme peut mettre fin à sa vie. Mais il ne peut mettre fin à son immortalité. Une fois qu’elle vous a pris à bord, vous ne pouvez plus jamais redescendre, et même si vous vous brûlez la cervelle, comme moi, vous restez à bord avec votre suicide, et c’est l’horreur. J’étais mort, couché sur le pont, et autour de moi je voyais mes quatre épouses accroupies, écrivant tout ce qu’elles savaient de moi, et derrière elles était mon fils qui écrivait aussi, et Gertrude Stein était là et écrivait, et tous mes amis étaient là et racontaient tous les cancans, toutes les calomnies qu’ils avaient pu entendre à mon sujet, et dans toutes les universités d’Amérique une armée de professeurs classaient tout cela, l’analysaient, le développaient, fabriquant des milliers d’articles et des centaines de livres…» Des biographies et des cancans, et encore des cancans et des biographies… Mais qui s’intéresse encore aux livres du célèbre romancier américain?
Dans L’immortalité, Milan Kundera met en scène une rencontre entre Goethe et Hemingway, dialoguant sur les chemins de l’au-delà. Rien, mais absolument rien de commun entre Goethe et Hemingway, me direz-vous! Il faut croire que, dans l’au-delà, Goethe (comme chacun d’entre nous, je suppose) préfère deviser avec d’autres voix que celles – Herder, Höderlin, Bettina – qu’il a entendues sa longue vie durant. Quoi qu’il en soit, comme Hemingway se plaint des innombrables biographies plus ou moins fantasques qu’on lui consacre, Goethe lui répond: «C’est l’immortalité, que voulez-vous. L’immortalité est un éternel procès». Et Hemingway de renchérir: «L’homme peut mettre fin à sa vie. Mais il ne peut mettre fin à son immortalité. Une fois qu’elle vous a pris à bord, vous ne pouvez plus jamais redescendre, et même si vous vous brûlez la cervelle, comme moi, vous restez à bord avec votre suicide, et c’est l’horreur. J’étais mort, couché sur le pont, et autour de moi je voyais mes quatre épouses accroupies, écrivant tout ce qu’elles savaient de moi, et derrière elles était mon fils qui écrivait aussi, et Gertrude Stein était là et écrivait, et tous mes amis étaient là et racontaient tous les cancans, toutes les calomnies qu’ils avaient pu entendre à mon sujet, et dans toutes les universités d’Amérique une armée de professeurs classaient tout cela, l’analysaient, le développaient, fabriquant des milliers d’articles et des centaines de livres…» Des biographies et des cancans, et encore des cancans et des biographies… Mais qui s’intéresse encore aux livres du célèbre romancier américain?