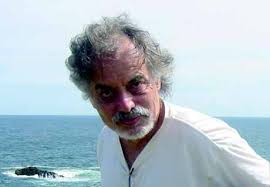Information ou désinformation
Par Pierre Béguin
Dans son émission de jeudi dernier, le téléjournal (le TJ, comme on dit) se fend d’un reportage de deux minutes sur le CEVA, le début du percement du tunnel de Champel et, accessoirement, sur les problèmes trop souvent occultés que génère ce chantier pharaonique. On aurait pu s’attendre à deux minutes d’information, ce fut plutôt deux minutes de désinformation. Quand on entend le chef des infrastructures CFF dire la bouche en cœur «qu’on propose dans toute la Suisse les mêmes règles, les mêmes normes, sans passe-droit», on croit rêver. Comment ce Monsieur pourrait-il ignorer que les oppositions des résidents de la Chapelle reposent justement sur le fait que les normes antibruit adoptées dans le tunnel de Champel sont bien supérieures à celles prévues dans le tunnel de Pinchat, quand bien même ce dernier est moins profond que celui de Champel? Comment peut-on prétendre appliquer les mêmes règles dans toute la Suisse alors que, sur un même tronçon, à un kilomètre de distance, les normes sont différentes? Faudrait-il conclure à un grossier mensonge pour désinformer les genevois? Et comment les responsables du reportage peuvent-ils laisser passer des affirmations (volontairement?) fausses sans veiller à une rectification par les parties concernées.
De même s’irrite-t-on à entendre M. Barthassat reprendre avec virulence le sempiternel refrain des autorités contre toute forme d’opposition: «Il est inadmissible qu’on prenne les genevois en otage… », refrain déjà entendu des dizaines de fois avec les mêmes accents culpabilisateurs. Comme me le disait il y a peu un ancien conseiller d’Etat et avocat dont je tairai le nom : «Les habitants de la Chapelle ont renoncé à faire valoir leurs droits en ne faisant pas opposition au CEVA». La formulation dit tout: faire opposition à un projet, c’est faire valoir ses droits; ne pas faire opposition, c’est y renoncer. Comment l’Etat peut-il s’offusquer d’oppositions citoyennes parfaitement légales lors même qu’il s’agit là du seul moyen pour ces citoyens de faire valoir leurs droits, irrémédiablement bafoués en cas d’abstention. Et celles ou ceux qui ne me croiraient pas feraient preuve d’une très grande naïveté. Je l’ai dit et je le répète: faire opposition est l’unique moyen de ne pas se retrouver écrasé. Et c’est bien ce qui s’est passé à la Chapelle: rappelons que les habitants de Champel se sont vus octroyer des mesures antibruit adéquates en compensation du retrait de leur opposition, alors que ceux de la Chapelle, ayant stupidement renoncé à toute opposition pour souligner leur adhésion au projet, se sont vus octroyer des mesures antibruit minimales, pour ne pas dire insuffisantes aux dires d’ingénieurs qui ne sont pas payés par le CEVA. Alors quand une sottise de l’Etat (et M. Barthassat s’est bien gardé de le souligner) a donné aux habitants de la Chapelle une seconde chance de formuler une opposition, ils ne se sont pas faits prier, expérience à l’appui cette fois, surtout après avoir dû affronter l’exceptionnelle mauvaise foi des autorités et des responsables du CEVA, et les nombreuses nuits sans sommeil dues au percement sauvage du tunnel – sauvage car totalement hors loi. Mais cette précision, les journalistes l’ont allègrement coupée au montage, comme d’autres d’ailleurs...
Enfin, une précision encore pour prévenir de futurs mensonges: quand l’Etat pointera d’un doigt accusateur les opposants pour justifier les dépassements budgétaires, ne vous laissez pas berner! Le budget du CEVA a explosé depuis longtemps, dépassant allègrement le seuil limite promis lors de la votation de 2009. Il suffit de savoir que les déchets du tunnel sont envoyés par camion à 400 kilomètres d’ici dans le sud de la France pour comprendre que ce n’est pas quelques oppositions légitimes qui changent la donne. Mais de cela, on n’en parle pas, comme de bien entendu…