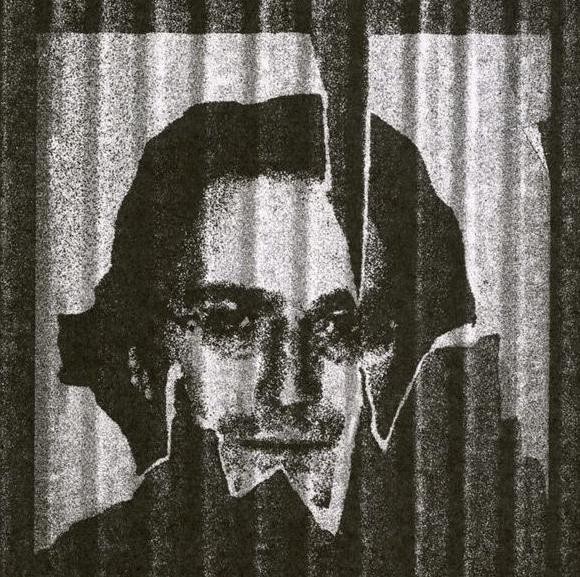révolution sexuelle (Holder toujours)
ANTONIN MOERI

Dans les années septante, la mode était de préférer la campagne à la ville. On allait dans le Sud s’acheter une ferme et cultiver les choux, la vigne ou les radis. C’est ce que firent les parents du narrateur. La pompe hydraulique ayant besoin de réparation, le père fait appel à Antoine qui répare l’appareil en moins de deux. Antoine a quitté une bonne situation dans le Nord pour faire plombier dans le Sud. Sa compagne, Blandine, est une blonde canon qui vit en autarcie avec son copain. Le narrateur a alors quatorze ans, il va prendre des leçons de piano chez cette femme qui croit en Jésus-Christ et qui va à la messe tous les dimanches. Un jour de pluie, la leçon de piano est interrompue par l’arrivée de Renato, un électricien tendre et viril, meilleur ami d’Antoine.
Le lecteur ne saura pas qui a fait des confidences au narrateur. Ce dernier apprendra que Blandine a hésité avant de s’abandonner dans les bras du bel Italien. Renato «verrouille la porte, la déshabille en un tournemain». Blandine attendait ce moment avec impatience, ne supportant plus l’ennui où Antoine la confinait. Renato a du doigté, il sait y faire avec les femmes, il colle la bouche contre le sexe de Blandine et aspire le bourgeon. Les cuisses de Blandine tremblent, ses orteils se recroquevillent. Non! supplie-t-elle quand elle touche au paroxysme.
Intrépide, fougueuse, passionnée, elle se glisse sous lui pour laper ses bourses et lécher sa verge. Elle a décidé de s’offrir «un festin de voluptés défendues», car l’époque prône la «révolution sexuelle». Ce corps nouveau, elle va le dévorer. Elle jouit plusieurs fois. «Il lui souriait avec bienveillance, comme s’il était fier d’elle». «Tou aimes la bite». La crudité des mots fait sauter le verrou. Elle ne s’empêche plus de hurler. Renato lui ouvre la porte d’une autre vie, à Lecce, Gallipoli ou Bari, où elle mangera des salades aux pieuvres fondantes, le sarago grillé, on ira brûler des cierges à Jésus, j’ai de l’argent, nous ouvrirons un commerce.
Tout le village est désormais au courant de cette relation torride, car on entend des hurlements dans la maison du plombier. «Vous entendez ça? Le brame du cerf, à côté?» C’est en l’enculant que l’électricien finit ces séances. Les hurlements sont tels que les mères enferment les bambins dans leur chambre et augmentent le volume de la radio. Après avoir été cognée par Antoine, Blandine part à Vintimille avec Renato, où ils ouvriront une pizzeria. Antoine vivra avec la mère de Blandine. Elle aussi, poussera des rugissements qui rendront les voisins songeurs. Le narrateur imagine, pour terminer, qu’ils vivent toujours ensemble, Antoine et la mère de Blandine, et qu’ensemble ils vont à la messe.
Comment raconter mieux cette génération post-68? On connaît les évocations de Houellebecq, beaucoup plus grossières, moins nuancées, j’aurais envie de dire beaucoup plus lourdes, moins enchantées. Et ceci parce que l’écriture de Holder n’est jamais aguicheuse, clin-de-l’oeillesque, relâchée ou vulgaire. L’auteur n’a pas besoin de s’appesantir sur les empoignades et les emmanchements. Il y a une économie et une délicatesse dans la phrase désencombrée de Holder qui permet au lecteur d’asseoir la beauté sur ses genoux, d’inventer «de nouveaux astres, de nouvelles chairs», d’entendre «le récit des ébats» de Blandine.
Je vous recommande l’achat de ce bijou. Il vaut des pépites.
Eric Holder: Embrasez-moi, Le Dilettante, 2011