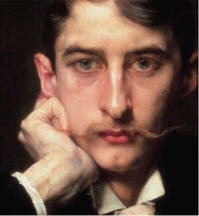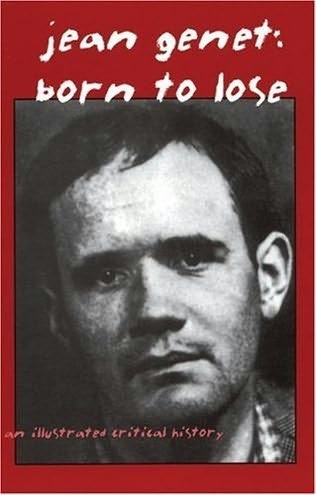un bien curieux thésard
par antonin moeri

Dès qu’on entend les mots «thèse de médecine», on imagine un ouvrage mince ou épais, laborieusement écrit, sur le fonctionnement des surrénales, avec moult graphiques, tableaux, grilles, preuves, observations et hypothèses. La déesse Science organisant tout ça. On est par conséquent sidéré en lisant la thèse de Louis-Ferdinand Destouches. L’entrée en matière, d’un lyrisme soutenu, annonce la couleur: quand l’humanité s’ennuie, elle brûle quelques idoles, elle veut changer de costume (l’auteur parle de la révolution française) pour mieux retourner ensuite vers la routine des bons sentiments. C’est dans une période convalescente de ce genre que naquit Semmelweis, le médecin hongrois qui découvrit l’asepsie, au grand dam de ses supérieurs, les «grands auxiliaires de la mort».
La vie de Semmelweis (qui conseilla de se laver les mains, après avoir disséqué des cadavres, pour aller ouvrir un ventre ou palper un col utérin) est racontée dans une langue très littéraire. Les formules singulières («le royaume de la frénésie») côtoient les images les plus étonnantes: «ces torves sourires qui rôdent tout le long du néant», ou bien: «On n’enfonce pas la terre dans le ciel avec un marteau».
Celui qui adoptera le nom de sa grand-mère (Céline) se projette dans la figure de Semmelweis: origine modeste - l’école ne vous apprend rien, ce sont la rue, le rêve, le rythme, la musique qui offrent la meilleure éducation - s’attacher à une femme et à un enfant est asphyxiant - le goût pour l’insolence et la provocation - plutôt que planer dans les sphères, penser à celles qui souffrent dans leur chair - la suffisance et l’hypocrisie des «auxiliaires de la mort» qui se gargarisent de belles phrases - refus de pactiser avec la Mort en hurlant avec les loups - l’émerveillement devant la naissance d’un enfant.
En fait, cette thèse sur Semmelweis n’est pas qu’un travail de biographe (bien que Louis-Ferdinand prétende adopter le point de vue objectif de l’historien) mais plutôt le travail d’un romancier, un romancier qui n’aurait pas encore écrit «Mort à crédit». Certains détails ouvrent les vannes d’une imagination débridée. Ce qui préfigure la transposition, procédé que Céline développera à la perfection dans la trilogie allemande.
Le professeur Brindeau, qui présidait la thèse, ne s’est pas trompé quand il a dit du jeune docteur: «Il est fait pour écrire ce garçon-là». Peut-on imaginer un professeur Brindeau dans les actuelles facs de médecine? Un professeur qui accepterait une telle thèse, qui saurait repérer le talent d’un futur romancier et qui serait sensible à une phrase de ce type: «La Musique, la Beauté sont en nous et nulle part ailleurs dans le monde insensible qui nous entoure» ?
Louis-Ferdinand Céline: Semmelweis, préface de Philippe Sollers, Gallimard, L’Imaginaire, 1999 (12 francs)

 Je viens de recevoir, par la poste, le dernier livre de Jacques Chessex, L'Interrogatoire*. Avec, sur la page de garde, une dédicace écrite au Pentel noir, d'une graphie souple et belle. En amitié. Jacques C.
Je viens de recevoir, par la poste, le dernier livre de Jacques Chessex, L'Interrogatoire*. Avec, sur la page de garde, une dédicace écrite au Pentel noir, d'une graphie souple et belle. En amitié. Jacques C. par Jean-Michel Olivier
par Jean-Michel Olivier Car tout, dans le livre écrit à quatre mains d'Olivier Adam et d'Arnaud Auzouy, appartient aux fantômes. L'atmosphère, les images, l'air même qu'on y respire. Nous sommes dans un pays marqué par la disparition.
Car tout, dans le livre écrit à quatre mains d'Olivier Adam et d'Arnaud Auzouy, appartient aux fantômes. L'atmosphère, les images, l'air même qu'on y respire. Nous sommes dans un pays marqué par la disparition. On le voit : ce livre est sans doute prophétique. Comme Simon Steiner, son héros, erre à travers une forêt de fantômes, il nous montre un pays qui, déjà, n'existe plus. Bien sûr, Kyoto n'est pas Fukushima. Mais il est facile d'imaginer ce qu'elle serait après un tremblement de terre ou une catastrophe nucléaire. Les photos d'Arnaud Auzouy en portent témoignage. On dirait que ce livre a été écrit juste avant la catastrophe. Et qu'il garde intacte la trace de ce qui va disparaître. De ce que nous avons perdu.
On le voit : ce livre est sans doute prophétique. Comme Simon Steiner, son héros, erre à travers une forêt de fantômes, il nous montre un pays qui, déjà, n'existe plus. Bien sûr, Kyoto n'est pas Fukushima. Mais il est facile d'imaginer ce qu'elle serait après un tremblement de terre ou une catastrophe nucléaire. Les photos d'Arnaud Auzouy en portent témoignage. On dirait que ce livre a été écrit juste avant la catastrophe. Et qu'il garde intacte la trace de ce qui va disparaître. De ce que nous avons perdu.