Féminisme et littérature III
Par Pierre Béguin
Les années 80 marquent la véritable entrée en politique de la femme. Mais attention! Comme s’il fallait justifier ontologiquement ce qui n’est finalement qu’une justice républicaine, elle fait de la politique «autrement», c’est-à-dire «mieux» que les hommes. Ses motivations pour la chose publique sont bien plus nobles, plus désintéressées que le vil carriérisme mâle, tant il est convenu – n’est-ce pas? – que la femme n’aime pas le pouvoir. Son lien ombilical avec la génération de demain est gage de compassion et bienveillance. Son atavisme domestique, curieusement (re)mis en évidence, l’a préparée de longue date au sens pratique, par opposition aux mâles qui n’en ont aucun, c’est bien connu (car la femme travaille 70 heures par semaine, toutes les statistiques l’affirment. Diable! 70 heures! De quoi vous culpabiliser les derniers bastions phallocrates et propulser ces dames au rang de sauveurs de la République). Dire qu’elles sont plus créatives, plus intuitives, plus sensibles relève de l’évidence. Plus souples, plus «psychologues», plus adaptables aussi. D’ailleurs, la vulgate psy ne cesse d’en abreuver ses lectrices consentantes dans tous les magazines féminins. Toute différence est acceptée et valorisée pour autant qu’elle penche du côté de la femme. Sinon, sus au macho!
Un déferlement d’amour maternel envahit les instances de l’Etat avec d’autant plus d’intensité niaise que nos sociétés vont mal. L’homme a échoué. Puisqu’on n’a rien trouvé de mieux pour sauver le monde, essayons la femme! Et voilà nos politiciennes aux ovaires salvatrices soudainement investies de travaux dignes d’Hercule: supprimer les guerres, instaurer la concorde entre les peuples ou, plus difficile encore, gérer les problèmes de la police genevoise. Et gare à elles en cas d’échec!
La campagne présidentielle de Ségolène Royale fut le point d’orgue de cette guimauve matricielle. En tenue blanche immaculée au milieu des sombres dinosaures de son parti, la «mère de famille» apparaît toute suintante de bons sentiments en «madone auréolée de son abnégation quasi sacrificielle». Le paradis existe, il est féminin, Ségolène est sa prêtresse et l’enfant son messie (encore heureux qu’elle ne nous ait pas fait le coup une seconde fois!) L’enfantement comme expression nombriliste! A quand une «Pregnant pride»? De la très loufoque «grossesse militante» de Sandrine Salerno aux actrices qui se font photographier, l’air béatement épanoui, le ventre rond fièrement découvert ou leur progéniture dans les bras, sous le titre «La maternité a changé ma vie», la pauvre Simone (de Beauvoir) aurait de quoi se lamenter dans sa tombe. Et pourtant, la nouvelle vague féministe, plus efficacement que la philosophe, a remplacé la puissance paternelle par la puissance maternelle. A l’image du couple «Brangelina», où le pauvre type a toujours l’air de suivre en se demandant ce qu’il fait là.
Bon! On y a gagné la disparition du père Fouettard et une belle revanche sur des milliers d’années d’oppression. C’est déjà ça. Et maintenant? Tiens! Et si on effaçait toute trace de la lignée paternelle? Suffit de supprimer la transmission automatique du patronyme, le principal lien symbolique que le père noue avec son enfant, faute d’une vérité biologique certaine. Le paradoxe est que celles qui demandent au père de s’associer à la grossesse en les envoyant suivre des cours pour respirer comme des phoques et «pousser» comme des malades, de manier les couches-culottes et de se transformer en père kangourou, sont aussi, en partie du moins, celles qui œuvrent à la disparition programmée de l’instance paternelle.
 Combien de femmes (et d’hommes) ont assis leur notoriété sur le cadavre de l’émancipation qu’elles (ils) ont dépouillé de tout sens pour nourrir leur carrière? C’est cet état des lieux qu’établit Elisabeth Badinter dans un brillant petit essai intitulé Fausse route. Un titre évocateur pour une condamnation du nouvel ordre moral féminin constitué en ligue de vertu à coup d’oukases, d’anathèmes et de diabolisations. Car mettre sur le même plan les affres de la bourgeoise occidentale peinant à concilier vie privée et vie professionnelle, ou les dérives de publicités sexistes – cf. ma note sur Blogres: Sandrine Salerno et les ligues de vertu, ou les récents, et non moins grotesques, coups de gueule de quelque députée opportuniste – avec des femmes frappées, martyrisées et violées non loin de chez nous pour quelque crime d’honneur relève de l’indécence et souligne les renonciations aux véritables objets du combat féministe.
Combien de femmes (et d’hommes) ont assis leur notoriété sur le cadavre de l’émancipation qu’elles (ils) ont dépouillé de tout sens pour nourrir leur carrière? C’est cet état des lieux qu’établit Elisabeth Badinter dans un brillant petit essai intitulé Fausse route. Un titre évocateur pour une condamnation du nouvel ordre moral féminin constitué en ligue de vertu à coup d’oukases, d’anathèmes et de diabolisations. Car mettre sur le même plan les affres de la bourgeoise occidentale peinant à concilier vie privée et vie professionnelle, ou les dérives de publicités sexistes – cf. ma note sur Blogres: Sandrine Salerno et les ligues de vertu, ou les récents, et non moins grotesques, coups de gueule de quelque députée opportuniste – avec des femmes frappées, martyrisées et violées non loin de chez nous pour quelque crime d’honneur relève de l’indécence et souligne les renonciations aux véritables objets du combat féministe.
Puisse-t-on lire dans cet essai l’augure, comme dans le mouvement Ni Putes ni soumises, d’un féminisme enfin débarrasser de ses obsessions différentialistes, refusant la posture victimaire et identitaire? L’auteur (avec «e» ou sans «e») de L’un est l’autre veut y croire. Et nous avec elle…
(A suivre)
Elisabeth Badinter, Fausse route, Odile Jacob 2003
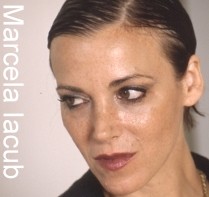 rogrès de l’humanité se mesurent dorénavant à l’aune de l’émancipation féminine, émancipation qui elle-même se mesure essentiellement aux pouvoirs qu’acquièrent nos consœurs et, surtout, à celui qu’elles retirent aux hommes. Finie la lutte des classes! Le sous-prolétariat exploité! Dans les années 80, face à l’essor du pan-libéralisme et au déclin du monde communiste, l’opposition hommes-femmes reste le seul paradigme de la domination. Et une riche bourgeoise sera toujours plus exploitée qu’un mineur de fond. La femme devient le porte-drapeau de l’idéologie victimaire qui s’est répandue dans cette période. Chaque homme doit faire son mea culpa public et confesser sa honte d’appartenir à une lignée d’hormones barbares. Il est ringard, caduc, triplement disqualifié: le passé l’accable, le présent l’accuse, le futur l’exclut. Il doit payer pour sa rédemption, surtout à son divorce, afin d’alimenter un assistanat qui, soudainement, n’est plus contradictoire avec émancipation (lire à ce sujet L’Empire du ventre de Marcela Iacub, juriste spécialisée en bioéthique et chantre du post féminisme, qui montre comment le système judiciaire éjecte le père pour laisser la place centrale à la relation mère-enfant). Des chanteurs de variété, dégoulinants de sincérité bêlante, célèbrent le genre qu’ils n’ont pas à grands coups de «Femmes je vous aime», de Julien Clerc à Sardou et son inénarrable «Femmes des années 80» en passant par Renaud et sa Miss Maggie: «Car aucune femme sur la planète n's'ra jamais plus con que son frère ni plus fière ni plus malhonnête à part, peut-être, Madame Thatcher». On avait connu Renaud plus inspiré en pourfendeur de clichés…
rogrès de l’humanité se mesurent dorénavant à l’aune de l’émancipation féminine, émancipation qui elle-même se mesure essentiellement aux pouvoirs qu’acquièrent nos consœurs et, surtout, à celui qu’elles retirent aux hommes. Finie la lutte des classes! Le sous-prolétariat exploité! Dans les années 80, face à l’essor du pan-libéralisme et au déclin du monde communiste, l’opposition hommes-femmes reste le seul paradigme de la domination. Et une riche bourgeoise sera toujours plus exploitée qu’un mineur de fond. La femme devient le porte-drapeau de l’idéologie victimaire qui s’est répandue dans cette période. Chaque homme doit faire son mea culpa public et confesser sa honte d’appartenir à une lignée d’hormones barbares. Il est ringard, caduc, triplement disqualifié: le passé l’accable, le présent l’accuse, le futur l’exclut. Il doit payer pour sa rédemption, surtout à son divorce, afin d’alimenter un assistanat qui, soudainement, n’est plus contradictoire avec émancipation (lire à ce sujet L’Empire du ventre de Marcela Iacub, juriste spécialisée en bioéthique et chantre du post féminisme, qui montre comment le système judiciaire éjecte le père pour laisser la place centrale à la relation mère-enfant). Des chanteurs de variété, dégoulinants de sincérité bêlante, célèbrent le genre qu’ils n’ont pas à grands coups de «Femmes je vous aime», de Julien Clerc à Sardou et son inénarrable «Femmes des années 80» en passant par Renaud et sa Miss Maggie: «Car aucune femme sur la planète n's'ra jamais plus con que son frère ni plus fière ni plus malhonnête à part, peut-être, Madame Thatcher». On avait connu Renaud plus inspiré en pourfendeur de clichés…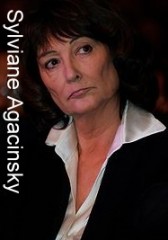 L’option naturaliste, très tendance à partir des années 1980-1990, d’abord à gauche de l’échiquier politique (le mouvement de libération de la femme a toujours été récupéré par la gauche: «Je suis socialiste, donc féministe» disait Jospin), qui se place, au contraire des culturalistes, sur le même terrain biologique que les discours essentialistes auxquels elle s’oppose. La femme a bel et bien un destin biologique qui, loin de la reléguer aux rôles subalternes, la propulse légitimement sur l’avant scène politique, et même économique: son utérus et ses deux chromosomes X fondent sa supériorité en ce qu’ils lui permettent d’accueillir l’Autre en elle, lui conférant ainsi, par essence, une richesse de dispositions inconnues des pauvres chromosomes XY. Voilà pourquoi elle est doublement l’avenir de l’homme. C’est l’option Sylviane Agacinsky dans Politique des sexes, grande inspiratrice du féminisme dans les années 90 et égérie de la politique féministe jospinienne.
L’option naturaliste, très tendance à partir des années 1980-1990, d’abord à gauche de l’échiquier politique (le mouvement de libération de la femme a toujours été récupéré par la gauche: «Je suis socialiste, donc féministe» disait Jospin), qui se place, au contraire des culturalistes, sur le même terrain biologique que les discours essentialistes auxquels elle s’oppose. La femme a bel et bien un destin biologique qui, loin de la reléguer aux rôles subalternes, la propulse légitimement sur l’avant scène politique, et même économique: son utérus et ses deux chromosomes X fondent sa supériorité en ce qu’ils lui permettent d’accueillir l’Autre en elle, lui conférant ainsi, par essence, une richesse de dispositions inconnues des pauvres chromosomes XY. Voilà pourquoi elle est doublement l’avenir de l’homme. C’est l’option Sylviane Agacinsky dans Politique des sexes, grande inspiratrice du féminisme dans les années 90 et égérie de la politique féministe jospinienne.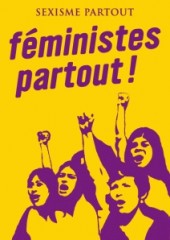 Une collègue écrivain – pardon! écrivaine –, peu après la création de «Blogres» à propos d’une note sur les quotas, m’envoyait un mail dans lequel elle précisait notamment: «Je reste rêveuse en lisant la composition de votre groupe de Blogres… Grands dieux, m’imaginerais-je qu’un beau jour vous vous êtes réunis et vous avez décrété: "pas de femmes parmi nous !" (…) Eh oui, même dans votre esprit progressiste, le masculin reste la norme».
Une collègue écrivain – pardon! écrivaine –, peu après la création de «Blogres» à propos d’une note sur les quotas, m’envoyait un mail dans lequel elle précisait notamment: «Je reste rêveuse en lisant la composition de votre groupe de Blogres… Grands dieux, m’imaginerais-je qu’un beau jour vous vous êtes réunis et vous avez décrété: "pas de femmes parmi nous !" (…) Eh oui, même dans votre esprit progressiste, le masculin reste la norme».



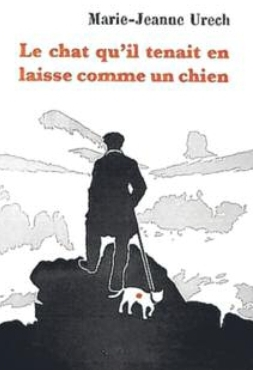
 gé lors d’un voyage en Amérique du Sud (le lieu mentionné est Quito, en Equateur), continent dont le réalisme magique a inspiré le récit. Ecrit par Marie-Jeanne Urech dont on avait déjà apprécié les derniers textes (voir
gé lors d’un voyage en Amérique du Sud (le lieu mentionné est Quito, en Equateur), continent dont le réalisme magique a inspiré le récit. Ecrit par Marie-Jeanne Urech dont on avait déjà apprécié les derniers textes (voir 